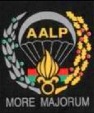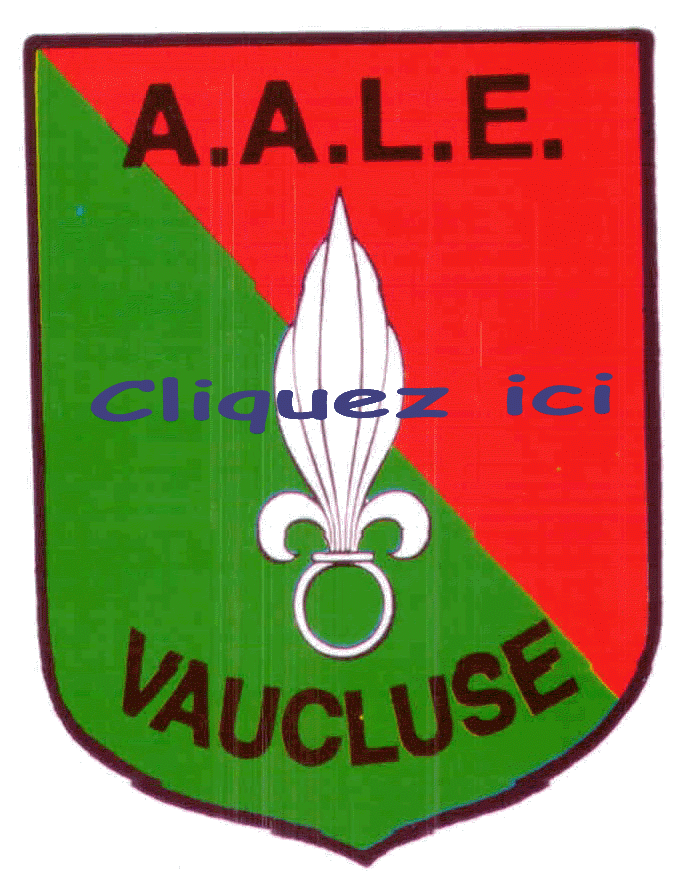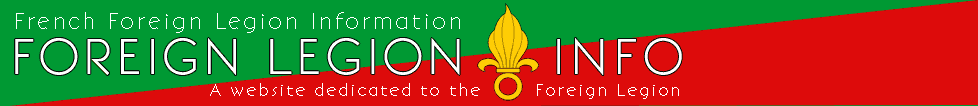aa
2011

Français par le sang versé.
Na-San
aa
Je suis un fusil récupéré.
aa
Sablons avec le 3/3° REI
aa
L’Honneur d’un Officier
Publié le 17/12/2011
Un article d’opinion de notre dessinateur, René Le Honzec.

Français et Américains surent utiliser les qualités de ces ethnies farouchement hostiles aux occupants Viets en les formant en maquis, d’une redoutable efficacité. Dien Bien Phu aurait, peut-être, pu être sauvé par ces maquis Méos (Hmongs) menés par une poignée d’officiers et sous-officiers atypiques comme Déodat Dupuy- Montbrun (lisez ses polars !). La République du Viet-Nam disparue, des maquis montagnards subsistèrent, abandonnés de tous. Plus de 100 000 purent s’enfuir aux Etats-Unis, 10 000 en France. En décembre 2007, une dépêche annonçait la déportation de 4000 survivants Hmongs, réfugiés-internés en Thaïlande, vers l’état communiste du Laos, constant dans sa politique génocidaire à leur égard. La « Communauté Internationale s’est déclarée indignée », poil au nez. BHL n’y était pas.
C’est pour combattre une dernière fois pour ses camarades Hmongs que le colonel Jambon a tiré sa dernière cartouche. Le 28 novembre 2011, le commandant Elie Denoix de Saint-Marc, 89 ans, ex- résistant, ex- officier légionnaire au Tonkin, ex-commandant du 1er REP putchiste en 1962, ex- condamné de la Vème République, a été fait Grand Officier de la Légion d’Honneur par Nicolas Sarkozy, Président de la République Française. Ce Héros n’avait pu accepter l’abandon des Harkis après celui de ses partisans Tho en 1950. Au moment ou un ancien Président est condamné pour de basses magouilles mercantiles, ces deux hommes illustrent une notion perdue par la plupart de nos élites et du peuple : la vertu de l’Honneur. Il n’y a pas que l’économie, la politique, la retraite, les conditions de travail, Koh Lanta, les vacances, etc…
Il y a la Vertu, il y a l’Honneur, indignez-vous ! Indignez-vous !
Ma dernière cartouche
L’éloquence philosophique du légionnaire

mardi 6 juillet 2010, par

Là, devant moi, un énorme in-folio, fabriqué de quatre gros cahiers Clairefontaine, couvertures agrafées dos à dos. Un titre, tapé à la machine, sur la reliure artisanale en plastic rouge, et qui évoque les balbutiements d’un apprenti philosophe découvrant la force nerveuse des mots : « Phénomènes des cours de philosophie de Charles Cambe – Année 1971-1972 ». Charles Cambe était mon prof’ de philo au lycée de Tarbes. Il était colonel de la Légion.

Crâne rasé, verbe calme et tranchant, gouailleur avec les cancres (je n’en étais plus) qui fréquentaient les bars à filles de cette ville naguère de garnison, sarcastique avec les bons de la Terminale A1 (je n’en étais pas) dont il savait qu’ils cesseraient de faire semblant de penser une fois le bac décroché, il arrivait en classe, le jour de cérémonies militaires devant le monument aux morts gravé d’éloquence lapidaire - NI HAINE NI OUBLI -, portant son uniforme de sable ; il posait son képi sur le bureau lui-même légèrement surélevé par une estrade ; il nous regardait, faisait l’appel et commençait d’une voix régulière, posée, sans aucune trace d’accent pittoresque, comme il se doit d’un moine de la République une et indivisible, une voix pleine et franche - « dynamique » serait le mot juste. En Terminale A2, celle des moins bons, le prof’ était un yéyé qui tirait sur son clope, faisait parfois la classe sur le pavé du préau, tutoyait ses élèves et qui, s’il avait eu le courage de ses convictions à la Jacques Dutronc, aurait fait crac-boum-hue avec eux, et leurs copines ; mais c’était un jeu d’apparences car, la seule fois où notre colonel avait dû s’absenter, pour aller rendre hommage à un de ses hommes et lever son verre « pour la poussière », le yéyé de l’A2 avait repris le cours exactement au point où le légionnaire avait laissé tomber sa voix pour aller prononcer son éloge funèbre, et cette reprise fut sans couture apparente. Ils s’étaient réparti les rôles. Ne jamais se fier aux apparences ni à l’habit, fût-il de sable ou de yéyé, qui ne fait pas le philosophe.
J’ouvre le premier cahier et commence à lire le chapitre I (mon in-folio artisanal en compte 41), à la date du 16 septembre 1971. J’avais compris, immédiatement, que je devais à la philosophie de transcrire la vive voix : « stupide » disaient les bons de la classe, mais stupéfié au sens divin du mot stupor, cette impression qui frappe l’esprit devant un événement inouï ; je pris l’habitude de prendre des notes verbatim et in extenso, technique d’art de mémoire profondément rhétorique, apprendrai-je plus tard ; habitude que j’ai gardée et qui me remet encore dans l’oreille la parole languissante de Barthes, comme si j’y étais, ou celle des remarques abruptes de Levinas. Mon gros in-folio répétait, sans que je l’eusse deviné car j’étais ignorant, la technique très ancienne des recueils de phrases et des livres de citations, sources de l’invention chez les grands rhéteurs, de l’Antiquité à la Contre-Réforme, et de la transmission du savoir de bouche à oreille, depuis le premier acte mythique où Apollon, dieu de la parole, cracha dans la bouche de son premier devin.
Voici l’entame de mon premier cours de philosophie : « La sensibilité. La connaissance sensible est la connaissance acquise par les sens. L’attitude philosophique consiste à s’arrêter en face de faits qui vont apparemment de soi ; attitude de tout le monde. Il ne faut pas confondre le sens et l’organe : un sens est le pouvoir d’éprouver une certaine catégorie de sensations ; un organe est un ensemble de cellules nerveuses ‘terminales’ (et là je me souviens d’un bref éclat de regard, derrière ses fines lunettes cerclées d’or : le colonel aimait l’ironie), sensibles à certains phénomènes ». Voilà comment, à seize ans, cheveux longs et puceau, j’entrai en philosophie. Je n’en suis plus sorti (de la philosophie, cela s’entend). A seize ans, un véritable coup de foudre pour la parole philosophique, l’éloquence de l’esprit : durant un an, le colonel Charles Cambe me mena, en 41 étapes, le long d’un parcours initiatique dont les grands modèles sont, dans l’Antiquité, la Table de Cébès et à notre âge classique les Délices de l’Esprit, lorsqu’un maître devise en philosophant et conduit un jeune homme de lieu d’intelligence en lieu de méditation, stimulant le désir d’en savoir plus par l’aiguillon de sa seule parole ; et lui fait découvrir à chaque porte franchie un nouvel émerveillement de l’intellect afin qu’ une fois sorti le jeune homme sache « bien savoir conduire sa vie ». Son éloquence donc me mena et me fit percevoir ce que je fus destiné à devenir.
On imagine mal, maintenant, alors que tout conspire à anéantir l’esprit critique des lycéens, maintenant que règne chez les adultes le culte du mot clef (« rilance », tout neuf, nul comme un cent d’euro), on imagine mal le cours de vie qu’étaient ces cours de philosophie, ceux du colonel comme ceux du yéyé de la Terminale A2 : on nous apprenait à chevaucher des cavales rétives et des étalons sauvages. Dehors, passe, j’entends le bruit de leurs sabots, alors que j’écris cette chronique, une horde de chevaux qu’on rentre au haras, non loin du même lycée. Sous le coup de cette parole philosophique, chaque jour, durant plusieurs heures, au timing le plus juste de la matinée, quand nous étions éveillés dans l’état le plus vierge et le plus séminal de nos seize ans, le colonel voulait faire de nous des cavaliers et des étalons.
La suite même des cours est une leçon sur la puissance formatrice de la philosophie, mise au sommet de notre éducation lorsqu’au moment même où l’Etat se sépara de l’Eglise la République supprima la rhétorique pour lui substituer la philosophie. Mais, simplement, une éloquence plus haute supplanta une éloquence devenue trop littéraire. Qu’ils étaient éloquents, et beaux, nos professeurs de philosophie ! Ils avaient endossé le manteau des grands prédicateurs, pour éduquer, vraiment éduquer, les apprentis citoyens.
Je vous donne le plan du cours du colonel Cambe : majestueusement, cheminant vers le sommet de la montagne, comme dans la Table de Cébès, nous passâmes de la connaissance sensible à l’inconscient, puis à la mémoire (ah ! le passage sur « la reconnaissance agie, la reconnaissance sentie et la reconnaissance pensée », si seulement on pesait ces simples définitions en politique), et à l’imagination, ensuite au langage et aux signes. Deux mois s’étaient écoulés. Un gros cahier. En novembre, alors que les Pyrénées virent au gris et au pluvieux, un cran, une marche, un progrès pour rompre la mélancolie : voici, coup sur coup, le concept, le jugement, le raisonnement, la connaissance scientifique, les mathématiques, les sciences expérimentales, les mathématiques appliquées, les sciences biologiques, l’histoire et le devenir historique (je relève : « un document est soit un vestige, soit un témoignage »… eh oui, aussi simple que cela, mais il lui fallut vingt pages de notes, au colonel, son képi sur le bureau, pour nous faire percevoir la valeur de cette distinction), le fait sociologique et, presqu’au sommet de la montagne, la porte éclatante, celle de perle et d’ivoire comme disait, je crois, Homère : la Vérité (je m’étais allé à y mettre une majuscule, on devait alors être avant les vacances de février). A la reprise, il nous parla de l’habitude, de la volonté, du plaisir et de la douleur, de l’émotion, de la passion (je lis : une passion est ou « dominante, ou dominatrice ou exclusive » : tout un programme !) suivi d’une glissade presque barthésienne, inattendue chez le légionnaire, sur « la vie d’une passion ». La Terminale A1, quand les marronniers commençaient de verdir, écoutait le colonel Cambe deviser sur la morale, le devoir, la responsabilité, les sanctions, et puis sur les écoles de morale antiques, Kant, l’utilitarisme et « les philosophes de la vie », enchaînant sur Nietzsche (« Vous n’engendrerez point ! », « ce qu’il y a de grand dans un homme c’est qu’il est un pont et pas un point d’arrivée » ; « être homme c’est se surmonter »), enfin Bergson, Sartre et Marx : « Rétablir la DIGNITE de l’homme c’est détruire l’aliénation du travail » - là, j’avais osé des majuscules pour tout un mot, le colonel avait dû ôter ses lunettes cerclées d’or, les poser sur la table, et accentuer le terme.
Alors vinrent, à l’approche de la fin des classes, trois surprises car, après un an de fréquentation quotidienne, nous nous étions tous fait une idée du colonel-philosophe : les cancres nous assuraient l’avoir vu au bordel, les bons affirmaient qu’il ne fumait jamais (étonnant à l’époque), d’autres parlaient à mots couverts de sa femme (une de ces grandes beautés à la Dominique Sanda, venues des colonies, que je ne rencontrai qu’une seule fois) : il nous jeta au visage, comme on vous lance un défi, trois cours, rapides et lumineux, car nous étions alors aguerris et pensions aller au pas de charge. D’abord deux leçons sur la beauté et sur Dieu – lui ? nous parler du beau et de Dieu ? Il fallait nous désarçonner. De la beauté, je lis : « Beau, ce mot vient de bellus, diminutif de bonus. Bellus est familier et était employé à l’égard des femmes et des enfants, « joli » ; adressé à un homme c’était très, mais très, péjoratif, vous voyez ce que je veux dire, pour un homme on disait pulcher ». Le colonel, nous ayant égayés, passait alors aux choses sérieuses, point par point, et nous ayant élevé l’âme vers l’esthétique il allait, systématiquement, comme à la manoeuvre, nous mettre sous les yeux de l’esprit toutes les preuves de l’existence de Dieu, déployées a priori et a posteriori. Face à face, sur l’échiquier de la vie, le plus fort des dilemmes qui se pose à un homme qui doit « se surmonter » : par les sens, ou par la transcendance ? Histoire de dire : tout ce que je vous ai enseigné est maintenant à tester contre cette double possibilité. Pesez ! Pensez ! Car « se surmonter » c’est être libre. Et devinez quel fut son cours d’adieu aux armes , la dernière surprise du légionnaire-philosophe, doigt sur la couture du pantalon ? La Liberté. « Vous êtes libres de juger ». Beau travail !
Il me souvient de lui avoir rendu visite, chez lui, avant les épreuves du bac. Il a signé mon gros cahier artisanal, 8 juin 1972, sans dire un mot. Il m’a seulement demandé comment allait mon père. Je l’ai revu une fois, une fois seulement, quand j’ai intégré à la rue d’Ulm, en juillet 1975. Je suis allé le remercier de m’avoir formé, lui avouant que, souvent, à Louis-le-Grand, je rouvrais mon gros cahier pour retrouver la bonne voie, la rectitude, la joie même de penser. Il m’a dit : « Salazar, vous auriez dû faire Saint-Cyr. Un Ricard ? ».
Charles Cambe, colonel, légionnaire, philosophe, est mort en juillet 2005. Tant que la République se tient à la hauteur de ces professeurs-là, lui comme le yéyé de la Terminale A2, et qu’elle se maintient à hauteur de cet enseignement-là, de cette éloquence-là, cette République aura des « valeurs ». Où est la source de la crise et du déchoir de la République ?
Je cède la parole au colonel, et c’est l’ultime phrase de mon gros cahier : « Cette notion de liberté fondamentale qu’est la liberté de vouloir est le plus souvent un mot. Généralement pour l’homme non-philosophe la « vraie » liberté, celle qui a un sens, c’est l’ensemble des libertés d’agir ». Cette République est-elle devenue seulement cela : une somme de libertés d’agir, et sa revendication stridente la seule « éthique » valable, depuis la tête de l’Etat jusqu’au simple citoyen ? Quand allons-nous enfin nous « surmonter » ?
Pierre Koenig : un sergent devenu Maréchal de France
aa
L’adieu à nos sentinelles de pierre
Par le Général de corps d'armée Bruno DARY, Gouverneur militaire de Paris.

Le 11 novembre, la France a honoré dans un hommage unique les Poilus de 1914 et les soldats tombés en opérations extérieures.
Qu'ils aient été tués dans les tranchées ou qu'ils aient péri sur le sol afghan, comme ce légionnaire, mort la semaine dernière, Serbe de sang mais Français de cœur, tous sont morts pour la France!....
Au-delà de leur vocation commune de défendre le pays, que de changements entre ces deux époques : les premiers ont péri sur notre terre ‘‘charnelle'' en défendant nos frontières ; les autres sont morts loin de chez eux, aucun sur le territoire national !
Ces différences sont dues à l'évolution de la Défense, des risques et des menaces, car en moins de vingt ans, une véritable accélération de l'histoire a bouleversé notre environnement : pour la première fois de son histoire, la France n'a plus de menaces majeures à ses frontières ; le terrorisme s'est fait jour sur notre sol et chez nos alliés ; les moyens de transports aériens et maritimes ont décuplé et augmenté les échanges internationaux, mais ont créé de nouvelles vulnérabilités sur les voies d'approvisionnement ; Internet est apparu, modifiant nos modes de vie et de travail et les systèmes d'information deviennent le centre nerveux de toute entreprise humaine, sans que leur sécurité ne s'adapte à leur généralisation.
L'ère du sans frontières
Le monde est entré dans une ère nouvelle, celle du sans frontières, qui n'est pas le moindre aspect de la mondialisation. Les citadelles érigées par Vauban rappellent que depuis toujours, la sécurité d'un pays reposait sur ses ‘‘sentinelles de pierre'', bâties aux marches du pays, à l'instar de la Grande Muraille de Chine, de la ligne Maginot ou du Rideau de Fer, derniers témoins d'un passé révolu. Médecins sans frontières a ouvert la voie, suivis des reporters, avocats, architectes, musiciens, clowns...
Ainsi chaque pays est-il devenu la superposition de plusieurs territoires aux contours forts différents :
- le pays légal avec ses frontières traditionnelles, sa population, son droit, ses codes, ses élections, qui demeure encore au cœur de nos intérêts vitaux ;
- l'Europe de Schengen, espace de liberté, de sécurité et de justice, devenue zone de libre circulation des personnes, aux frontières identiques aux nôtres ;
- l'espace économique de Maastricht, zone de libre échange, mais aux ramifications mondiales ;
- le territoire écologique, aux limites plus floues : Tchernobyl a montré que les particules radioactives ne s'arrêtaient pas aux frontières ; l'effet de serre et la pollution concernent la terre entière ;
- le cyberespace, le moins visible et le plus sensible, sans frontières, ni limites, ni contrôles ;
- le territoire politique fondé sur les intérêts du pays, son histoire et sa place à l'ONU, dans l'UE, avec l'OTAN et sur la scène internationale.
L'adaptation des armées
Les armées françaises, qui ont toujours eu pour mission de garder les frontières, tout en assurant la défense de nos intérêts outre-mer, ont vu leur rôle se transformer radicalement, à travers quatre évolutions majeures : la disparition de menace à nos frontières, qui a éloigné le spectre d'une guerre totale, amené la suspension du service national et créé une nouvelle armée professionnelle ; l'apparition du terrorisme, dont la menace s'affranchit des frontières ; la multinationalité, car si la France figure parmi les pays qui comptent, elle ne règlera plus à elle seule les litiges extérieurs ; la globalité, car dans toute crise, si le recours à la force est parfois nécessaire, il reste souvent insuffisant, ne pouvant suffire à lui seul à établir une solution pérenne.
Or, à travers leurs engagements présents ou récents, les armées françaises montrent qu'elles ont su ‘‘prendre en compte'' ces différents territoires selon des modalités adaptées : la défense du territoire national, avec le contrôle permanent de l'espace aérien et la surveillance des approches maritimes ; Vigipirate pour protéger la population contre d'éventuelles attaques terroristes, et qui contribue à la sécurité des frontières de Schengen ; la protection des Français s'étend jusqu'en Afghanistan et au Sahara Occidental, car la France et ses alliés ne peuvent accepter de voir des régions entières devenir des zones de non-droit, où prolifère le terrorisme ; la sécurité de l'Europe a provoqué la longue intervention dans les Balkans ; le contrôle des flux commerciaux de l'UE justifie l'opération Atalante ; et la protection de nos ressortissants et de notre territoire politique explique notre présence au Liban, en Côte d'Ivoire et en Libye.
Ainsi, Poilus de 14, Français libres de 40, combattants de l'Union française, Harkis, appelés face au Pacte de Varsovie, soldats professionnels d'aujourd'hui, tous ont répondu à la même vocation du service des armes.
Tous ont montré que la défense de la France ne dépendait pas tant de l'épaisseur de ses murailles, en l'occurrence de ses sentinelles de pierre, que de ses ‘‘sentinelles de chair'' !
Eloge au Commandant Hélie Denoix de Saint-Marc


Eloge au Commandant Hélie Denoix de Saint-Marc
par le Général CA Bruno DARY, Gouverneur Militaire de Paris.
Aujourd’hui, 50 ans plus tard, à travers l’honneur qui vous est fait, il semble que l’Histoire soit sur le point de rendre son verdict !
Morts pour la France : multiplier les célébrations dilue le souvenir
le 18-11-2011
LE PLUS. Depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, la cérémonie du 11 novembre a revêtu différents aspects, s'éloignant progressivement de la seule commémoration des Poilus morts durant la Première Guerre mondiale. Une nouvelle évolution est-elle judicieuse ?
Par David Desforges
Un soldat français est mort lundi en opérations en Afghanistan. Un légionnaire. Un homme qui avait fait le choix de cette vie, le choix du "métier des armes", le choix de ce risque, le choix de cet engagement et, en fait, le choix d’une telle mort. Il rejoint ses 75 frères d’armes morts depuis 2001 sur ce théâtre d’opérations extérieures.
Mort pour une juste cause diront certains. Mort pour rien rétorqueront d’autres. Mort au champ d’honneur diront encore les anciens. Mort dans l’indifférence du plus grand nombre enfin.
Un Memorial Day "à la française" ?
C’est pour lutter contre l’oubli que, vendredi dernier, le président de la République a dévoilé son ambition de faire du 11 novembre un Memorial Day à la française ; jour unique à l’occasion duquel le pays honorerait ses morts au combat. Tous. Sans exclusive. Volonté sincère ou aveu d’échec lorsque les Français se détournent, ou simplement ignorent, l’engagement militaire de tant des leurs ? Peu importe, les deux thèses se défendent sans doute.

Bien sûr, le calcul politique n’est pas étranger à la démarche. En période pré-électorale, il est de bon ton et de bonne stratégie de marquer le terrain et de ne pas se voir ravir les thèmes de la nation, du sang versé et des honneurs dus aux morts au bénéfice traditionnel de qui l’on sait.
C’est donc "sans polémique" que François Hollande a souhaité répondre à Nicolas Sarkozy depuis l’ossuaire du Bois de la Gruerie dans la Marne pour regretter "une utilisation de l’Histoire au risque de la division". Le candidat de la rue de Solférino s’oppose à un jour de commémoration unique, au nom précisément du caractère unique de chacun des conflits qu’une telle journée embrasserait. "Chaque guerre a ses causes et ses caractéristiques dont il faut se souvenir pour ce qu’elles sont" avance, non sans raison, François Hollande.
De fait, la boucherie ignoble de la Grande Guerre n’est pas la conflagration de la Seconde Guerre mondiale. La guerre oubliée conduite en Indochine par la France pauvre de l’après-guerre n’est pas l’épouvantable déchirure à contre-courant de l’Histoire des "opérations de maintien de l’ordre" en Afrique du Nord. Et ces engagements armés - puisque tous n’avaient pas juridiquement le statut de guerres, sont évidemment sans rapport avec les interventions militaires entreprises par la France dans le cadre de mandats onusiens, au nom du droit d’ingérence humanitaire ou encore avec celles engagées contre le terrorisme.
Onze jours et onze nuits
Si les morts de la Grande Guerre défilaient sur les Champs-Élysées, leur procession durerait onze jours et onze nuits. Sans interruption. Six cent seize de leurs frères d'armes sont pour leur part tombés dans les 228 opérations extérieures conduites par la France depuis 1963. Mais le droit à la reconnaissance de la nation ne peut bien évidemment pas atteindre le nombre des victimes.
Dans un pays où il faut un siècle pour déclassifier certaines archives, pour un pays auquel il fallu plus de 50 ans pour reconnaître sa faute dans la déportation des juifs, dans un pays où certaines plaies semblent s’envenimer là où, partout ailleurs, elles cicatriseraient, il faut avoir la lucidité de reconnaître que certains morts risquent de n’être jamais honorés par la collectivité.
Les morts de la Grande Guerre sont parmi nous. Leurs noms sont gravés pour l’éternité sur les obélisques de nos villages. Ils nous observent de leurs regards hallucinés de martyrs. Les morts de la Seconde Guerre mondiale ne le sont pas moins. Ils ont rejoint leurs pères ou leurs oncles sur les faces encore lisses de ces obélisques que le lierre ou la mousse n’avaient pas même eu le temps de gagner.
Pour tous les morts sans stèle
Hormis dans certaines communes, assez rares, les morts d’Indochine, de Suez et d’Afrique du Nord, demeurent pour beaucoup des morts sans stèle. Quant à ceux plus proches de nous, du Tchad, du Liban, de Bosnie, de Côte d’Ivoire et d’Afghanistan, c’est comme si leur nombre, l’accélération de l’histoire et la complexité du monde devaient les priver du regard et de l’hommage de la communauté nationale
Si une journée unique n’est certes pas la meilleure solution, imagine-t-on sérieusement une "journée de l’Indo", une journée par pays d’Afrique du Nord et encore une journée des opérations extérieures ? La France se connaît. Personne n’y croit raisonnablement. Trop de célébrations divisent, diluent le souvenir. Assez de morts pour ajouter maintenant la polémique à la douleur.
Au-delà de leurs croyances, de leurs aspirations philosophiques, de leurs choix politiques, de la liberté de n’en avoir fait aucun ou de l’honneur d’avoir seulement servi, ces morts demeurent unis malgré la diversité des conflits qui les ont emportés. Ce n’est pas faire injure au "Poilu" de Verdun que de le célébrer avec le légionnaire de la vallée de Kapisa.
Tous sont morts pour la France
C’est pourquoi, le 11 novembre, le théâtre des petites opérations intestines de la politique aurait pu sonner une trêve, juste une. Par respect pour eux.
Page 1 sur 8