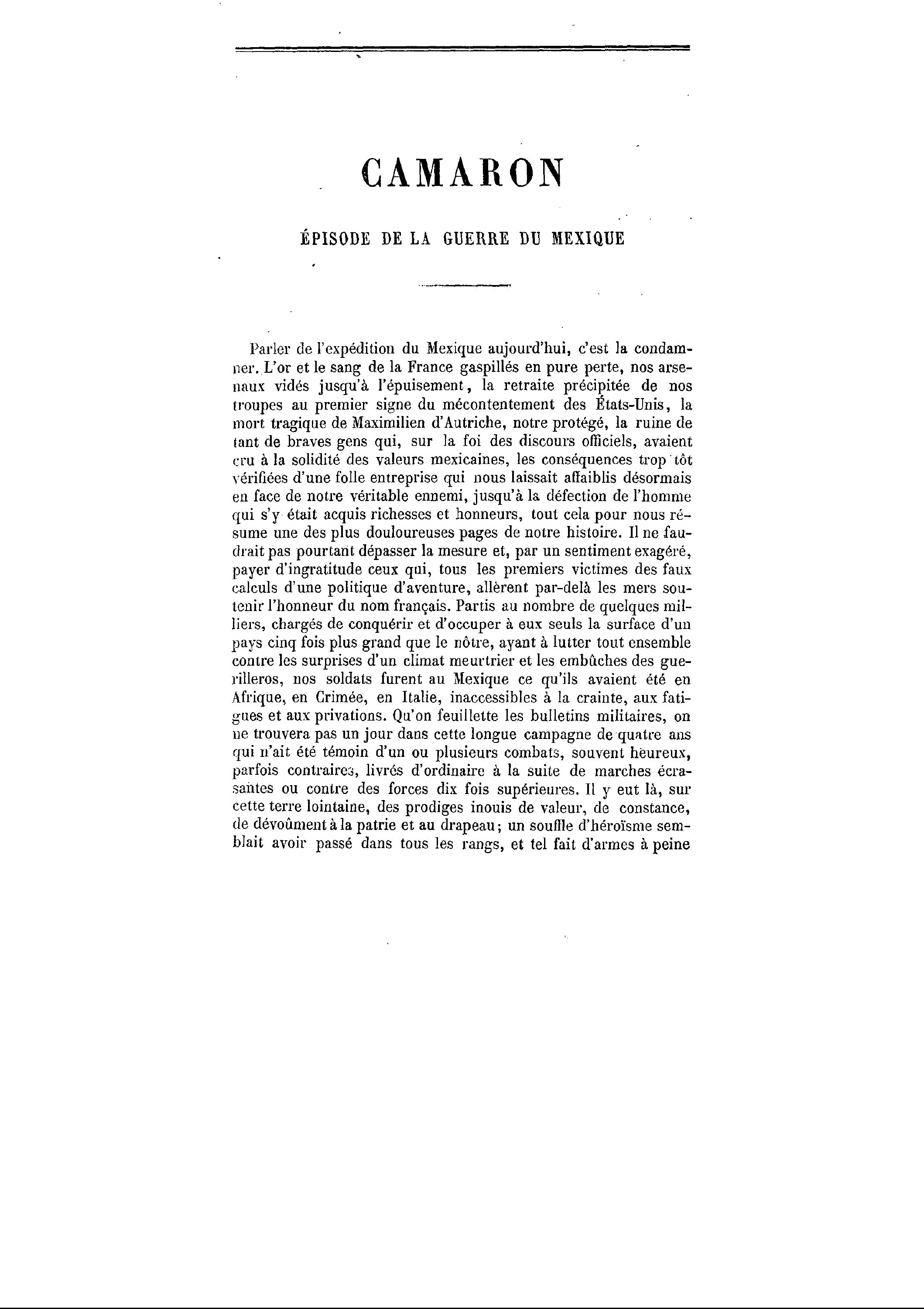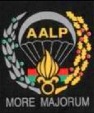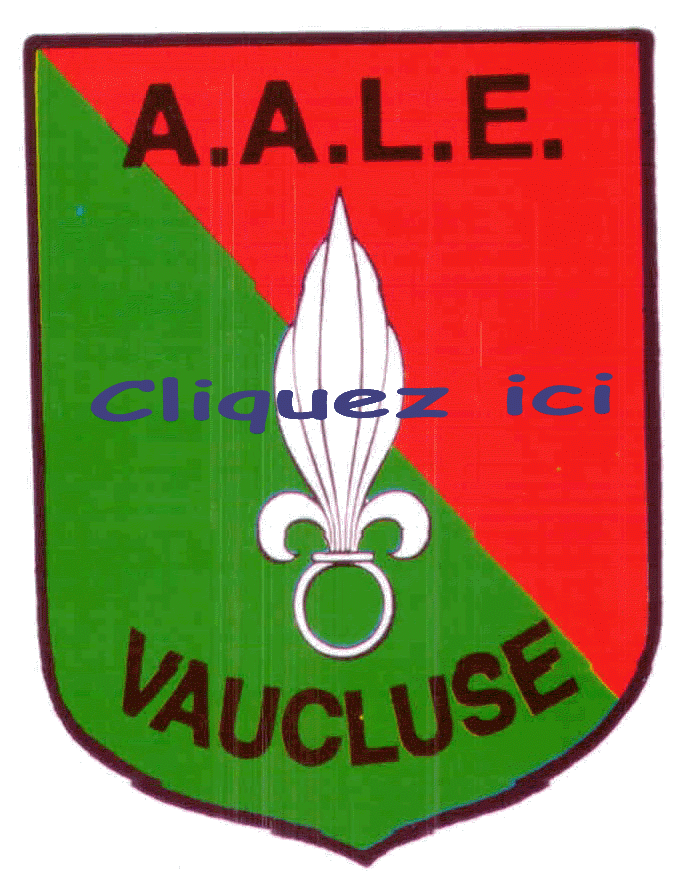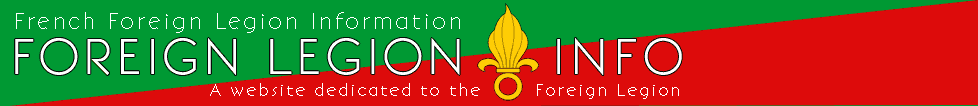1878
Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 11/08/1878.
CAMARON
Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 11/08/1878.
CAMARON PAR L. LANDE
Camaron (qui signifie écrevisse en espagnol) est le nom d un petit village du Mexique, où s'est passé le fait d'armes le plus inouï, le plus glorieux peut-être de tous ceux qu'on peut citer dans les annales de l'armée française.
C'est l'un des rares survivants de cette affaire qui l'a raconté à M. Louis Lande, lequel l'a transcrit pour les lecteurs de la Revue des Deux-Mondes,, dans le numéro du i5 juillet dernier.
La place ne nous permet de reproduire que la dernière partie de ce récit, la plus émouvante d'ailleurs. Voici le court résumé des événements qui l'amènent.
C'était après l'échec de Puebla. La 3e compagnie du 1er bataillon de la légion étrangère (une soixantaine d'hommes environ) se trouva acculée dans la cour d'une hacienda de Camaron par un gros de cavalerie mexicaine et s'y barricada d'une façon sommaire.L'ennemi occupait, de son côté, deux chambres du rez-de-chaussée et les alentours de la maison.
Le feu commença à neuf heures et demie du matin. A onze heures, le commandant de la compagnie, capitaine Danjou, tomba frappé d'une balle en pleine poitrine. A midi, trois bataillons d'infanterie vinrent renforcer la cavalerie mexicaine.
La vaillante petite troupe française avait à lutter dans la proportion de vingt contre un au moins.
Nous laissons maintenant la parole au survivant dont M. Louis Lande a rapporté le récit.
Ajoutons que le héros en question s'appelle le capitaine Maine, aujourd'hui en retraite.
L'assaut commença. Le premier élan des Mexicains fut terrible ils se ruaient de tous côtés pour pénétrer dans la cour, criant, hurlant, vomissant contre nous les imprécations et les injures,avec cette abondance qui leur est propre en pareil cas et que facilite encore l'inépuisable richesse du vocabulaire espagnol « Dehors les chiens de Français A bas la Canaille ! A bas la France ! Mort à Napoléon » Je ne puis tout répéter.
Pour nous, calmes, silencieux, chacun à notre poste, nous ajustions froidement, ne tirant qu'à coup sûr et quand nous tenions bien notre homme au bout du fusil les plus avancés tombaient le flot des assaillants oscillait d'abord, puis reculait en frémissant, mais pour revenir à la charge aussitôt après. A peine avions nous le temps de glisser une nouvelle cartouche au canon, ils étaient déjà sur nous. Leurs officiers surtout étaient magnifiques d'audace et de bravoure.
Rentrés en force dans le corps de logis, les uns s'occupaient d'ouvrir avec des pics et des pinces dans le mur du rez-de chaussée une large brèche sur la cour.
En même temps, d'autres s'étaient établis derrière la partie du mur d'enceinte qui faisait face aux grandes portes; de là, mettant à profit les créneaux que nous avions percés nous-mêmes et que nous n'avions pas pu défendre, en perçant de nouveaux; comme le niveau. du sol extérieur était plus élevé que celui de la cour, ils érigeaient sur nous un feu plongeant de ce côté encore ils parvinrent, quoique non sans peine, à ouvrir une brèche de plus de trois mètres.
Alors nous dûmes changer nos dispositions.
Le poste de réserve dont je faisais partie et qui tenait le.milieu entre les deux entrées se trouvait pris à découvert nous réunissait aux défenseurs de la porte de droite qui n'était plus attaquée, tous ensemble nous fîmes retraite dans l'angle sud-ouest de,la cour, sous le hangar ouvert, d'où nous continuâmes à tirer.
Vers deux heures et demie, le sous-lieutenant Vilain revenait de visiter le poste de la brèche et traversait la cour en diagonale dans la direction des grandes portes, quand une balle partie du bâtiment l'atteignit en plein front. Il tomba comme foudroyé.
En ce moment, il faut bien le dire, un sentiment d'horrible tristesse nous pénétra jusqu'au fond de l'âme. La chaleur était accablante le soleil en son zénith tombait d'aplomb sur nos têtes, un soleil dévorant, impitoyable comme il ne luit qu'aux tropiques; sous ses rayons à pic, les murs de la cour paraissaient tout blancs et la réverbération nous brûlait les yeux quand nous ouvrions la bouche pour respirer, il nous semblait avaler du feu dans l'air pesant comme du plomb, couraient ces tressaillements, ces ondulations qu'on voit passer sur les plaines désertes dans les après-midi d'été; la poussière que soulevaient les balles perdues frappant le sol de la .cour avait peine à quitter la terre et lentement montait en lourdes spirales; surchauffé tout à la fois par les rayons du soleil et la rapidité de notre tir, le canon de nos fusils faisait sur nos mains l'impression du fer rouge.
Si intense était l'ardeur de l'atmosphère dans ce réduit transformé en fournaise, que les corps des hommes tués s'y décomposaient à vue d’œil; en moins d'une heure, la chair des plaies se couvrait de teintes livides.
Pêle-mêle avec les morts, car. il n'y avait aucun moyen de les secourir, les blessés gisaient à la place même où ils étaient tombés; mais tandis qu'on entendait au dehors ceux des Mexicains gémir et hurler de douleur, tour à tour Invoquant la Vierge ou maudissant Dieu
et les saints, les nôtres, par un suprême effort, en dépit de leurs souffrances, restaient silencieux. Ils eussent craint, les pauvres garçons, d'accuser ainsi nos pertes et de donner confiance à l'ennemi.
Nous n'avions rien mangé ni bu depuis la veille les provisions s'en étaient allées avec les mulets nos bidons étaient à sec, car en arrivant à Palo-Verde, nous les avions vidés dans les gamelles qu'il fallut renverser ensuite, et, grâce à notre retraite précipitée, nous n'avions pas eu le temps de les remplir de nouveau enfin, dans le ravin, nous n'avions pu trouver d'eau.
Seul, au départ, l'ordonnance du capitaine portait en réserve dans sa musette une bouteille de vin, que M. Danjou lui même, au moment d'organiser la résistance; avait distribuée entre les hommes. A peine y en avait-il quelques gouttes pour chacun, qu'il nous versa et que nous bûmes dans le creux de la main.
Aussi la soif nous étreignait à la gorge et ajoutait encore aux horreurs de notre situation une écume blanche nous montait aux coins de la bouche et s'y coagulait nos lèvres étaient sèches comme du cuir, notre langue tuméfiée avait peine à se mouvoir, un souffle haletant, continu, nous secouait la poitrine; nos tempes battaient à se rompre, et notre pauvre tête s'égarait de telles souffrances étaient intolérables. Ceux-là seuls peuvent me comprendre qui ont vécu sous ce climat malsain et qui connaissent par expérience le prix d'un verre, d'une goutte d'eau.
J'ai vu des blessés se traîner à plat ventre, et, pour apaiser la fièvre qui les dévorait, la tête en avant, lécher les mares de sang déjà caillé qui couvraient le sol. J'en ai vu d'autres, fous de douleur, se pencher sur leurs blessures et aspirer avidement le sang qui sortait à flots de leur corps déchiré. Plus forte que toutes les répugnances, que tous les égouts, la soif était là qui nous pressait et puis on avait juré le devoir.
Nous en vînmes nous-mêmes à boire notre urine.
A la vérité, ce n'était guère le temps de nous apitoyer sur nous-mêmes ou sur les souffrances de nos camarades. Il fallait avoir l’œil tourné sur tous les points à la fois à droite, à gauche, en avant, vers les fenêtres du bâtiment, vers les brèches de la cour, car partout on voyait briller les canons de fusil et de partout venait la mort. Les balles, plus drues que grêle, s'abattaient sur le hangar, ricochaient contre les murs, faisaient voler autour de nous les éclats de pierre et les débris de bois. Parfois un de nous tombait, alors le voisin se baissait pour.fouiller ses poches et prendre les cartouches qu'il avait laissées.
D'espoir, il n'en restait plus; personne cependant ne parlait de se rendre. Le porte-drapeau Maudet, un vaillant lui aussi, avait remplacé Vilain un fusil à la main, il combattait avec nous sous le hangar, car déjà les progrès des ennemis ne permettaient plus de traverser la cour et de communiquer des ordres aux différents postes. Au fait, il n'en était pas besoin, la consigne était bien connue de tous: tenir jusqu'au bout, jusqu'à la mort.
Les Mexicains commençaient à se lasser; mais alors, pour mieux vaincre notre résistance, ils imaginent de recourir à une manœuvre de guerre fort en honneur parmi eux ils entassent de la paille et du bois à la partie nord-est du bâtiment et y mettent le feu l'incendie dévora d'abord un hangar extérieur, qui faisait face à Vèra-Cruz et qui de là gagna rapidement les toits.
Le vent soufflait du nord au sud et rabattait sur nous une épaisse fumée noire qui ne tarda pas à envahir la cour nous en étions littéralement aveuglés, et cette odeur âcre de la paille brûlée, nous prenant à la gorge, rendait plus ardente encore l'horrible soif qui nous tordait les entrailles. Enfin, au bout d'une heure et demie, l'incendie s'éteignit de lui-même, faute d'aliments pourtant cet incident nous avait été funeste à la faveur de la fumée qui nous dérobait leurs mouvements, les Mexicains avaient pu s'avancer davantage et nous tirer plus sûrement. Les postes de la brèche et de la porte dé gauche avaient perdu la plus grande partie de leurs défenseurs.
Vers cinq heures, il y eut un moment de répit les assaillants se retiraient les uns après les autres comme pour obéir à un ordre reçu, et nous pûmes reprendre haleine. Tout bien compté, nous n'étions plus qu'une douzaine.
Au dehors, le colonel Milan avait réuni ses troupes autour de lui et les haranguait, sa voix sonore arrivait jusqu'à nous, car tout autre bruit avait cesse, et à mesure qu'il parlait, sous le hangar, un ancien soldat de la compagnie, Bartholotto, d'origine espagnole, tué raide à côté de moi quelques instants plus tard, nous traduisait mot par mot son discours.
Dans ce langage en auu ei ooiure qui fait le fond de l'éloquence espagnole, Milan exhortait ses hommes à en finir avec nous; il leur disait que nous n'étions plus qu'une poignée, mourant de soif et de fatigue, qu'il fallait nous prendre vivants, que s'ils nous laissaient
échapper, la honte serait pour eux ineffaçable il les adjurait au nom de la gloire et de l'indépendance du Mexique, et leur promettait bien haut la reconnaissance du gouvernement libéral.
Quand il eut fini, une immense clameur s'éleva et nous apprit que l'ennemi était prêt pour un nouvel effort. Toutefois, avant d'attaquer, Milan nous fit adresser une dernière sommation; nous n'y répondîmes même pas.
L'assaut reprit plus terrible que jamais l'ennemi se précipitait sur toutes les ouvertures à la fois. A la grande porte, le caporal Berg seul restait debout; il fut entouré, saisi par les bras, par le cou, enlevé: l'entrée était libre, et les Mexicains s'y jetèrent en foule. Nous cependant, de notre coin, nous enfilions le mur en longueur; tous ceux qui se mon. traient dans cette direction faisaient aussitôt demi-tour; en moins de dix minutes, il y eut là plus de vingt cadavres en monceau qui obstruaient le passage et arrêtaient élan des nouveaux venus.
Par malheur, vers le même temps l'entrée de l'ancienne brèche était forcée; quatre hommes s'y défendaient encore, Kuwasseg; Gorski, Pinzinger et Magnin; mais tandis qu'ils repoussent les assaillants du dehors, franchissant portes et fenêtres, les Mexicains par derrière envahissent la cour: nos camarades sont contraints de faire face à cette attaque imprévue qui les prend à revers en vain veulent-ils résister à l'arme blanche, ils sont à leur tour désarmés et pris.
Sous le hangar, nous tenions toujours la poitrine haletante, les doigts crispés, sans répit chargeant notre carabine, puis l'armant d'un geste inconscient et fébrile, nous réservions toute notre attention pour viser. Chacun de nos coups faisait un trou dans leurs rangs, mais pour un de tué, dix se présentaient.
La porte naguère défendue par Berg, l'entrée ouverte dans le mur d enceinte, les fenêtres et la porte de l'hacienda vomissaient à flots les assaillants, et se traînant sur les genoux, dissimulés derrière un petit mur du hangar détruit qui à cet endroit avançait dans la cour, d'autres adversaires nous arrivaient continuellement par l'ancienne brèche.
Il faisait grand jour encore; dans le ciel d'un bleu cru, sans nuages, brillait le soleil aussi ardent, aussi implacable qu'en plein midi, et ses rayons à peine inclinés, comme s’acharnant après nous, fouillaient tous les coins de la cour. Plusieurs des blessés, frappés d'insolation et en proie au délire, ne pouvaient plus retenir leurs plaintes et demandaient à boire d'une voix déchirante les, mains contractées, les yeux injectés et saillants, les malheureux se tordaient dans les angoisses dernières de l'agonie et de leur tête nue battaient lourdement le sol desséché.
Depuis le matin, je n'avais rien perdu, fût-ce un seul moment, de mon sang froid, ni de ma présence d'esprit; tout à coup je pensai que j'allais mourir.
Souvent j'avais entendu dire que, dans un péril extrême, l'homme revoit passer en un instant, par les yeux de l'esprit, tous les actes de sa vie entière. Pour ma part et bien qu'ayant fait la guerre je me fusse trouvé parfois dans des circonstances assez difficiles jamais je n'avais rien observé de semblable. Cette fois il devait en être autrement. Ce fut comme un de ces éclairs rapides qui par les chaudes nuits des tropiques, précurseurs de l'orage, déchirent subitement la nue et, courant d'un pôle à l'autre, illuminent sur une étendue immense les montagnes et les plaines, les forêts, les villes et les hameaux pendant la durée de quelques secondes a peine, chaque détail du paysage apparaît distinct en son lieu, puis la nuit reprend tout. Ainsi mon passe apparut soudain. Je revis mon beau et vert pays de Périgord, et Mussidan où j'étais né, si sentiment assis entre ses deux rivières, tout embaumé de l'odeur des jardins, et les petits camarades avec qui je jouais enfant. Je me revis moi-même jeune soldat, engagé aux zouaves, bientôt partant pour la Crimée, blessé dans les tranchées, prenant part un des premiers à l'assaut du Peut-Redan, décoré.
Je me revis plus tard en Afrique, entré aux chasseurs à pieds et faisant parler la poudré avec les Arabes puis en dernier lieu rendant mes galons de sous-officier pour faire partie de la nouvelle expédition et visiter cette terre du Mexique où j'allais laisser mes os.
En effet, l'issue pour nous n'était plus douteuse. Acculés dans notre coin comme des sangliers dans leur bauge, nous étions prêts pour le coup de grâce. De moment en moment un de nous tombait, Bartholotto d'abord, puis Léonard.
Je me trouvais entre le sergent Morzicki, placé à ma gauche, et le sous-lieutenant Maudet à ma droite. Tout à coup Morzicki, reçut à la tempe une balle partie du coin de la brèche son corps s'inclina et sa tête inerte vint s'appuyer sur mon épaule; Je me retournai et le vis face à face, la bouche et les yeux grands ouverts.
Morzicki est mort, dis-je au lieutenant. Bah fit celui-ci froidement,un de plus ce sera bientôt notre tour, et il continua de tirer. `
Je saisis à bras-le-corps le cadavre de Morzicki,je l'adossai à la muraille et retournai vivement ses poches pour voir s'il lui restait encore des cartouches il en avait deux, je les pris.
Nous n'étions plus que cinq, le sous-lieutenant Maudet, un Prussien nommé Wensel, Cattau, Constantin, tous les trois fusiliers, et moi. Pourtant nous tenions toujours l'ennemi en respect; mais notre résistance tirait à sa fin, les cartouches allaient s'épuisant. Quelques coups encore, il ne nous en resta qu'une à chacun; il était six heures environ, et nous combattions depuis le matin. Armez vos fusils, dit le lieutenant : vous ferez feu au commandement ; puis nous chargerons à la baïonnette,vous me suivrez.
Tout se passa comme il l'avait ait.
Les Mexicains avançaient ne nous voyant plus tirer la cour en était pleine.
Il y eut alors un grand silence autour de nous le moment était solennel les blessés mêmes s'étaient tus; dans notre réduit nous ne bougions plus, nous attendions.
Joue feu dit le lieutenant; nous lâchâmes nos cinq coups de fusil, et, lui en tête, nous bondîmes en avant baïonnette au canon. Une formidable décharge nous accueillit, l'air trembla sous cet ouragan de fer et je crus que la terre allait s'entr'ouyrir.
A ce moment, le fusilier Cattau s'était jeté èn avant de son officier et l'avait pris dans ses bras pour lui faire un rempart de son corps; il tomba frappé de dix-neuf balles.
En dépit de ce dévouement, le lieutenant fut également atteint de deux balles, l'une au flanc droit, l'autre qui lui fracassa la cuisse droite.
Wensel était-tombé, lui aussi, le haut de l'épaule traversé, mais sans que l'os eût été touché il se releva aussitôt.
Nous étions trois encore debout Wensel, Constantin et moi. Un moment interdits à la vue du lieutenant renversé, nous nous apprêtions cependant à sauter par-dessus son corps et à charger de nouveau mais déjà les Mexicains nous entouraient de toutes parts et la pointe de leurs baïonnettes effleurait nos poitrines.
C'en était fait de nous; quand un homme de haute taille, aux traits distingués qui se trouvait au premier rang parmi les assaillants, reconnaissable à son képi et à sa petite tunique galonnée pour un officier supérieur, leur ordonna de s'arrêter et d'un brusque mouvement de son sabre releva les baïonnettes qui nous menaçaient : Rendez-vous nous dit-il.
Nous nous rendrons, répondis-je, si vous nous laissez nos armes et notre fourniment, et si vous vous engagez à faire relever et soigner notre lieutenant que voici là blessé.
L'officier consentit à tout, puis comme ces premiers mots avaient été échangés en espagnol Parlez-moi en français me dit-il, cela vaudra mieux sans quoi ces hommes vont vous prendre pour un Espagnol, ils voudront vous massacrer, et peut-être ne pourrai-je pas me faire obéir.
On reconnaît bien là cette haine inexpiable que gardent les Mexicains,et avec eux tous les colons de l'Amérique espagnole, contre la mère patrie juste retour de tant d'injustices et de cruautés commises pendant trois siècles dans ces belles contrée par lés successeurs de Pizarre et de Fernand Cortès.
Cependant l'officier parlait à l'un de ses hommes, il se retourna et me dit : Venez avec moi. Là-dessus il m'offrit le bras, donna l'autre à Wensel blessé, et se dirigea vers la maison; Constantin nous suivait de près.
Je jetai les yeux sur notre officier que nous laissions par derrière.
Soyez sans inquiétude, me dit-il, j'ai donné ordre pour qu'on prît soin de lui on va venir le chercher sur un brancard.
Vous-mêmes, comptez sur moi, il ne vous sera fait aucun mal.
Pour dire vrai, je m'attendais à être fusillé mais cela m'était indifférent je le lui dis.
Non,- non, reprit-il vivement,je suis là pour vous défendre.
Au moment même où, sortant du corps de logis, nous débouchions sur la route, toujours à son bras, un cavalier régulier fond sur nous avec de grands crié et lâche des deux mains sur Wensel et sur moi deux coups de pistolet sans mot dire, l'officier prend son revolver dans sa ceinture, ajuste froidement et casse la tête au misérable qui roule de la selle sur la chaussée; puis nous continuons notre route sans nous occuper autrement de lui.
Le colonel Cambas avait été élevé en France et parlait notre langue admirablement, militaire par occasion comme beaucoup de ceux qui nous combattaient et que l'amour de la liberté avait armés contre nous, il appartenait, ainsi que Milan, cette classe de Licenciados
qui comprend à elle seule presque tous les hommes les plus instruits et les plus influents du pays. Excellentes gens, l'un et l'autre, et qui eussent fait honneur même à une autre armée, car pour leurs soldats, je ne crois pas les calomnier beaucoup en disant que les trois quarts n'étaient que des bandits.
Nous étions arrivés ainsi dans un petit pli de terrain à quelque distance de l'hacienda, où se tenaient le colonel Milan et son état-major.
C'est là tout ce qu'il en reste ? demanda- t-il en nous apercevant; on lui répondit que oui, et, ne pouvant contenir sa surprise : Pero non son hombres, s'écria-t-il, son demonios. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons.
Puis s'adressant à nous en français : Vous avez soif, messieurs, sans doute.
J'ai déjà envoyé chercher de l'eau. Du reste ne craignez rien; nous avons déjà plusieurs de vos camarades que vous allez bientôt revoir; nous sommes des gens civilisés, quoi qu'on dise, et nous savons les égards qui se doivent à des prisonniers tels que vous.
On nous donna de l'eau et des tortillas, sortes- de crêpes de maïs dont le bas peuple au Mexique se sert comme de pain et sur lesquelles nous nous jetâmes avec avidité.
Au même moment arrivait le lieutenant Maudet, couché sur un brancard et entouré d'une nombreuse escorte de cavaliers d'autres blessés venaient après lui.
La nuit était tombée tout à coup sous les tropiques, le crépuscule n'existe point non plus que l'aurore, et le jour s'éteint comme il naît, presque sans transition.
En compagnie de nos vainqueurs, nous fîmes route vers leur campement de la Joya, où nous arrivâmes assez tard il y régnait une grande émotion, et les blessés encombraient tout. Là, malgré la parole du colonel Cambas, nos armes, qu'on nous avait laissées d'abord, nous. furent enlevées; il fallait s'y attendre, on nous réunit alors à nos camarades faits prisonniers avant nous. Épuisés par la fatigue et par la souffrance, noirs de poudre, de poussière et de sueur, les traits défaits, les yeux sanglants, nous n'avions plus figure humaine.Nos vêtements,nos chapeaux étaient criblés, percés à jour les miens pour leur part avaient reçu plus de quarante balles, mais par un bonheur inouï, durant cette longue lutte, je n'avais pas même été touché.
Comment en étions-nous sortis sains et saufs ? Nous ne le comprenions pas nous-mêmes, et les Mexicains pas davantage seulement le lendemain je me tâtais les membres, doutant encore si c'était bien moi et si j'étais réellement en vie.