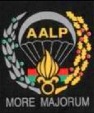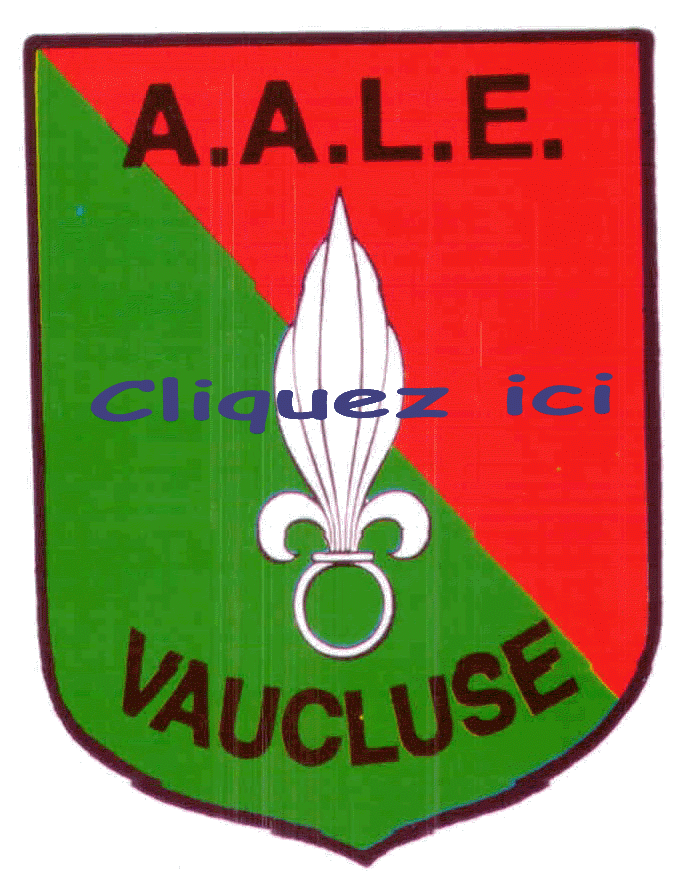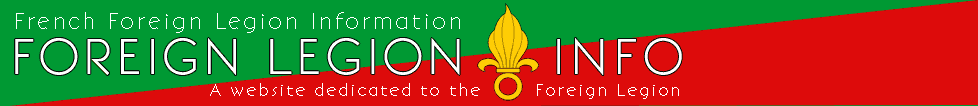mardi 19 novembre 2013
19 novembre 2013... Ceci commence sans vrai avertissement de ce qui va suivre, fortuitement, on dirait sans intention de nuire. Il s’agit d’un débat sur France 24, animé par une dame selon le standard de la chaîne, voix coupante, ton métallique et lèvres serrées, pas laide mais d’un agrément glacé, clone de Christine Ockrent qui a décidé que l’objectivité passe par l’arrogance froide et immuable accompagnant un discours d’un conformisme-Système de fer. Le sujet en est le risque que courent les journalistes reporteurs du temps de guerre, cela renvoyant aux deux journalistes français tués au Mali. On est le 5 novembre, dans le cours et le cœur du débat «Journalistes : comment travailler en zone de guerre».
L’un des journalistes-reporteurs de la chaîne, Mathieu Mabin, a belle allure ; Frédéric Mitterrand, entre deux sonneries de sa récréation (1), nous dirait qu’il est “beau gosse” et qu’il aimerait s’entretenir avec lui. Ce qui m’importe ici, moi qui écoutais le débat d’une oreille bien légère, c’est que j’entends Mabin dire : «J’ai rendez-vous avec...», puis être interrompu par la Christine Ockrent de circonstance. Comme il s’exprime à propos de ses sentiments lorsqu’il se trouve dans une “zone de combat“ et que les balles pleuvent autour de lui, je dresse l’oreille : Ce “J’ai rendez-vous avec...”-là ne m’est pas indifférent, et même il ne m’est pas inconnu si je ne me trompe ... Était-ce donc faire erreur ? C’était donc faire erreur, sans nul doute. Mabin tranche, reprenant sa phrase si injustement tranchée :
«J’ai rendez-vous avec mes enfants et mes petits-enfants...», poursuivant qu’il n’a qu’une idée, c’est de boucler son boulot syndicalement et rentrer vite fait chez lui, à l’abri des balles, en Bretagne. Je ressentis une profonde déception ; pourtant, quelle injustice de lui en vouloir pour cette réponse si naturelle, – qui n’en dirait autant, – et moi-même, d’une certaine façon, si j’étais dans ce cas ? Pourtant, non, ce «J’ai rendez-vous avec...» me reste dans l’esprit et dans l’âme, implacable et inexpugnable. Je sais aussitôt de quoi il s’agit, car ce verbe, cette expression ne forment qu’une seule référence possible pour moi.
***
Le titre, le thème et la répétition tragique du poème d’Alan Seeger est dans sa langue d’origine «I Have A Rendezvous With Death», qu’il est juste de traduire, je pense, par «J’ai rendez-vous avec la Mort». Cette phrase, commençant par ce sublime et tragique “J’ai rendez-vous avec...” qui m’avait arrêté chez Maubin, est attaché profondément en moi au souvenir et à l’évocation de Verdun. (2) Le poème de Seeger fait partie du legs symbolique de la grande bataille, bien que Seeger n’y ait pas participé et n’ait pas écrit précisément pour elle (il est mort sur la Somme le 4 juillet 1916). Il fait partie de ces œuvres sans rapport direct, et pourtant que vous entendez, lisez ou voyez, lorsqu’un documentaire ou un document concernant Verdun est réalisé ; des œuvres que la grande bataille a faites siennes parce qu’elle s’est reconnue en elles, comme autant de symboles, pour elle qui est le symbole des symboles de toutes les batailles de la Grande Guerre.
Ainsi, par exemple, du quatrième morceau de la Première Symphonie de Mahler, avec sa lenteur tragique et sa grandeur funèbre, qui rythme une longue prise de vue remontant presqu’en contre-plongée la perspective latérale du champ immense des milliers de tombes du cimetière de l’Ossuaire. Un autre poème de Verdun, également sans rapport avec Verdun, est celui de Péguy, en fait un quatrain rassemblé d’une façon assez curieuse et pour moi inexpliquée, à partir de vers tirés de deux quatrains différents de son immense poème Eve de 1913, et ces vers écrits comme par prémonition ...
«Mère voici vos fils qui se sont tant battus.
»Qu'ils ne soient point jugés sur leur seule misère.
»Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre
»Qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimée.»
***
Le poème de Seeger a fait l’objet de plusieurs traductions. Je dois avouer qu’aucune ne me satisfait pleinement, mais je parle de détails essentiellement ; mais aussi bien l’on sait que “le diable est dans le détail”, ou bien que “le bon Dieu est dans le détail” (versions anglaise et française de l’adage, qui reflète peut-être les génies très différents des deux nations). Il s’agit de détails de langue mais ils ont une forte valeur symbolique. (Le poème original et son interprétation se trouvent notamment vers ce lien et vers ce lien.)
Les première et dernière strophes disent ceci :
La première : «I have a rendezvous with Death/ At some disputed barricade, / When Spring comes back with rustling shade/ And apple-blossoms fill the air –»
La dernière : «But I’ve a rendezvous with Death/ At midnight in some flaming town, /
When Spring trips north again this year, / And I to my pledged word am true, / I shall not fail that rendezvous.»
Les traductions françaises (voir ce lien et ce lien notamment) sont nombreuses avec quelques nuances de peu d’importance. Toutes traduisent «I have a rendezvous with Death» par «J’ai un rendez-vous avec la Mort», alors que je préfère «J’ai rendez-vous avec la Mort». La dernière strophe est typiquement celle-ci :
«Mais j'ai un rendez-vous avec la Mort / A minuit, dans quelque ville en flammes, / Quand le printemps revient vers le nord cette année / Et je suis fidèle à ma parole, / Je ne manquerai pas ce rendez-vous.»
Et, pour ma part, je la préférerais sous cette forme :
«Mais j'ai rendez-vous avec la Mort
» A minuit, dans quelque ville en flammes,
» Quand le printemps revient vers le nord
»Et, fidèle à la parole donnée,
» Je ne manquerai pas ce rendez-vous.»
Le contraste est saisissant entre les douceurs de la vie de la jeunesse, symbolisées par les douceurs du printemps qui revient, qui s’attarde, qui vous enveloppe de ses douceurs infinies, celles de la nature comme celles de l’adolescence ; mais il y a ce rendez-vous avec la Mort et la parole donnée qui est une chose sacrée ... Et c’est sans amertume, sans désespoir, mais au contraire dans le sens des principes respectés comme celui qui est fondamental de la parole donnée, que le poète “fidèle à la parole donnée” ne manquera pas d’être présent à ce rendez-vous que la Mort lui donne. D’ailleurs, tout cela à ce moment où le printemps s’en sera venu d’une façon si paradoxale, comme l’on s’efface puisque l’heure est venue...
Il y a quelque chose de l’héroïsme pur dans cette attitude, où je ne vois ni fatalisme, ni même, encore, désespoir. Je ne sais si notre époque comprend encore cela, – et mon “je ne sais”, bien sûr, sera entendu comme une forme de style. La “parole donnée” est un acte humain, mais nullement “trop humain”, car accordé au fondement de la nature du monde et de l’espèce par conséquent, qui est le Principe. La “parole donnée”, c’est un acte humain et, finalement, un choix complètement justifié sinon juste ; c’est un acte humain lorsqu’on a la grandeur de vouloir dépasser cette condition ; c’est un acte humain accordé à la transcendance, c’est-à-dire le “pari pascalien” de la transcendance effectivement rencontrée. L’honneur de soi, c’est le respect de cette volonté tragique, et en un sens il grandit ce que cette mort-là (celle de Seeger) peut avoir d’absurde et de monstrueux ; dans cette Grande Guerre bien plus encore, qui est si absurde et monstrueuse à cause de la domination totalitaire de la technologie de guerre dans un moment où cette technologie est à un stade de blocage par la tuerie qu’elle est capable de déclencher et de maintenir ; dans cette Grande Guerre qui est la première crise fondamentale du “déchaînement de la Matière”.
Ce n’est en aucun cas le fait que Seeger repousse la vie et sa douceur, mais simplement que le temps du printemps est venu, a répandu ses charmes, puis a passé (dans le poème, la mention du printemps est triple, il arrive, il est présent, il revient comme on s’en va, cette graduation renvoyant à la considération grandissante du respect de la parole de l’honneur, du principe respecté). C’est là du pur héroïsme, notamment par la conscience exacte de la situation des engagements de l’être, par rapport aux variations de la nature du monde ; et, précisément dans le cas personnel, par ceci que le poète est aussi soldat dans un combat où la Mort ne cesse de fixer ses rendez-vous. C’est évidemment, par la puissance de l’essence qui l’habite, un poème prémonitoire, qui précéda de peu la mort de Seeger au combat. Cette prémonition fait de l’acte de l’acceptation de la Mort nullement un geste de fatalisme mais une volonté de respect de la Providence, comme l’on respecte la “parole donnée”. En juin 1915, il écrit à sa mère : «You must not be anxious about my not coming back. [...] But if I should not, you must be proud, like a Spartan mother, and feel that it is your contribution to the triumph of the cause whose righteousness you feel so keenly...»
***
Loin des déplorations sur l’“horreur de la guerre” et autres conventions affectionnées par nos commentateurs-Système, je vous dirais qu’Alan Seeger est un de ces destins qui m’émeuvent considérablement, qui me rendent de l’ardeur et de la confiance dans les choses, bref qui me donnent encore, paradoxalement comme certains jugeraient faussement, le goût de vivre. Sa carrière est courte, certes, pour la cause que l’on sait, mais c’est sans aucun doute un destin puissant dans le sens de la richesse de l’âme et de la hauteur du comportement. Seeger avait été à Harvard en même temps que T.S. Eliot, avec lequel il partageait son goût pour la poésie, puis à partir de 1912 il s’installa à Paris, au sein d’une colonie américaine d’écrivains et de poètes qui commençait à s’étoffer depuis l’installation d’Edith Wharton au 53 rue de Varenne. Il y vécut ce que l’on nomme “la vie de bohême” et y conçut une grande affection pour Paris et la France.
Ainsi expliqua-t-il son engagement dans la Légion Etrangère le 20 août 1914 : «To me the matter of supreme importance is not to be on the winning side, but on the side where my sympathies lie... Let it always be understood that I never took arms out of any hatred against Germany or the Germans, but purely out of love for France.» Ainsi composa-t-il son «Ode in Memory of the American Volunteers Fallen for France», ce poème d’une étrange prémonition continuée qu’il ne put aller lire en public à Paris pour le Memorial Day (30 mai 1916) comme il était prévu. Ainsi s’avère-t-il que ces mots écrits par lui à la gloire de quelques “morts américains pour la France” s’adressent également à lui-même et à sa propre gloire. (Quelques extraits de ce poème sont inscrits, en même temps que son nom parmi vingt-deux autres volontaires américains engagés dans la Légion Etrangère et morts pour la France, dans la pierre du monument de Victor Boucher inauguré par Raymond Poincaré, place des États-Unis, le 4 juillet 1923, qui était la date anniversaire de sa mort.)
« Hail, brothers! Goodbye to you, the exalted dead!
» To you, we owe two debts of gratitude forever:
» The glory of having died for France,
» And the homage due to you in our memories. »
Ainsi Alan Seeger ne connut-il jamais son neveu Pete Seeger, pacifiste comme son père le musicologue Charles Seeger qui, en 1916, l’année où son frère était tué, perdit son poste de professeur à l’université de Californie à cause de son opposition à l’entrée en guerre des USA. Pete Seeger devint le barde pacifiste et, bientôt, l’un des héros et des inspirateurs de la Beat Generation de Jack Kerouac et du protest song des années 1960. Ainsi un premier lien est-il noué entre la mort d’Alan Seeger et la Grande Guerre, et les prémisses de notre époque de grande crise de la civilisation.
***
Seeger ne connut pas non plus, bien sûr, John Kennedy, mais l’on découvre le lien, d’une subtile et tragique émotion d’un texte partagé. C’est un deuxième lien noué de Seeger avec notre époque, avec l’assassinat de Kennedy, et donc avec notre temps présent où le 50ème anniversaire de cet assassinat fait si grand bruit parce que l’événement de novembre 1963 à Dallas semble être devenu, enjambant ce demi-siècle, comme un grand coup du destin annonciateur de la phase décisive de cette grande crise que nous vivons aujourd’hui. «I have a rendezvous with Death» fut le poème préféré de Kennedy, qui éprouvait une étrange fascination pour la tragédie de la mort. James M. Douglass rapporte cet épisode dans ce livre qui vient d’être publié, avec ce titre parfaitement justifié et même, dirais-je, parfaitement juste, – JFK & l’Indicible. (3).
«Il récita “Rendez-vous“ à Jacqueline, la première nuit à Hyannis Port au retour de leur lune de miel, en 1953. Elle apprit le poème par cœur, et le lui récitait elle-même de temps en temps. A l’automne 1963, elle l’apprit à son tout à Caroline, leur fille, alors âgée de cinq ans. Le 5 octobre 1963, John Kennedy participait à une réunion avec le Conseil national de sécurité, à la roseraie de la Maison-Blanche. Caroline apparut soudain près de son père ; elle avait quelque chose à lui dire. Le Président tenta de détourner son attention, mais sa fille insista. Aussi se résolut-il à écouter ce qu’elle avait à lui dire. Tout le monde autour de la table en fit autant. Caroline regarda son père dans les yeux et [récita le poème en entier] :
»“J’ai [...] rendezvous avec la mort / A quelque baraque âprement disputée, / ”Quand le printemps revient avec son ombre frémissante, / Et quand l’air est rempli des fleurs de pommiers” [...]
»“... Mais j’ai rendez-vous avec la Mort/ A minuit, dans quelque ville en flammes, / Quand le printemps s’en va vers le nord / Et, fidèle à la parole donnée, / Je ne manquerai pas ce rendez-vous.
»les conseillers de la Sécurité nationale observèrent un silence stupéfié. L’un d’eux, décrivant la scène 30 ans plus tard, dira : “C’était comme s’il essayait d’enseigner une ‘musique intérieure’” à sa fille. Cette “musique intérieure” racontait son intimité avec la mort...»
Ainsi Alan Seeger affirmait-il l’universalité symbolique et intemporelle parce qu’au-delà du temps, de la poésie et de l’héroïsme. Il avait écrit «J’ai rendez-vous avec la Mort» aussi bien pour lui, dans une attaque d’un village de la Somme le 4 juillet 1916, que pour un président des États-Unis, installé dans une limousine décapotable, dans les rues de Dallas le 22 novembre 1963.
***
Le poème de Seeger «J’ai rendez-vous avec la mort» nous dit la grandeur tragique du destin de la Grande Guerre. Une petite fille récitant «I have a rendezvous with Death» à l’intention de son père nous restitue la grandeur tragique du destin de notre époque... Ce dernier point est essentiel à considérer dans ma conviction des choses et la perception qui la nourrit, parce que, pour ce domaine de la perception, le 50ème anniversaire est un véritable événement actuel, par les circonstances de l’assassinat, sa puissance symbolique qui a repris toute sa force, tout cela s’insérant dans la phase paroxystique de la crise générale de l’effondrement du Système que nous vivons présentement. Et, pour poursuivre l’idée, nous aurons bientôt le centenaire de la Grande Guerre.
Je veux dire qu’il y a un lien d’extrême communauté des choses et de l’esprit, qui abolit le temps, qui fait bon usage de l’Histoire, entre nous et l’assassinat de Dallas, et JFK et sa fille, et Alan Seeger et sa mort le 4 juillet 1916, et le “rendez-vous avec la Mort” qui est le messager de tout cela. Ce lien n’est pas tant celui de “la Mort” que celui de l’héroïsme dans l’affrontement de l’épreuve suprême ; et aussi, d’autre part, celui de la communauté de la crise que nous affrontons, car c’est la même crise qui a engendré la Grande Guerre, l’assassinat de Kennedy et notre situation actuelle. Ce qui importe dans cette courte évocation, ce ne sont pas tant les personnes, les situations, etc., que le lien tragique qui les unit et les met ensemble, et ce lien est certes le poème qui nous dit «I have a rendezvous with Death».
La substance même des mots, la puissance structurante de cette substance, conduit à créer une essence dans leur chef. Les mots («J’ai rendez-vous avec la mort») sont à la fois représentation de ce qui a existé et de ce qui existe, symbole de ce que nous ne distinguons pas nécessairement, créateur de situations qui éclairent la vérité du monde par ce qu’ils font naître chez ceux qui les lisent et les entendent. Dès lors qu’il est présenté dans toute sa puissance temporelle et toute son expansion spatiale, dans toute sa force de représentation et toute sa hauteur symbolique, le poème transmue la situation du monde et crée les conditions permettant d’appréhender la vérité du monde. Lecture faite et refaite, et toutes les implications réalisées, je ne suis plus le même, et l’avancement de ma perception et de ma réflexion s’est réalisé dans des domaines aussi différents en apparence que la mort assumée et acceptée du poète dans une bataille de la Grande Guerre, l’assassinat tortueux et terrible de ce président-là, notre situation présente de bouleversement, et le lien vital établi entre ces événements, leur connivence au-delà du temps, leur fatalité catastrophique, leur providence métahistorique.
Les mots portent ainsi l’essentiel de tout. Mis sous la forme de ce poème prémonitoire, avec la beauté de cette forme, ils charrient des émotions indescriptibles, décrivent le caractère héroïque de notre temps, confortent l’âme dans sa volonté de figurer dans son temps historique, ouvrent l’esprit à une meilleure compréhension de la situation du monde. Ils nous lient fermement au martyre d’Alan Seeger et au martyre de John Kennedy, et à notre propre martyre. Il suffit de bien entendre de quel “rendez-vous” il s’agit, – bien autant celui de l’héroïsme que celui de “la Mort”, – et, avec un naturel presque intemporel, “fidèle à la parole donnée”, de ne point y manquer.
Philippe Grasset
Notes
(1) La récréation (chez Robert Laffont, 2013), retrace les années de Frédéric Mitterrand au ministère de la Communication et la Culture de Sarkozy. Journal passionnant des us et coutumes d’un ministre chargé jusqu’à l’épuisement de la gestions des réseaux, jalouseries, courses au prébendes, explorations intéressée des gloires passées et à venir, etc., d’un domaine sans égal à cet égard ; journal passionnant d’un homme qui fit son métier en y croyant sans aucun doute sincèrement, mais avec une pensée politique réduite à ce domaine. Journal passionnant, certes, entrecoupé de constantes allusions à l’état “sociétal” de l’auteur, presque convulsivement, comme une sorte de réflexe pavlovien de la liberté homosexuelle enfin votée par l’Assemblée Nationale et qu’il est non seulement bienvenu selon les normes des salons, mais de bonne conformité d’afficher comme une vertu de la plus haute lignée ; drôle de libération, ou la liberté revue par Pavlov-gay... Il reste que, parfois, en le lisant, j’ai l’impression qu’il n’a pas vraiment changé, “Frédo”, depuis l’années scolaire 1963-64, en Philo 4, à Janson de Sailly, où il figurait comme un excellent élève, toujours placé au premier rang, attentif aux divers professeurs, d’un conformisme touchant et assez supportable avec ses allures primesautières. Il était en avance sur moi et par conséquent plus jeune et plus habile. (J’avais deux ou trois redoublements à mon actif, pirate “pied-noir” venu des côtes barbaresques de l’ex-Algérie française pour échouer à Janson, toujours placé au fond de la classe, près du radiateur, d’ailleurs autant par timidité que par goût de la chaleur subversive...)
(2) ... Chose si importante, Verdun, pour ce site, donc pour nous, et pour moi sans aucun doute. Je ne cesse de rappeler cet intérêt, voire cette passion, depuis exactement sept ans où la chose a pris sa place dans ma mémoire. Il en a été question déjà dans cette chronique, il y a exactement un an, le 19 novembre 2012. Je reprends la note que je mettais ce jour-là, en fin de ce texte du 19 novembre précédent, pour rappeler nos complicités verdunoises.
« Le premier texte sur Verdun, correspondant à notre découverte du lieu symbolique et du symbole initiatique pour nos conceptions fut mis en ligne le 24 novembre 2006. On trouve nombre de textes sur Verdun ou autour de la bataille, ou à propos d’elle et de la Grande Guerre, depuis cette date, par exemple le 22 septembre 2008, le 11 novembre 2008, le 11 juillet 2009, On a encore, très récemment, rappelé le rôle fondamental de Verdun dans notre évolution, avec ce que nous nommons “l’intuition de Verdun”, et sa part essentielle dans l’élaboration du concept de “déchaînement de la Matière, le 5 novembre 2012.
» Bien entendu, il faut mentionner le livre et album photo publié à l’occasion de nos divers déplacements, Les Âmes de Verdun. Récemment encore, un lecteur nous signalait (le 3 novembre 2012, – qu’il soit remercié à cette occasion), indirectement à son initiative, la parution d’un article sur le livre, ce 11 novembre 2012. Quant à nous, nous devons signaler avec une satisfaction presqu’étonnée que nous trouvâmes, lors de cette visite évoquée ici, dans plusieurs librairies des ouvrages et musées de la bataille de Verdun, Les Âmes de Verdun mises en évidence. Peut-être le centenaire de la Grande Guerre sera-t-il le temps venu pour que ce livre retrouve le public qui lui est dû. »
(3) JFK & l’Indicible, James W. Douglass, éditions Demi-Lune, septembre 2013. Cette publication donne en traduction française l’original de Douglass datant de 2009 (JFK & The Unspeakable, why he died and why it matters), marquant ainsi combien ce texte transcende les exigences de l’actualité. On reviendra sous peu, très rapidement, sur ce livre, mais il faut dire déjà que sa méthodologie, c’est-à-dire la façon dont il aborde son sujet pour lui donner toute sa signification, constituent une originalité singulière parmi l’immense bibliothèque consacrée à l’événement et à l’homme. (40.000 ouvrages traitant de JFK et de l’assassinat de Dallas, parus aux USA : «I have not counted, but somebody there said that 40,000 books have been written about our 35th president», selon Richard Reeves, le 15 novembre 2013 sur Truthdig.org.)
Une expérience assez étrange et revigorante c’est de lire, comme je l’ai fait, en même temps voire côte-à-côte, ce livre de Douglass et La récréation de Mitterrand (voir la note [1]). On en obtient une mesure également étrange et ironiquement revigorante de la différence entre la tragédie de l’histoire et la comédie du pouvoir qui prétendrait, notamment dans le domaine de la culture, être l’inspirateur ou le mécène de l’art et par conséquent de la dimension tragique qu’on devrait y trouver.