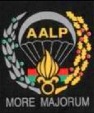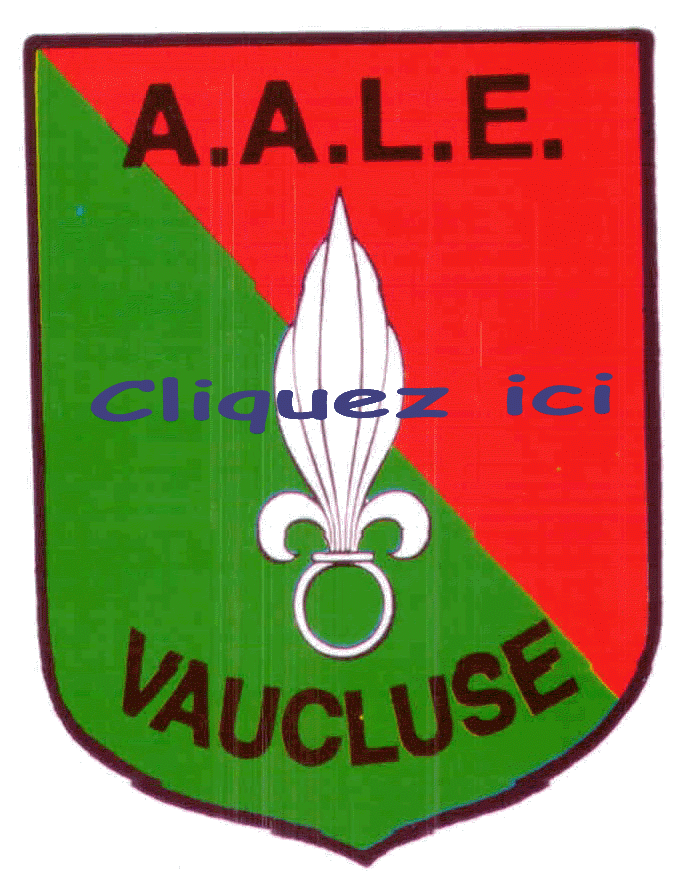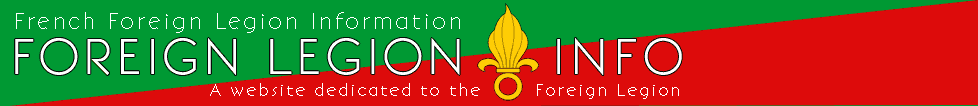![]()
Le 30/08/2014
Livres | Entretien étonnant avec l'écrivain, qui a utilisé la psychanalyse comme ferment de son œuvre. En témoigne “Le Monstre”, confession fleuve restée inédite durant quarante ans.

« Je suis un écrivain du XXe siècle, qui connaît l'extension de son nom, et du genre littéraire qu'il a lancé, au XXIe », dit avec douceur, avec étonnement presque, Serge Doubrovsky, en cet après-midi du mois d'août, assis dans un fauteuil, dans son appartement de l'Ouest parisien. Le Monstre, qu'il a écrit entre 1970 et 1977, et qui était demeuré à ce jour inédit, paraît ces jours-ci chez Grasset. Un livre hors norme (mille sept cents pages), écrit sous l'égide de Freud et de Proust, et où sa plume prend de saisissants accents céliniens. En 1977, l'écrivain en avait tiré Fils, considéré comme le livre fondateur de l'autofiction. Car c'est cela, le genre littéraire que Serge Doubrovsky a inventé et dans lequel s'inscrivent ses ouvrages les plus connus, du Livre brisé (1989) au testamentaire Un homme de passage (2011), en passant par L'Après-vivre (1994) et Laissé pour conte (1999). Son « invention » lui a valu naguère nombre de dénigrements – nombrilisme, a-t-on dit. Et même, à la fin des années 1980, une condamnation morale par une partie de la critique, l'accusant d'avoir poussé par ses écrits sa deuxième épouse au suicide – en fait, suicide ou accident, on ne sait pas. Rencontre avec un écrivain qui, à 86 ans, ne revendique rien – ni honneurs ni influence. Rien, si ce n'est « la langue française pour seule patrie ».
Vous souvenez-vous des circonstances de l'écriture de ce livre, Le Monstre, il y a plus de quarante ans ? De ce qui a tout déclenché ?
Sans hésiter : le phénomène de la perte. Déjà, dans mon premier livre personnel, La Dispersion (1969), qui n'est pas encore une autofiction mais un roman nourri de faits réels, je racontais l'histoire de ma rencontre avec une jeune femme tchèque et de notre rupture – j'ai écrit le roman pour surmonter cette séparation. Mais la mort de ma mère, en 1968, a été LA perte la plus grande de ma vie, qui ne s'est jamais totalement comblée, parce qu'elle était la perte de l'origine. Comme je n'arrivais pas à tenir le coup, je suis entré en analyse, à New York, où je vivais alors. Et j'ai fait huit ans d'analyse, en anglais, avec un psychanalyste américain. Il m'avait demandé : écrivez tous vos rêves. Ce que j'ai commencé à faire, en français – et un peu en anglais. L'écriture se situait, en quelque sorte, à l'intérieur de l'analyse.
Cela a duré sept ans, de 1970 à 1977 – j'écrivais tous les jours, de 9h30 à 13 heures, je n'ai jamais accompli un travail comparable de toute ma vie. Et cela a constitué une expérience fondamentale car, avant cela, je n'étais pas spécialement porté à l'introspection. Mais là, à force de fouiller l'intime en analyse… J'ai toujours cité à mes élèves ces mots de Freud que j'aime beaucoup, qu'il écrit dans une lettre à son ami Fliess : « Depuis que j'ai découvert l'inconscient, je me trouve beaucoup plus intéressant. » Cela m'est arrivé aussi. Ecrire a été un moyen de survie. Il ne s'agissait pas de m'épancher, de ressasser mon chagrin, mais d'essayer de comprendre qui j'étais et ce qui m'avait uni si fortement à ma mère. Les pages du Monstre contiennent tout ce qui vient à l'esprit d'un homme – d'un écrivain – qui vient de subir la plus grande perte de sa vie.
“Ce livre, je l'ai oublié,
comme on oublie
un travail de jeunesse.”
Pouvez-vous nous parler d'elle, de votre père ?
Mes parents étaient opposés en tout. Le père de ma mère était né dans un ghetto polonais, mais elle-même était une jeune fille née à Paris, d'une mère alsacienne, et qui avait dans sa bibliothèque toute la poésie française du XIXe siècle. Mon père, lui, était un Juif russe. Il était né en 1892 et, plus tard, avait fui la Russie pour ne pas servir dans l'armée du tsar. En France, il s'était engagé dans la légion étrangère, puis avait été naturalisé. Il parlait russe, mais sa langue maternelle était le yiddish. Il était arrivé en France avec des mœurs d'un autre pays, d'un autre temps. Ma mère n'avait pas connu d'hommes dans sa vie avant son mariage, en 1927. Et pour lui, le Russe/rustre, elle a été, dans un premier temps, une simple reproductrice. Une génisse. Cela, je l'ai compris en analyse. Plus tard, mon père s'est civilisé – ma sœur, de six ans ma cadette, me dit souvent que nous n'avons pas eu, elle et moi, les mêmes parents. Mon père avait changé, et s'il n'y avait pas eu la guerre, s'il n'était pas mort de la tuberculose juste après, je crois qu'ils auraient fini leurs jours heureux d'être ensemble… Quoi qu'il en soit, de toute ma vie, ma mère est la personne que j'ai le plus aimée.
Ce travail d'écriture entrepris après son décès, était-ce des notes à votre seul usage ou l'envisagiez-vous comme un livre ?
C'était un livre. Quand j'ai eu fini, j'ai adressé le manuscrit aux éditions Gallimard, et j'ai reçu en retour une lettre, très aimable d'ailleurs, m'expliquant qu'il était commercialement impubliable. J'étais d'accord, et je m'en suis désintéressé, tout en me disant qu'il fallait en faire autre chose. Alors, avec l'aide de mon ami Jean Paris, nous en avons extrait un livre, qui s'appelait Fils, et qui a été publié en 1977 chez Galilée.
Par la suite, le manuscrit s'est dispersé, entre Paris et New York, les deux villes entre lesquelles je vivais et voyageais sans cesse, en Angleterre où habitait ma sœur, qui m'avait demandé de lui envoyer les passages concernant notre mère afin qu'elle puisse les lire… Et voilà, ce livre, je l'ai oublié, comme on oublie un travail de jeunesse. Jusqu'à ce qu'une jeune critique généticienne, Isabelle Grell, qui s'intéresse à la genèse des textes, me demande de le lui confier. J'ai rassemblé tout ce que j'avais dans des cartons, à Paris, aux Etats-Unis, en Angleterre, elle a travaillé cinq ou six ans pour reconstituer le texte. L'idée de départ était qu'il soit accessible sur le site Internet de mon éditeur, Grasset. Qui a décidé finalement de le faire paraître en papier.
“Ce n'est pas du tout
un récit autobiographique traditionnel,
il y a une folie dans ce texte.”
Vous ne l'aviez jamais relu ?
Non, je suis en train de le faire. Pour moi, c'est le livre d'un autre. Un type qui a quarante ans de moins que moi, une autre gueule, une autre vie que la mienne. J'étais très anxieux au début : si ce texte s'avérait être une simple bêtise de jeunesse, c'était embêtant de le publier, qui plus est comme mon dernier livre. En fait, en le relisant, je suis frappé par sa construction – c'est comme si une seule phrase courait sur deux mille cinq cents feuillets –, par sa puissance verbale, l'absence de ponctuation, la richesse du vocabulaire. Je suis obligé de le lire avec des dictionnaires à mes côtés, comme si je connaissais le français cent fois mieux il y a quarante ans que maintenant !
En fait, je m'aperçois en me relisant que l'analyse a non seulement déclenché une recherche vers la compréhension de soi, mais aussi une manière particulière d'écrire. Quand j'écris un article de critique, ou une lettre à des amis, j'ai une syntaxe tout à fait normale. Le Monstre, c'est plutôt comme une longue succession d'idées qui passent par la tête d'un type. En analyse, on laisse les pensées s'accrocher les unes aux autres – là, j'ai laissé les mots s'accrocher les uns aux autres, jouer et s'accoupler entre eux. Ce n'est pas du tout un récit autobiographique traditionnel, il y a une folie dans ce texte. Et aussi quantité de défauts : il est trop long, il se répète, il est extravagant… Mais je le signe avec plaisir.
Vous parvenez à vous lire comme si vous n'étiez pas l'auteur du texte ?
C'est moi, et c'est un autre ; c'est moi, et ce n'est plus moi. C'est les deux à la fois. Je lis, je prends des notes. Je me dis parfois : tiens, ce qu'il écrit là, ce n'est pas bête – c'est alors le professeur en moi qui s'exprime. Disons que je le lis à la fois objectivement et subjectivement.
“Les années 1940-1944 sont les plus marquantes
de ma vie. L'écriture a été un moyen d'essayer,
non pas d'oublier, mais d'intégrer cela.”
C'est une sorte de dédoublement de la personnalité ?
J'ai vécu sous le signe de la division. A ma naissance, j'avais deux prénoms : Julien, du nom d'un cousin de ma mère qu'elle aimait beaucoup, mort aux Dardanelles, et Serge, pour faire plaisir à mon père, car cela sonnait plus russe. Ces deux prénoms se sont partagé ma vie : pour les miens, pour mon banquier et pour mes médecins, je suis Julien Doubrovsky, et pour mon éditeur, je suis Serge Doubrovsky.
Toute mon existence a été ainsi divisée. Entre Julien et Serge, donc. Entre l'enseignement et l'écriture. Entre la France et les Etats-Unis, où je me suis installé au milieu des années 1960. Entre la langue française, dans laquelle je donnais mes cours à la New York University, et l'anglais, que je parlais en famille ou dans la vie sociale – j'étais marié à une Américaine et, avec nos deux filles, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé qu'en anglais. Entre New York et Paris, où j'ai vécu alternativement chaque année, de 1970 à 2006, après que NYU m'avait proposé d'enseigner un an sur deux dans sa succursale parisienne. C'est vraiment une double vie qui s'est installée alors, avec parfois, évidemment, une femme sur un continent, une seconde femme sur l'autre… Je dirais même qu'au plus profond de moi, je suis un Juif non juif : adolescent, j'ai porté l'étoile jaune et échappé par miracle à la déportation, mais en même temps je suis absolument athée, je n'ai rien à voir avec la religion juive.
C'est durant l'Occupation que vous avez commencé à écrire ?
Oui. Déjà alors l'écriture était liée pour moi à la survie. Nous habitions Le Vésinet, dans une maison qui avait appartenu à mon grand-père. Le 3 novembre 1943, à l'aube, on a sonné à la porte, c'était un gendarme à vélo venu prévenir mon père : « Dans une heure, je viens vous arrêter. » Heureusement, nous savions où nous réfugier, chez une tante, alors nous avons fait nos valises en hâte et nous sommes partis pour Villiers-sur-Marne. Là, je suis resté caché près de dix mois, sans sortir de ma chambre. Une fois que j'ai eu lu tous les livres qu'il y avait dans la maison, j'ai commencé à écrire, dans le cahier de comptes de mon père. En un certain sens, je peux dire que je suis un écrivain de l'an 40 : les années 1940-1944 sont les plus marquantes de ma vie. Dans chacun de mes livres, je crois, j'y ai fait allusion. L'écriture a été un moyen d'essayer, non pas d'oublier, mais d'intégrer cela.
“Avec l'autofiction, on est dans
l'ère postmoderne – la déconstruction
des textes, la brisure, la cassure du récit.”
Vous y revenez dans Le Monstre. Au fait, pourquoi ce titre ?
Il y a au moins dix raisons, dix sens différents. Pour commencer, c'est le livre, son épaisseur, sa forme. C'est aussi moi, et les sentiments monstrueux qui ont pu m'habiter, toutes mes laideurs – parce qu'un individu, ce n'est pas que beau à voir… Cela renvoie encore à un de mes rêves que je raconte, et qui figure aussi dans Fils, autour du monstre marin du récit de Théramène, dans le Phèdre de Racine. Et le terme « monstre » est aussi lié au projet même d'écrire de l'autofiction, car il vient du latin monstrum : montrer, exhiber. Le Monstre est, je crois, celui de mes textes qui va le plus loin dans le dévoilement de soi, du plus intime – dans mes relations avec mes parents, ma sœur, avec la France et l'Amérique. Beaucoup plus que Fils, Le Monstre est le fondement conscient et détaillé de l'autofiction, le livre qui invente cette notion et ce genre, et qui en développe même la théorie – parce qu'il y a aussi un prof qui l'écrit, et pas seulement un fils éploré.
L'écrivain et le professeur en vous ont-ils la même définition de l'autofiction ?
L'écrivain l'a inventée, poétiquement, et le professeur et critique, que je suis aussi, lui a donné une définition plus précise. Celle qu'on propose toujours, depuis Fils, c'est : « une fiction d'événements et de faits strictement réels ». Une des formulations à laquelle je me tiens aujourd'hui, c'est « un récit dont la matière est entièrement autobiographique, la manière entièrement fictionnelle ». Il ne s'agit pas de raconter ma vie telle qu'elle s'est déroulée, mais selon la façon dont les idées me viennent. C'est-à-dire de manière non linéaire, et même disloquée.
C'est notamment en cela que je me suis éloigné des écrivains du Nouveau Roman, qui ont été des amis personnels – Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute et les autres, que j'aime en tant que personnes et que je respecte en tant qu'écrivains. Avec l'autofiction et le succès qu'a rencontré le genre, on a changé d'époque : on n'est plus dans le Nouveau Roman, mais plutôt avec Derrida, dans l'ère postmoderne – la déconstruction des textes, la brisure, la cassure du récit. Le récit de ma vie, je le disloque, je le déconstruis, pour en faire sortir ce qu'il peut y avoir d'intéressant.
L'autofiction, est-ce donc « moi envisagé comme un autre » ?
L'autofiction, c'est comme le rêve : un rêve n'est pas la vie, un livre n'est pas la vie. Comme disait Sartre, vivre ou raconter, on ne peut pas faire les deux en même temps. En écrivant Le Monstre, j'étais bien conscient que ce que j'offrais, c'était le rêve de ma vie. Dans notre appréhension de la réalité, il y a toujours une part de fiction. Et, comme dit Jules Renard dans son Journal, dès que quelqu'un parle de soi, au bout de dix minutes, c'est du roman…
“Je n'ai jamais prétendu donner une formule
à suivre pour d'autres écrivains,
ni cherché à avoir des disciples.”
Sans remonter à Montaigne, on peut dire que l'autofiction existait déjà…
Elle existait avant moi. Simplement, je lui ai donné un nom et je l'ai conceptualisée. L'année de ma naissance, en 1928, est paru Naissance du jour, de Colette, et il s'agissait d'une sorte d'autofiction. Quand André Breton écrit Nadja, c'est aussi le cas. Et encore quand Céline donne D'un château l'autre et ses livres suivants. Ou Joyce quand il écrit Portrait de l'artiste en jeune homme. L'autofiction était pratiquée, mais n'était pas conçue comme un genre. C'était plutôt vu comme des accidents littéraires, dans la vie et la bibliographie d'auteurs dont le reste de l'œuvre était souvent très différent.
Cela dit, je n'ai jamais prétendu donner une formule à suivre pour d'autres écrivains, ni cherché à avoir des disciples. Pourquoi la mort de ma mère a-t-elle produit un texte comme Le Monstre et pas de la poésie lyrique ou du roman ? Cela reste un mystère. Et en définissant l'autofiction, j'ai juste essayé de comprendre, moi, ce que je faisais. L'immense surprise que j'ai eue, depuis le début du XXIe siècle, c'est de voir le mot et la pratique se répandre dans toutes les langues. Au Brésil, en Afrique, en Iran… partout.
Comment expliquer ce succès ?
Ce n'est pas de ma compétence, mais de celle des sociologues ou des historiens. Et c'est différent selon les cultures. En Inde, ou en Afrique, l'autofiction apparaît comme révolutionnaire, car c'est un peu la découverte de l'existence possible de l'individu hors du groupe – le village, le clan, etc. En Occident, l'implantation de l'autofiction est plutôt liée à la perte d'influence des grands récits fondateurs : le récit chrétien, le récit marxiste, tout cela s'est délité, et l'individu est renvoyé à la petite chose qu'il est, à la petite vie qui est la sienne – comment essayer de la comprendre, de la relier au reste de la société et à l'Histoire ?
Car, contrairement à ce qu'affirment encore certains, les œuvres d'autofiction ne sont pas nombrilistes ou narcissiques. Ce sont des oeuvres par lesquelles des histoires individuelles s'inscrivent dans l'Histoire. Personnellement, je ne peux pas m'analyser sans découvrir à quel point je ne suis que le produit d'une époque. Mon père était de Tchernigoff, en Ukraine, dans la Russie tsariste que les Juifs, à la fin du XIXe siècle, ont fuie, car ils ne voulaient plus servir dans l'armée du tsar – c'est un fait historique. Ma mère est née en 1898, elle a atteint l'âge adulte alors que les trois quarts des hommes de son âge étaient morts durant la Grande Guerre – c'est encore un fait historique. Ma mère avait décidé que je devais être écrivain, parce que, jeune fille, elle avait été très amoureuse d'un jeune normalien qui s'essayait à l'écriture et qui est tombé au champ d'honneur en 1915.
Comment voyez-vous la postérité de l'autofiction – et la vôtre ?
Au XXe siècle, j'ai reçu des insultes, des injures, j'ai été démoli par les critiques. Et au XXIe siècle, j'ai vu se développer l'autofiction de façon incroyable. Mais je sais que ce n'est qu'un mouvement, un jour viendra où les écrivains passeront à autre chose. Moi, descendant d'illettrés, je suis heureux d'avoir trouvé un mot qui puisse servir à la culture contemporaine du XXIe siècle, j'ai accompli ma tâche. Même si ce qui compte vraiment, ce n'est pas de rester dans l'Histoire en tant que « pape de l'autofiction » mais, plutôt, qu'en lisant un de mes livres on continue longtemps à en être touché.
Photo Manuel Braun pour Télérama