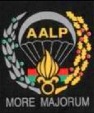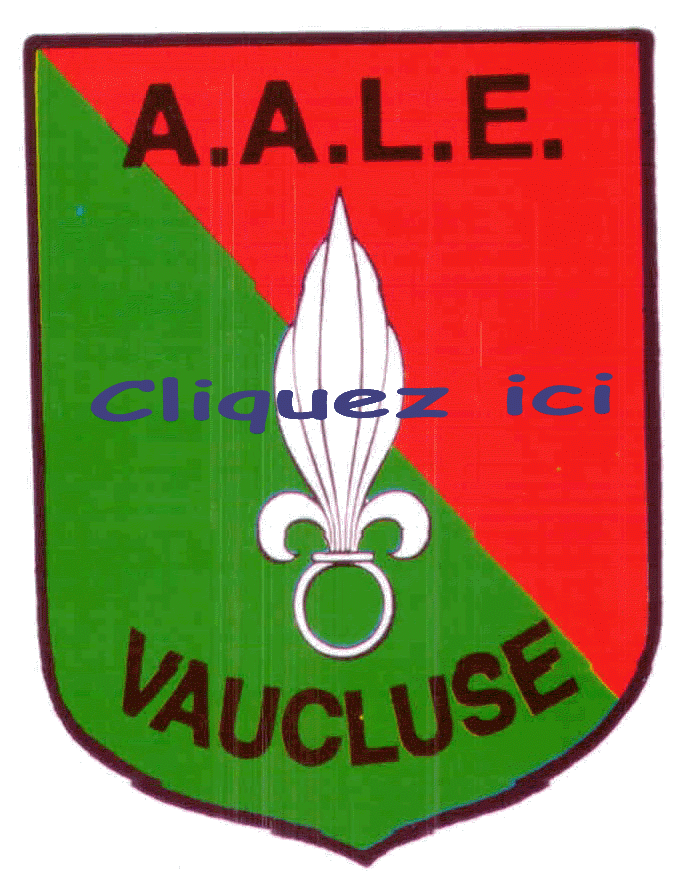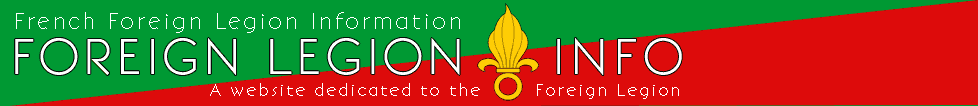29/01/2008
Depuis la disparition, dimanche dernier, de Louis de Cazenave, Lazare Ponticelli, 110 ans, est le dernier survivant. Né italien, doyen des Légionnaires, résistant, il incarne désormais les 8,5 millions de soldats français engagés dans la Grande Guerre.
La cadence sèche de sa mitrailleuse et les cris des blessés résonnent toujours dans sa tête. Lazare Ponticelli n'a rien oublié de la Grande Guerre. Ni les combats qu'il a menés, ni les camarades qui sont tombés. Dernier survivant des poilus, il a 110 ans. Pourtant, dans ses yeux aujourd'hui presque aveugles, brille encore le regard de l'enfant qu'il fut. Ceux de ce gamin sans le sou qui avait les pieds nus et la rage de vivre. Ceux aussi de cet émigré italien prêt à tout pour garder la tête haute et dont la vie entière est à l'image d'un siècle de fer, de sang et d'espoir infini. Depuis son plus jeune âge, il a combattu. La pauvreté et la faim d'abord, puis sur le front et dans les tranchées. Dans les ateliers et sur les échafaudages. Avec les FFI pendant la Libération de Paris. Toujours, il a tenu bon.
A Bettola, petite commune d'Emilie-Romagne, dans le nord de l'Italie, où il naît le 7 décembre 1897, Lazare Ponticelli n'a connu que la misère. Son père travaille sur les foires comme maquignon, tandis que sa mère s'occupe des enfants et exploite un petit bout de terrain. Mais les affaires sont difficiles et l'argent ne rentre pas tous les jours. Souvent, avec ses frères et soeurs, il se couche le ventre vide ou se contente d'une maigre soupe. A Bettola, on est dur au mal. On serre les dents en silence en espérant que la chance va enfin tourner. Mais le sort s'acharne. Faute de pouvoir payer le médecin, son frère aîné est emporté par la maladie. Puis son père meurt brutalement.
Sa famille prend alors le chemin de l'exil, vers la France où ses frères pensent trouver du travail. Livré à lui-même, Lazare reste seul, car l'argent manque pour payer son voyage. En attendant, il devient berger et économise le moindre sou, jusqu'à ce qu'il puisse acheter son billet de train pour Paris. Un matin, les chaussures autour du cou, pour ne pas les abîmer, il quitte enfin l'Italie. Sans regrets. Il a tout juste 9 ans quand il débarque à la gare de Lyon. Trois jours et deux nuits, l'enfant erre sous ses hautes verrières, dormant sur un banc, jusqu'à ce qu'un commissionnaire le remarque et lui demande ce qu'il fait là. Lazare, qui ne comprend pas le français, ne fait que répéter le nom et l'adresse d'un bistrotier dont on lui a parlé avant son départ. Par chance, le cheminot connaît l'endroit et l'y conduit. Très vite, l'épouse du cafetier le prend sous son aile. Il y reste pendant huit mois, rendant de menus services aux commerçants du quartier.
En 1908, Lazare a 10 ans et quitte Paris pour rejoindre ses frères, Céleste et Bonfils, dont il a retrouvé la trace à Nogent-sur-Marne, là où de nombreux Italiens ont posé leur sac. Les premiers mois sont difficiles et les retrouvailles, houleuses. Il enchaîne les petits boulots et couche parfois dehors. Mais rien ne l'arrête. Lazare est tour à tour livreur de charbon, ramoneur, puis crieur de journaux. En mars 1913, avec un ami, il lance une entreprise de ramonage. Les affaires démarrent plutôt bien, mais, en août 1914, son monde s'écroule. La France mobilise contre l'Allemagne. La guerre est déclarée. Il n'y a plus de travail. Par milliers, les Italiens rentrent chez eux. A Nogent, on exhorte Lazare à partir et à regagner Bettola. C'est mal le connaître.
Bille en tête, il se présente à la caserne du boulevard Richard-Lenoir et s'engage pour la durée de la guerre dans le premier régiment de marche de la Légion étrangère. Il n'a que 16 ans et a triché sur son âge. « J'ai voulu défendre la France parce qu'elle m'avait donné à manger, explique- t-il en levant la tête. C'était ma manière de dire merci. »
Engagé volontaire à 16 ans
Dans la file des volontaires, il retrouve son frère Céleste. Comme des centaines de jeunes recrues, ils rejoignent Nîmes puis Avignon. Un mois d'instruction plus tard, l'armée estime qu'ils sont prêts pour le front. Fiers de leur nouvel uniforme, les deux hommes font les bravaches. C'est vrai qu'ils ont de l'allure, avec leur pantalon garance, leur vareuse bleue et le képi légèrement de travers. A l'épaule, leur fusil Lebel pèse d'un poids rassurant. Avec une telle arme, les Boches n'ont qu'à bien se tenir ! Lazare bout d'impatience. Mais au fond, ni l'un ni l'autre ne savent vraiment ce qui les attend.
C'est vers Soissons qu'ils reçoivent leur baptême du feu et découvrent la guerre. Les premiers mois sont les plus meurtriers et la Légion est de tous les coups durs. Céleste est blessé puis évacué. « Au début, nous savions à peine nous battre et nous n'avions presque pas de munitions, raconte-t-il. Nous creusions sans cesse. D'abord des fosses pour enterrer les morts, puis des sapes et des tranchées. On avait la peur au ventre. Parfois on se dévisageait en silence, en se demandant lequel d'entre nous ne reviendrait pas. En Argonne, sur la cote 707, j'ai secouru un type qui avait perdu sa jambe. Il hurlait de douleur pendant que je le traînais jusqu'à notre tranchée. En face, les Allemands nous tiraient dessus. Avant que les infirmiers ne se précipitent sur lui pour le soigner et l'évacuer, il a voulu me serrer dans ses bras en me disant : "Merci pour mes quatre enfants." Je ne sais pas ce qu'il est devenu. »
La guerre l'emporte. A Verdun, il fait partie des hommes chargés de reprendre le fort de Douaumont. L'artillerie allemande pilonne sans relâche. Les pertes sont énormes. Lazare survit. En mai 1915, tout bascule. L'Italie vient d'entrer en guerre contre l'Autriche-Hongrie. Conformément aux accords signés entre les deux pays, la France démobilise les Italiens engagés dans son armée. Le soldat Ponticelli doit quitter la Légion, écoeuré.
« Je ne voulais pas partir de mon bataillon et laisser mes camarades. La Légion avait fait de moi un Français, explique le vieil homme. C'était profondément injuste. » Rendu à la vie civile, Lazare retourne à Paris et tente de se rengager dans l'armée française. En vain. Il pense qu'on l'a oublié quand deux gendarmes, un peu gênés, viennent l'arrêter et le conduisent de force à Turin, où il est incorporé à la 159e compagnie de mitrailleuses du 3e régiment d'Alpini, les chasseurs alpins italiens.
A nouveau, les combats s'enchaînent. Dans le fracas des tirs et des explosions, la douleur et le murmure des prières. Puis un matin, à Pal Piccolo, en pleine montagne, le silence. Timidement, on se fait signe de part et d'autre des tranchées. Des mains se tendent, offrent des cigarettes ou un morceau de pain. « Cela faisait des semaines que l'on vivait à quelques mètres les uns des autres, se souvient Lazare. Si près qu'on entendait les conversations. Dans ma section, les trois quarts des hommes étaient des Italiens germanophones. L'"ennemi" était souvent le voisin d'en face. Alors est arrivé ce qui devait arriver : on a fraternisé. » L'état-major ne leur pardonnera pas. Les hommes passent en conseil de guerre et sont envoyés en Slovénie, sur le Monte Cucco, face à une compagnie d'élite autrichienne qui engage aussitôt le combat.
Deux jours durant, Lazare repousse les assauts ennemis derrière sa mitrailleuse. Il est blessé au visage, mais il continue à tirer. « Le sang me coulait dans les yeux. Je me suis dit que, si je m'arrêtais, j'étais mort. Alors, malgré ma blessure, j'ai continué à presser la détente comme un automate. Et tout à coup, les Autrichiens sont sortis, ils agitaient des chiffons blancs... C'était fini. Nous avons fait 200 prisonniers. Puis j'ai été évacué. »
Il se réveille à Naples dans un hôpital militaire, une médaille agrafée sur la poitrine. Mais la guerre n'est pas finie. Lazare remonte en ligne au cours de l'année 1918. Cette fois, partout sur le front, les Autrichiens reculent. « Puis, alors que le bataillon se préparait à monter à l'attaque, on a appris la signature de l'armistice. Fallait voir ça ! C'était incroyable ! On s'est embrassés, Italiens et Autrichiens ensemble. Nous étions fous de joie ! » Il s'y revoit et sourit en silence.
Mais son enthousiasme est de courte durée. Le 3e régiment d'Alpini n'est pas démobilisé et participe à des missions de sécurité intérieure. Lazare doit attendre 1920 pour être libéré. Mais un autre problème l'attend. S'il est dégagé des obligations militaires en tant qu'ancien combattant italien, il lui sera très difficile d'obtenir des papiers pour rentrer à Paris.
Déterminé, l'ancien légionnaire fait alors le siège du consulat de France à Milan où l'on traîne des pieds pour le recevoir. Tant pis. Il attend. « Finalement, s'amuse-t-il, j'ai réussi à montrer mon livret militaire de 1914 que j'avais précieusement gardé. On m'a alors reconnu en tant que soldat français et libéré en tant que tel. »
De retour en France, Lazare veut oublier la guerre. Avec ses deux frères, il se spécialise dans le montage et le démontage de cheminées. En 1921, ils créent ensemble Ponticelli Frères, une société de fumisterie. Les chantiers se succèdent. Au cours de l'été 1923, Lazare se marie avec Clara, une Française, qui lui donne trois enfants. Dans les années 30, l'entreprise prend de l'essor et se diversifie dans l'industrie pétrolière. Le Rital illettré de Bettola a pris sa revanche.
En 1939, les trois frères obtiennent la nationalité française. C'est la prospérité. Mais une nouvelle guerre éclate, et la France mobilise à nouveau. L'enthousiasme n'est pas le même qu'en 1914 et le pays se prépare au combat les tripes nouées. En 1940, la défaite de l'armée française et l'exode le conduisent en zone libre avec sa famille. Mais l'inactivité lui pèse. Fin 1942, il rejoint la Résistance, détourne des wagons d'obus destinés à l'Allemagne et participe à la libération de Paris avec les FFI.
La paix revenue, Lazare décroche de nouveaux contrats, et sa société ne cesse de grandir. Quand il prend sa retraite, au début des années 60, Ponticelli Frères est en passe de devenir la multinationale aux 2 000 salariés qu'elle est aujourd'hui.
Avec le temps, les souvenirs de la Première Guerre mondiale sont revenus le hanter. Dans sa maison du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), où il vit avec sa fille, ses nombreux visiteurs ne lui parlent que d'explosions et de batailles. Lazare les écoute et raconte avec passion. Puis savoure le calme revenu, gère son portefeuille boursier avec passion et reçoit les siens. En décembre 2007, il a fêté son cent dixième anniversaire à la Cité de l'immigration. Un symbole fort, pour cet Italien qui a tout fait pour être français. Dernier des poilus, Lazare Ponticelli ne s'est pas décidé à accepter des funérailles nationales - un refus toutefois nuancé par sa famille -, comme Jacques Chirac l'avait promis en 2005. Mais tant que sa force le lui permettra, il s'est juré de témoigner. Et chaque 11 novembre, on peut voir sa frêle silhouette s'incliner devant le monument aux morts de sa commune. « Je leur dois bien cela, dit-il soudain ému. Si je suis là, c'est aussi grâce à eux. » Leur rendre hommage est son dernier combat.
Cyril Hofstein