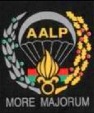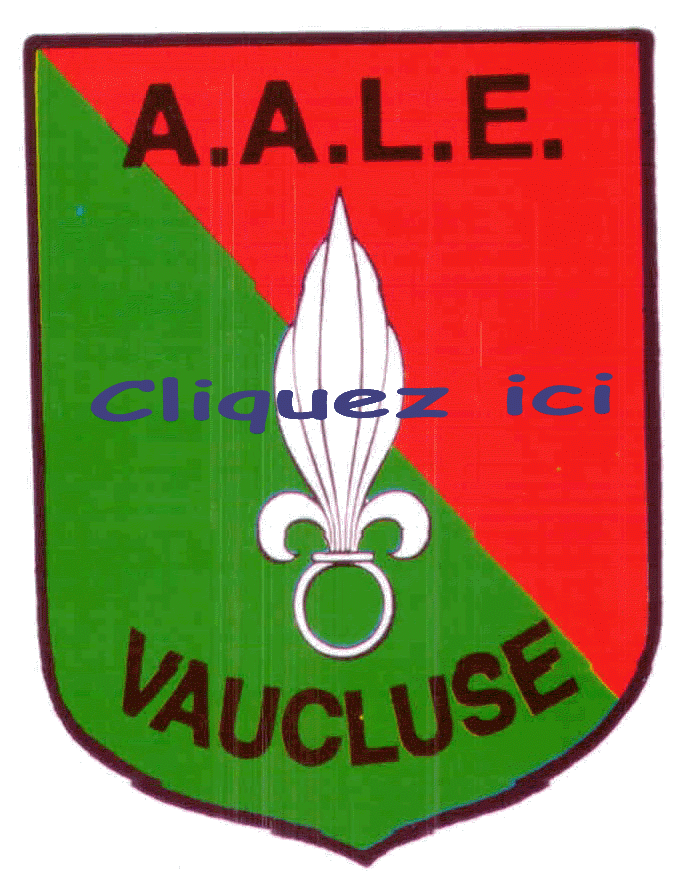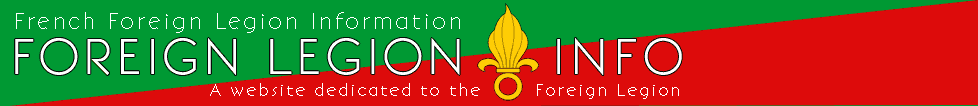14 novembre 2013
Paulina Dalmayer est une journaliste d’origine polonaise. Après avoir passé de nombreux mois en Afghanistan entre guerre et non-guerre, elle revient en France avec un premier roman intitulé « Aime la guerre ! ». L’occasion de prendre un café, bien au chaud dans notre confort occidental, afin de parler de la légitimité du mot « guerre », de la situation qu’elle a vécue dans le froid afghan et de littérature, évidemment. Entretien sans filtre.
Avant de commencer notre entretien, Paulina Dalmayer, je voulais te demander si tu as coupé certains passages de ton livre. Livre qui comporte tout de même 590 pages (!)…
Paulina Dalmayer : Pas vraiment. À vrai dire j’ai coupé seulement une scène, sur la suggestion d’Elizabeth Samama. Sinon il n’y a pas eu de coupe. Il y avait un travail très minutieux sur certains mots, ça oui. Mais pas de coupes de scènes.
Tu penses qu’on peut aimer la guerre ?
Oui, bien sûr. Mais je ne crois pas que ce soit lié à une époque donnée. C’est lié à un état d’esprit de gens qui font la guerre et même de gens qui vivent dans des états et des pays en guerre. Interroge n’importe quel militaire, n’importe quel rebelle qui a été à un moment au combat, ce sont toujours les meilleurs moments de leur vie. Interroge quelqu’un qui est parti quelques mois en Afghanistan, ou des Américains qui ont été envoyés en Irak, ils ont beau avoir été traumatisés, avoir perdu un bras ou une jambe, c’est toujours le meilleur moment de leur vie. J’ai un ami très proche qui était légionnaire. Il a passé trois ans dans la légion, par le biais de laquelle il a été envoyé en Afrique. Ce monsieur a maintenant 75 ans et on pourrait avoir l’impression que ses 75 ans se résument à ces trois années passées dans la légion. C’est l’expérience qui est sans doute la plus forte dans la vie humaine.
En filigrane de ton livre, on dirait que cette guerre n’est pas vraiment une guerre, mais que ç’en est quand même une parce qu’on lui a donné ce nom. Qu’est-ce qui détermine, pour toi, qu’une guerre en soit véritablement une ?
C’est une question très drôle. J’en ai discuté avec mon ami qui n’est personne d’autre que l’ambassadeur de Pologne en Afghanistan. Auparavant, il était conseiller militaire de l’ambassade de Pologne en Irak. C’est un militaire de carrière, il a vécu. Il est passé par cette aventure irakienne à laquelle les Français n’ont pas participé. Les Polonais étaient quand même la troisième force d’occupation en Irak. Nous étions assis, comma ça, dans un jardin à Kaboul et je luis dis « Écoute Piotr, c’est une guerre ou ce n’en est pas une, en fait ? » Et là il me répond « Mais non, mais non ce n’est pas une guerre. – Comment peux-tu savoir que ce n’est pas une guerre ? – C’est très simple, Paulina : il n’y a pas de bombardements. Ça veut donc dire que ce n’est pas une guerre ». Et je me suis dit « c’est peut-être vrai ». Je n’ai jamais véritablement connu le pays sous les bombardements. En fait si, un peu en Libye où les journalistes ont été complètement écartés du terrain. Quand tu lis par exemple « Chienne de guerre : une femme reporter en Tchétchénie », d’Anne Nivat, persiste en effet dans les phénomènes des bombardements quelque chose de si terrifiant que c’est déterminant pour pouvoir dire si c’est véritablement une guerre. Je ne suis pas sûre, par exemple, que ce qui se passe au Mexique actuellement ne soit pas pire que ce qui se passe en Afghanistan. Mais bon, on ne bombarde pas le Mexique. Peut-être que l’Afghanistan est aussi coupé entre deux zones qui sont et ne sont pas en guerre.
Peut-on imaginer une classification de « guerre » au-delà d’un certain seuil de morts ?
Non, je ne crois pas. Parce que le cas mexicain contredit cela ; ce qui se passe en Somalie également ; là-bas c’est un conflit extrême, d’une violence rare. S’il y a un seul pays au monde où je ne voudrais pas mettre les pieds par peur, c’est bien la Somalie. Et pourtant, ce n’est pas véritablement une guerre.
Est-ce que la morale de ton livre, s’il doit y en avoir une, n’est pas que « chacun mène sa propre guerre » ?
Oui, bien sûr. Il y a Hanna qui fait sa guerre à la fois pour pouvoir aimer et pour extraire d’elle l’amour. D’autre part, Robert bataille pour s’adapter à une vie plus normale, qui puisse l’aider à aimer et vivre avec quelqu’un. Bastien bataille à la fois pour oublier et préserver son indépendance et sa liberté et en même temps pour s’adapter à la vie avec quelqu’un, ce qui lui est impossible.
À quel moment tu t’es dit : « il faut que je raconte cette aventure dans un livre » ?
Au moment où j’ai signé le contrat. Presque.
Ton livre est écrit d’une manière très journalistique. Pourquoi ?
Je m’insurge, et c’est là où je te rejoins, contre les livres sur la Seconde Guerre mondiale qui n’arrêtent pas de paraître. Ils sont écrits par des gens qui ont trente ou quarante ans et qui fantasment sur le sujet, alors qu’il y a tant de conflits dans le monde où ils n’ont pas le courage d’aller pour témoigner et vivre. Bien sûr, ça peut donner des œuvres magnifiques, il n’en reste pas moins que les chefs-d’œuvre absolus ont été écrits par des gens qui ont vécu ce qu’ils écrivent. Fantasmer sur la guerre, je trouve ça d’une morbidité et d’une malhonnêteté…Je crois que la véritable honnêteté consiste à vivre cette expérience pour la décrire. Ce qui ne veut pas dire qu’on est obligé de tuer quelqu’un pour écrire un roman policier…
À travers ton titre, peut-on dire que tu aimes la mort ?
Pas forcément. Derrière la guerre se cache aussi la liberté anarchique, violente, sauvage, mais très belle. Derrière la guerre se cache aussi une sorte de relâchement sur le plan moral qui révèle ce qui est réellement bon en toi, chez les autres, ce qu’il y a de plus humain. C’est ça le grand examen. Je n’ai pas pensé à la mort, en Afghanistan. Je n’ai pas pensé à la mort une seule fois, dans ce pays.
On connaît l’expression latine « In vino veritas », penses-tu qu’on pourrait remplacer le vin par la guerre, dans cette expression ?
Sans doute. Je ne dis pas que c’est la seule expérience qui te révèle à toi-même ou à tes proches. Je pense qu’une maladie grave, incurable pose certainement le même problème. Et à toi-même et aux gens qui t’entourent. Il y a des expériences comme ça. Radicales. Extrêmes. Mais la guerre en est une.
Je ne sais plus quel écrivain disait qu’une chose grave peut ne pas être importante. Quelle est la chose la plus grave que tu as vue ou vécue en Afghanistan ?
(Long silence). J’ai envie de rire parce qu’en fait je crois que le plus dur pour moi c’était de survivre l’hiver. Et ce n’est pas grave, tout compte fait. Maintenant j’en ris. Pourtant, les moments où il fallait attendre, jour après jour, heure après heure, minute après minute que le courant revienne…C’était d’une pénibilité absolue. Pourquoi c’est si abominable ? Parce que tu es seul et que tu ne peux rien faire. Tu as tellement froid que tu ne peux qu’attendre. Donc tu es enveloppé de ta doudoune, d’une couette qui est chez toi avec un bonnet, et tu attends comme un débile.
Le pire ce n’est pas d’être seule, c’est d’être seule avec soi-même, non ?
Oui, c’est le moment où tu te poses la question « Mais qu’est-ce que je fous là, dans ce pays, à attendre quelqu’un qui appuiera sur un bouton pour avoir un peu de lumière et de chaleur ». Maintenant j’en ris, mais Dieu sait que ça m’a couté énormément.
Comment s’est déroulé ton retour en France ?
On ne ressent pas tout de suite le vide. C’est l’instinct qui te fait jouir de tout ce que tu retrouves, tout ce dont tu as été privé pendant deux mois. Il y a quelques secondes de folie, de jouissance au Monoprix ou tu as des rayons, des rayons entiers de trucs. C’est là aussi où tu vois la folie occidentale d’avoir inventé 150 variétés de beurre ou de yaourt. Là bas tu en as un ou deux et basta. Dans un premier temps tu profites de ça, tu profites de la vie culturelle que tu n’as pas. Le plaisir d’aller au cinéma, d’aller au théâtre, d’aller voir une exposition, ce n’est pas la même démarche. Aussi, j’ai souvent rêvé de la possibilité de sortir de chez moi, d’acheter un journal, de m’asseoir dans un café et de le lire. Tu ne peux pas le faire là-bas. Ensuite, à partir du moment où ça devient ta routine, ton quotidien, tu ne penses qu’à l’éventualité d’y retourner. C’est une drogue, la guerre ! Très très puissante.
La guerre est finalement la meilleure drogue d’Afghanistan…
(Rires). Oui, la guerre et l’écriture.
Il y a quelque chose dont tu ne parles pas, dans ton livre : ce qui touche au domaine de la spiritualité, de Dieu, etc. Pourquoi ?
La religion c’est paradoxal. C’est difficile de parler de la spiritualité des afghans, qui, sans doute, existe. Sauf que cette spiritualité est complètement gâchée et cachée et éclatée par les aspects purement politiques et sociaux de l’islam. Après, en ce qui me concerne, ce qui s’est produit avec moi, qui suis complètement athée, jusqu’au bout des ongles, c’est que le fait que ce soit la religion qui régisse la vie quotidienne et le moindre de tes gestes, à la fois ça m’attirait énormément, étant donné que c’est ce qui donne naissance à la vie de tant de gens, et il y a une sorte de beauté dans cela, je l’observais même chez le gardien de notre maison, qui se levait à 3h du matin et allait prier dans la neige. En même temps, il y a eu aussi un mouvement contraire, une furie où je ne pouvais plus supporter le religieux autour de moi. Je ne pouvais plus voir les femmes voilées, plus voir les hommes barbus, plus voir les mosquées remplies le vendredi. J’avais envie de vomir. Ça provoque une répulsion. Chez les gens qui en ont la possibilité, comme les militaires ou les mercenaires, ça peut provoquer, j’imagine, un excès de folie meurtrière. Parce que c’est à un tel degré que ça devient insupportable, pour nous occidentaux. De surcroît, nous voyons leur hypocrisie dans l’application de la religion : ils boivent, ils courent après les nanas, les étrangères, etc. Je suis rentrée saturée par ça, au point qu’atterrissant à Roissy, moment où j’ai croisé des Européennes voilées, il a fallu que je me contienne pour ne pas envoyer des baffes, tellement je n’en pouvais plus.
As-tu connu un moment de transcendance durant cette guerre ?
Non, absolument pas. Je trouve que c’est tout à fait naturel de s’interroger là-dessus quand tu vis dans un pays comme l’Afghanistan. Ce n’est pas la même chose en Lybie ni dans la bande de Gaza, en Palestine. Ma foi, et je crois qu’il y a lieu de parler de « foi », réside dans l’espoir que tout se termine au moment de la mort. La consolation, pour moi, elle est là. Au moment de ma mort, je reviendrai à la terre, là d’où je viens. Ensuite je ne sais pas, c’est les particules élémentaires…Il y a quelque chose de très beau : je suis capable de contempler et d’admirer la foi des autres. Ça me touche énormément, jusqu’à me bouleverser. Et quand je vois des hommes prier, je trouve ça d’une beauté extrême. La confiance qui les pousse à des crimes atroces, je trouve ça d’une beauté extrême. Peut-être sont-ils plus proches des réalités, je n’en sais rien. Mais ce que nous avons fait de Dieu, en Occident, nous l’avons domestiqué, nous en avons fait un type assez sympa, qui pardonne tout, qui est « cool ». Je ne pense pas qu’il soit cool, en fait. Quand tu lis la Bible ou le Coran, il n’est pas cool. C’est donc peut-être eux qui sont plus proches de la vérité. Leur religion c’est le sang, la cruauté, le meurtre, la rédemption. Des mots confus en occident. Si j’étais croyante, je crois que je serais dans l’extrémisme et que je serais une intégriste. Il y a un corps de la religion qu’il ne faut pas perdre. Les messes en français, polonais, ou tchèque n’ont pas la même puissance qu’en latin. Ce qui m’insupporte, c’est cette tendance à rendre Dieu très cool. Non, il n’a pas à l’être.
Tu penses qu’il est plus facile d’écrire en français, quand on est étrangère, plutôt que dans votre langue natale, le polonais ?
Oui et non. Non bien évidemment parce qu’en parlant je m’entends moi-même faire des fautes. Ça exige un travail considérable de relecture, avec les dictionnaires, pour soigner la syntaxe. Il y a énormément de travail . Mais en même temps, il y a en moi une sorte de défi, c’est-à-dire qu’à partir du moment où j’ai décidé de vivre dans ce pays, la moindre des choses c’est de pouvoir utiliser la langue française librement, comme si j’étais française. C’est une sorte de remerciement adressée à la France de m’avoir accueillie. Accueillie bien ou mal, peu importe, ça fait un bout de temps que je suis là. Je me dis qu’en même temps, dans cette difficulté, il y a une facilité qui consiste dans le fait d’être coupé de toute une partie de vocabulaire superflu. Ça épure naturellement. Cruellement, mais naturellement. Par exemple, je ne saurais pas écrire un roman en français sur l’enfance. Parce que tout le vocabulaire lié à l’enfance me manque.