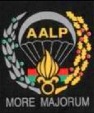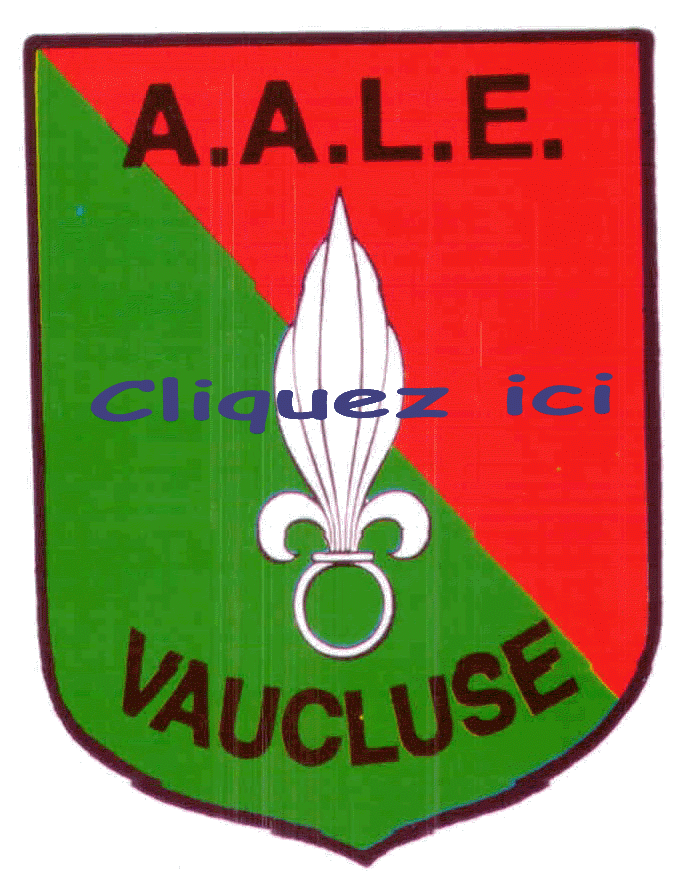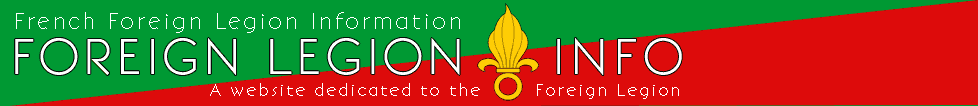François Lecointre
Article extrait du numéro 11 de la revue
Expression de la singularité des armées et de leur finalité, la culture militaire, le plus souvent brocardée mais aussi, selon les périodes de l’histoire, utilisée comme vecteur de patriotisme populaire, est un élément constitutif du paysage culturel national. Sans doute en est-ce même une composante essentielle qui va bien au-delà de l’apport, généralement concédé avec une certaine ironie, de l’« art militaire » au patrimoine commun. Une conception proprement martiale de l’ordre des choses dont, en bien ou en mal, procède pour une part importante l’alchimie propre à chaque identité nationale.
Or cette culture militaire, pour ancienne qu’elle soit, est de plus en plus menacée au sein des démocraties occidentales par un mouvement récurrent de banalisation que le sociologue américain Morris Janowitz – le premier à en avoir identifié les effets à la fin des années 1960 – a décrit sous le terme de « civilianisation » Morris Janowitz, The Professional Soldier, The Free Press, 1971..
De quelle manière, et pour quelles raisons, un tel affadissement s’exerce-t-il ? Doit-on le déplorer comme la perte d’une dimension virile qui accroîtrait une propension européenne à la passivité inspirée de Vénus Robert Kagan, La Puissance et la Faiblesse, Paris, Plon, 2003. ? Doit-on au contraire s’en féliciter comme d’une rupture avec la « babouinerie et adoration animale de la force » « Babouineries et adoration animale de la force, le respect pour la gent militaire, détentrice du pouvoir de tuer. […] Et pourquoi noble ou chevaleresque sont-ils termes de louange ? […] Pris en flagrant délit, les humains ! Pour exprimer leur admiration, ils n’ont rien trouvé de mieux que ces deux qualificatifs, évocateurs de cette société féodale où la guerre, c’est-à-dire le meurtre, était le but et l’honneur suprême de la vie d’un homme ! » (Albert Cohen, Belle du Seigneur, Paris, Gallimard, 1968). qu’Albert Cohen dénonce comme une malédiction fondatrice des sociétés féodales ?
Pour comprendre ce phénomène et tenter d’en mesurer quelques conséquences, il convient tout d’abord de s’efforcer à une description rapide des principaux traits de la culture militaire tels qu’ils s’expriment à travers des manières d’agir, des manières de penser et des valeurs de référence souvent très décalées par rapport à la culture civile contemporaine. On pourra ensuite tenter d’identifier les courants et les mécanismes de banalisation qui sont à l’œuvre aujourd’hui avant de proposer quelques pistes de préservation ou de restauration d’une identité militaire peut-être plus nécessaire aujourd’hui que jamais.
Manières de faire
Les armées, c’est entendu, sont faites pour être engagées dans la guerre et, dans la guerre, ont pour fonction de « mettre la force en œuvre de façon méthodique et organisée » Gaston Bouthoul, Traité de polémologie, Paris, Payot, 1991.. Cette fonction est remplie dans un cadre, sous des contraintes et selon des procédés impératifs très caractéristiques, qui sont autant de fondements de la culture militaire.
Tout d’abord, la guerre se déroule dans des conditions de chaos et de désorganisation de l’environnement général, sur des « théâtres d’opérations » ou des « champs de bataille » que les civils sont réputés avoir évacués, fut-ce dans un exode dont les flux désordonnés sont susceptibles de désorganiser la logistique militaire. Elle se fait donc entre militaires face à un ennemi dont les moyens, la doctrine et la puissance sont a priori comparables à ceux des amis (sinon l’ennemi aurait été dissuadé par avance d’attaquer ou convaincu de se soumettre sans combattre) et face auquel, dans le respect du jus in bello, l’emploi le plus extrême de la force sera considéré comme légitime.
La guerre, ensuite, se fait dans le respect de la confidentialité des objectifs militaires à atteindre et des plans de bataille. Et si l’action de combat sert de support à une communication qui l’accompagne pour la rendre plus acceptable ou pour motiver les troupes autant que la population, il s’agit bien là d’une propagande contrôlée autant que le sont les correspondants de guerre envoyés sur le champ de bataille. Selon l’idéal type ainsi défini en se référant aux guerres entre États-nations et aux derniers conflits mondiaux, les armées sont donc engagées, sous la forme d’une confrontation extrême de grands ensembles militaires complexes, sur une durée définie précisément, le début et la fin des hostilités donnant lieu à des accords signés entre belligérants.
Pour conduire de telles guerres, les États modernes se sont dotés d’armées dont la puissance et l’efficacité procèdent de leur maîtrise des technologies les plus avancées ainsi que de leur capacité à planifier et à conduire des actions d’une grande complexité sur de vastes échelles. Entièrement organisées et rationalisées pour l’engagement le plus efficace possible dans une guerre qui s’intercale entre deux périodes de paix, les armées ne sont pas réputées être utiles dans des phases de non-emploi dont il est communément admis qu’elles doivent être totalement dédiées à leur préparation et à leur entraînement.
Manières de penser
Leur finalité les vouant à la nécessité éventuelle de l’engagement le plus extrême pour la survie du pays, les armées entretiennent un lien consubstantiel avec la nation. De ce lien découle un rapport au temps très singulier. Pas de nation, en effet, sans continuité historique passée et à venir ; continuité dont les armées se sentent pour partie les garantes. Les militaires s’inscrivent donc, consciemment ou non, dans le temps long de l’histoire et mettent toujours leurs actions et leurs propres évolutions en perspective. Sans doute cette forte historisation, ajoutée au principe selon lequel les armées ne trouvent leur pleine utilité qu’au moment où il faut faire la guerre, conduit-elle les militaires à se soucier assez peu de rentabilité immédiate, celle-ci ne pouvant être réellement mesurée qu’en de rares et tragiques occasions.
De la relation sacralisée qui existe entre la vie de la nation et l’existence des armées procède également une complète dépolitisation de l’institution, le lien entretenu avec la France transcendant la fidélité à un régime particulier. Cet apolitisme s’ajoute à la forte soumission au politique déjà évoquée. Il n’est cependant pas exclusif d’une interrogation récurrente sur la légitimité des missions et des ordres donnés par l’autorité politique.
Le rapport des militaires à l’espace est sans doute également notablement différent de celui des autres corps de l’État ou de la société française en général. Les armées sont en effet naturellement bien plus tournées vers l’extérieur que vers l’intérieur. Ne vaut-il pas mieux que la guerre et les ravages qu’elle induit aient lieu ailleurs que sur le territoire national ? Et n’a-t-on pas intérêt à aller contrer la menace au plus loin, chez elle si possible, avant qu’elle ne prenne de l’ampleur ? Ce tropisme international est renforcé par l’existence d’une séparation bien nette entre les forces de l’ordre chargées de la mise en œuvre quotidienne de la force sur le territoire national et les armées. Il engendre une relative désaffection des militaires pour les problématiques de sécurité intérieure auxquelles leurs concitoyens sont pourtant bien plus sensibles qu’à l’état du monde.
L’appréhension de l’univers médiatique se fait sur un mode paradoxal. En effet, les armées, quoiqu’ayant souvent affecté un certain mépris pour la communication, ont toujours été fort soucieuses de l’image qu’elles renvoyaient à leurs concitoyens. L’esthétique militaire est une réalité ancienne que l’on retrouve en architecture, en musique et, bien sûr, dans le cérémonial et dans les tenues. Si le souci de l’apparence est donc une constante de la culture militaire, il n’induit cependant pas de souci de notoriété tant il semble naturel au soldat d’être au centre des préoccupations du politique dès lors que du sort de la guerre dépend la survie de la nation. En outre, depuis le considérable effort de reconstruction militaire mis en œuvre par la iiie République au lendemain de la défaite de 1870 (effort qui visait autant à l’instauration profonde d’un régime républicain dans le pays qu’à la préparation de la revanche), les armées se trouvent placées au centre de la culture nationale Le 14 juillet 1880, la cérémonie de remise des drapeaux aux régiments reconstitués marque le point de départ d’un mariage essentiel entre l’État et l’armée, ferment d’un patriotisme renouvelé et républicain qui durera jusqu’à nos jours à travers l’association entre la fête nationale et la parade militaire.. Malgré la défaite de 1940 et l’image peu valorisante des guerres de décolonisation, malgré l’effet parfois ravageur que produit la contrainte du service national sur l’opinion qu’ont les Français de leur armée, les militaires, jusqu’à la professionnalisation de 1996, continueront à considérer les journalistes comme des gens dont il faut se méfier et à assimiler la communication à une publicité à finalité commerciale pour laquelle ils éprouvent un certain dédain.
Valeurs partagées
La guerre est une action tellement extrême qu’on ne pourra s’y résoudre que pour des raisons extraordinaires ayant trait à la survie de la communauté et qu’il ne saura être question, dès lors qu’une telle obligation sera avérée, de tenter de s’y soustraire. Le soldat, par état, est donc disponible, c’est-à-dire prêt, en permanence, à combattre l’ennemi et à exécuter la mission (le militaire peut être appelé à servir en tout lieu et à tout moment). Détenteur de la force et du pouvoir exorbitant d’infliger la mort et la destruction, il doit également être parfaitement soumis au pouvoir politique dont il est l’instrument. Cette exigence de discipline et de très grande rigueur est renforcée par la complexité technique de l’activité de combat qui met en œuvre de très nombreux acteurs servant des équipements et des armes très variés, dont la complémentarité des effets garantira le succès tactique. Ainsi, la rigueur et la discipline paraissent d’autant plus acceptables et naturelles aux militaires qu’elles sont la garantie de leur efficacité et de leur sécurité dans une activité éminemment collective.
Contraint, par fonction, à donner la mort, le soldat ressent profondément la nécessité d’encadrer ses actes par une éthique exigeante qui, plus encore que la légalité de l’ordre reçu et la légitimité de l’autorité qui l’emploie, permet de surmonter le traumatisme moral que constitue ce fait. C’est certainement le sacrifice consenti de sa propre vie qui rend moralement supportable l’obligation de tuer. La mort acceptée devient ainsi une sorte de caution expiatoire. Elle est intimement liée à l’éthique militaire et fonde la vertu d’héroïsme comme elle amène naturellement à considérer que la mort doit être donnée le moins possible dès lors qu’existe une sorte de symétrie déontologique entre la vie d’un ennemi et celle d’un ami. De cette symétrie découle une vertu essentielle du soldat : la capacité de maîtriser sa propre violence. Encore faut-il, pour que cette vertu puisse être pratiquée, que l’ennemi soit toujours considéré comme un être humain dont la dignité est aussi sacrée que la sienne propre.
De la conjugaison des exigences éthiques du métier des armes et de son caractère collectif procèdent, enfin, les qualités particulières des comportements individuels et interpersonnels, qualités revendiquées comme autant de vertus militaires, même si les militaires ne peuvent prétendre en avoir l’exclusivité. Parmi ces vertus, il faut en retenir deux principales. Le courage, d’une part, qui paraît une nécessité pour surmonter la peur au combat et endurer les fatigues ainsi que les agressions physiques et morales que comporte une activité souvent rude. Mais le courage, et plus encore la force morale, permet de faire son métier avec honneur. La confiance mutuelle, d’autre part, liée à l’interdépendance, jusqu’à la mort, des soldats et de leurs chefs dans le combat. Cette confiance mutuelle induit le respect entre individus « frères d’armes », en dehors de toute considération de grade et d’ancienneté. Elle rend la discipline acceptable, transformant ce qui pourrait n’être que soumission imposée en obéissance librement consentie. Elle se traduit en outre par la fidélité qui lie chefs et subordonnés par des liens très puissants de devoirs réciproques.
Ces vertus ne sont évidemment pas pratiquées avec une égale intensité par tous les militaires en toutes circonstances. Elles constituent cependant le cadre psychologique et moral, admis, tacitement ou explicitement, par tous, et à l’intérieur duquel doivent s’élaborer les rapports entre les individus, à la fois dans la forme (le cérémonial ou les règles de savoir-vivre militaires) et dans le fond (comme, par exemple, le devoir que tout chef a de défendre et de promouvoir les intérêts de ses subordonnés, que les exigences spécifiquement militaires de discipline et de disponibilité privent du droit de grève comme du droit de se syndiquer).
La culture militaire à l’épreuve de la professionnalisation et de la fin de la guerre
L’identité militaire qui a été tracée à grands traits est le produit de sédimentations successives dont les plus déterminantes sont également les plus récentes, les deux « guerres mondiales » constituant des paroxysmes aussi fondateurs qu’ils sont destructeurs, pour la civilisation humaine en général, pour les armées en particulier. Mais cet archétype de la culture militaire, s’il a pu traverser avec une relative impunité les conflits de la décolonisation, est profondément affecté par les évolutions des deux dernières décennies.
Cette période, en effet, est celle d’une fracture intellectuelle et civilisationnelle importante caractérisée par le glissement qui s’opère du statut de sujet-citoyen à celui d’individu-homme. Cette évolution touche en premier lieu l’État démocratique dont Pierre Manent nous montre que dès lors qu’il a rempli sa mission historique d’accomplissement des libertés individuelles et d’égalisation des conditions, il se défait progressivement, perd son rôle d’incarnation de la nation et sa fonction opérationnelle d’organisation de la vie publique Pierre Manent, La Raison des nations, Paris, Gallimard, 2006.. L’État-nation perdant sa légitimité entraîne tous ses serviteurs dans une forme de banalisation qui se traduit par la contestation des statuts (garantie d’emploi, irresponsabilité de fait) et des privilèges (prestige des fonctions) liés jusque-là à leur mission régalienne. Ce glissement remet encore profondément en cause une partie considérable d’un corpus culturel militaire fondé, on l’a vu, sur le sentiment collectif et la discipline.
Ces décennies sont également celles de l’atténuation progressive de la grandeur de la France ; grandeur matérialisée par un empire et par un statut de vainqueur qui disparaissent l’un et l’autre tandis que se crée l’Union européenne, au sein de laquelle se dilue l’identité nationale que rien ne vient relayer. Avec cette disparition de la grandeur cesse l’un des mobiles principaux de l’identification entre le citoyen et le soldat. Un autre mobile, celui du combat pour la survie, s’estompe avec l’évaporation d’une menace jusqu’alors très concrètement matérialisée dans des espaces géographiques proches.
Quand être soldat devient un métier
Ces évolutions considérables renforcent la singularité des armées au sein de la société au point d’en faire une institution en décalage extrême avec les enjeux internationaux, tels qu’ils apparaissent aux non-avertis, et surtout avec les aspirations individuelles des citoyens, jusqu’à délégitimer définitivement le service national. De façon assez paradoxale, le passage à l’armée professionnelle va s’accompagner d’une banalisation accélérée sous l’effet de trois processus principaux.
La technicisation du métier
Professionnalisées à partir de 1996, les armées doivent, dans des délais très courts, constituer une ressource humaine professionnelle considérable. Pour réaliser ce véritable tour de force et attirer chaque année environ trente mille jeunes hommes et femmes, elles décident de développer l’image d’un employeur offrant de très nombreuses opportunités ; image séduisante, certes, mais qui gomme la réalité d’une spécificité militaire dont on craignait alors qu’elle puisse être mal comprise et qu’elle ne décourage les vocations les moins assurées.
S’ajoutant aux thèmes « métiers » des campagnes de recrutement et à la technicité croissante de l’activité guerrière, le principe même de professionnalisation engendre, au sein de la communauté militaire, un malentendu et une évolution « techniciste » de la conception du service des armes. Considéré à tort comme « spécialiste militaire », le soldat pourrait ne valoir que pour la compétence technique qu’il exercerait dans le cadre strict des horaires de service. L’ambition éducative qui sous-tendait toute vocation de chef militaire de l’armée de conscription, et qui conduisait à considérer l’homme et le citoyen avant l’individu techniquement compétent cède alors le pas à l’obsession technicienne et à la mesure rigoureuse du rendement. Cette vision désastreuse banalise la vocation militaire.
L’effet « trente-cinq heures »
Caractérisant les évolutions psychologiques d’une société et d’une jeunesse qui, au-delà du droit au loisir, revendique l’absolu respect d’une sphère privée considérée comme lieu essentiel de l’épanouissement individuel, l’acquis des « trente-cinq heures » doit être pris en compte par les armées. Celles-ci, en effet, souhaitent éviter que ne se renforce à l’excès, entre elles et la société, un décalage très contre-productif en termes de recrutement. N’ayant pas les moyens financiers de compenser à proportion due les contraintes inhérentes aux exigences de disponibilité proprement militaires, elles intègrent le décompte horaire des trente-cinq heures dans le rythme et le mode de vie militaires. Cette intégration fragilise considérablement les principes fondateurs d’une identité forte et originale, procédant pour l’essentiel, on l’a vu en première partie, des devoirs et contraintes qui découlent du service de la nation par les armes.
L’obsession de la rupture d’avec la société
Habituées à considérer la communication comme une démarche de « marketing » peu nécessaire, les armées, à l’heure de la professionnalisation, sont confrontées au besoin d’une communication de recrutement évoquée ci-dessus et dont on a vu les effets pervers. Elles s’estiment également sujettes à un risque de rupture entre les soldats et les citoyens. Ce risque est très contestable, et l’on doit sans doute considérer que le danger véritable n’est pas celui d’une rupture mais d’une indifférence croissante. Toujours est-il que l’analyse faite en 1996 conduit les armées à cultiver une image la plus neutre et la plus consensuelle possible. Elles pratiquent également un devoir de réserve rigoureux qui, fin de la conscription et éloignement géographique des opérations aidant, fait pratiquement disparaître les questions militaires du débat public français.
Quand la guerre n’existe plus
La grande confusion sémantique qui caractérise aujourd’hui tous les débats et réflexions sur la défense et les armées n’est sans doute que le reflet de deux décennies d’évolution profonde de la conception qui est faite de l’emploi de l’outil militaire. S’agit-il encore de « défendre » ou bien de « sauvegarder », ou bien encore, selon le volapük actuellement en cours dans les milieux autorisés à traiter de ces sujets, de s’inscrire dans le « continuum sécurité-défense » ? Une chose paraît à peu près certaine à la plupart : il ne s’agit plus de faire la guerre puisque celle-ci a disparu. Mais alors à quoi et comment employer un outil dont on dispose et qu’il faut bien utiliser, ne serait-ce que pour justifier son coût ? Ainsi, parmi les principaux facteurs de banalisation de l’action militaire, il faut retenir l’émergence d’une logique de rentabilisation de l’outil militaire et l’engagement quotidien croissant des armées dans les opérations extérieures.
Le souci de rentabilisation de l’outil militaire
Avec l’effondrement de l’Union soviétique et le démembrement du pacte de Varsovie a disparu l’évidente nécessité d’une défense militaire de l’Europe occidentale en général, de la France en particulier. Ce n’était certes pas la première fois qu’à la fin d’une guerre, l’ennemi étant vaincu, il devenait possible de démobiliser la troupe et de réorienter l’effort productif principal du pays vers le secteur civil. Le fait nouveau de cette fin de guerre froide résidait dans cette conviction des sociétés occidentales que la guerre étant un modèle de gestion des conflits devenu désormais complètement et définitivement obsolète, les armées pouvaient être supprimées. Sans doute un tel constat était-il trop brutal pour être immédiatement traduit en décision politique mais, combiné à l’idée que les confrontations entre nations avaient changé de nature et que la guerre ne pourrait plus être qu’économique, il posait la question de la rentabilité d’un outil dont le coût important pouvait être considéré comme une entrave à la performance d’un pays. À cette question nouvelle, deux réponses ont été apportées qui pervertissent l’une comme l’autre l’archétype de l’action militaire tel qu’il a été défini en première partie. Tout d’abord, l’engagement des armées dans des actions de sécurité sur le territoire national qui, s’il confère une bonne « visibilité » aux soldats, les assimile à des policiers dont les modes d’action, l’organisation et les équipements n’ont évidemment aucun rapport avec ceux des militaires. Ensuite, les opérations à très forte visibilité humanitaire qui, si elles répondent assurément aux émois de l’opinion publique, détournent les armées de leur finalité première de mise en œuvre délibérée de la force et conduisent à des engagements militaires sans objectifs politiques définis. Plus grave encore, un tel emploi des armées brouille l’enjeu stratégique pourtant bien réel de stabilisation des marges de l’Europe et fait perdre de vue la véritable nécessité de posséder un outil militaire apte à la résolution des situations de crise qui portent en germe la fin de la prospérité et de la sécurité des démocraties occidentales.
Les opérations extérieures
Si les opérations extérieures sont un facteur important de civilianisation de l’action militaire, c’est principalement parce que leur très grande complexité les rend difficiles à comprendre tant par les observateurs extérieurs que par les soldats eux-mêmes qui pensent parfois pouvoir s’exonérer, dans ces engagements, des règles et principes d’action qui sont de rigueur dans les guerres classiques. S’appuyant généralement sur les procédés tactiques liés aux missions de contrôle de zone, ces opérations se distinguent cependant de l’action de guerre par un certain nombre de caractéristiques qui semblent s’opposer point par point aux canons définis plus haut. Plus d’ennemi, en effet, simplement des belligérants entre lesquels il faut le plus souvent s’interposer. Plus de limite de temps pour des opérations qui se déroulent, en outre, au milieu des populations, sous les feux des médias et dans un cadre juridique rendu de plus en plus contraignant par la multi-nationalité et l’impératif d’une légitimité que seul un mandat de l’ONU peut conférer. Plus de manœuvres de grandes masses d’hommes et d’équipements, mais des dispositifs le plus souvent statiques et des actions au cours desquelles l’acteur décisif est le simple chef de groupe… En somme, des opérations internationales de maintien de l’ordre pour lesquelles de simples constabulary forces pourraient suffire amplement en lieu et place d’armées aussi coûteuses que sophistiquées et suréquipées.
L’expérience de vingt années d’interventions extérieures ne suffit pas toujours à faire admettre le principe de réversibilité mis en avant par les armées et selon les termes duquel, dans ces opérations de « stabilisation », la force engagée doit pouvoir, sans délai, faire face à une recrudescence de violence extrême et combattre de la manière la plus déterminée et la plus classique qui soit. Malheureusement, la confusion généralement entretenue entre une réalité de niveau stratégique On pourrait sans doute parler ici de réalité de niveau politique ou philosophique si l’on se réfère à l’analyse que fait Pierre Manent dans La Raison des nations (op. cit.). Selon lui, en effet, il n’y a plus de guerre légitime pour des démocraties s’il ne s’agit de rétablir le règne du droit. Toute opération de guerre doit ainsi être considérée comme une opération de police puisqu’elle vise à rétablir un ordre sur un territoire organisé par le droit national ou international. Les armées, ne poursuivant plus d’intérêt national spécifique mais visant simplement à rétablir le droit, sont donc devenues des forces de police et doivent être considérées comme telles. Sans qu’il soit ici question de contester cette analyse point par point, il est tout de même nécessaire d’insister sur le fait que les opérations de stabilisation répondent bien, même si cela est difficilement perceptible par l’opinion publique, aux impératifs de défense de la société et de préservation des intérêts nationaux. On peut également relever que Pierre Manent lui-même modère sa propre thèse dans une interview donnée au journal L’Expansion le 1er octobre 2006 : « [La] douceur démocratique a rendu les actes de violence, et même les simples risques, de plus en plus insupportables. En Europe, […] nous ne voulons pas voir qu’il y a danger. [Nous avons la] conviction que si nous, Européens, sommes suffisamment tolérants, ouverts, etc., les problèmes se résoudront d’eux-mêmes. Nous nous interdisons ce que Tocqueville appelait les “vertus viriles”, qui ont à voir avec l’exercice de la force. », qui fait de ces opérations extérieures des « opérations autres que la guerre », et la réalité de niveau tactique, qui met clairement en évidence le besoin d’armées très classiquement entraînées et équipées, conduit à privilégier la moindre exigence et le moindre coût.
Du souci de rentabilisation de l’outil militaire et de l’analyse erronée des opérations extérieures naît, dès lors, l’idée que les armées pourraient avantageusement être « allégées ». Elles deviendraient alors une sorte de garde républicaine, suffisante pour garantir la participation de la France aux opérations internationales et utilement employable pour faire face quotidiennement, sur le territoire national, à des enjeux de sécurité intérieure probablement exagérés mais dont on ne peut douter qu’ils soient au centre des préoccupations des électeurs.
Garder un champ pour la bataille et préserver sa force pour la conduire
La posture de déni collectif et individuel est une des singularités troublantes des sociétés occidentales modernes, que l’accès à l’ère de l’information sans limite pousse dans des attitudes et des comportements quasi suicidaires. Au nombre de ces refus pathologiques à admettre la réalité, le déni de violence est peut-être l’un des plus pervers. Au prétexte qu’on ne peut pas se résoudre à la subir, on prétend éradiquer la violence du cœur des hommes, de la vie des sociétés, des rapports entre les nations. Et pour parvenir à cette pure utopie, on s’en remet tout entier, dans une sorte d’aveuglement qui confine à l’idéologie, au règne d’un droit omnipotent par nature et qui évacue aujourd’hui ces notions de guerre et de violence collective au motif que, seule une guerre défensive pouvant être légitime (cette conception étant considérée comme universellement partagée Par la Charte de l’Organisation des Nations Unies, les nations signataires s’engagent (préambule) à « accepter des principes et à instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force, sauf dans l’intérêt commun », cet intérêt commun étant défini (article 41) comme le « maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale », la seule exception à cette règle étant (article 51) le « droit naturel de légitime défense ».), aucune société n’a plus désormais de raison d’y avoir recours.
Cette vision très irénique fait, hélas, abstraction de la réalité. Cette « morale » (relative comme toute morale) est d’abord (seulement ?) européenne et n’est évidemment pas partagée par tous les protagonistes des relations internationales. Il est même à craindre qu’elle puisse être considérée par beaucoup comme un moyen d’imposer une dictature pacifique de la prospérité. Les sociétés les plus pauvres et les moins aptes à accéder à la qualité et au rang de partenaire du jeu économique mondial pourraient, en effet, refuser une vision moralisante des rapports entre groupes humains qui prétendrait leur dénier le recours collectif à une force et à une violence que leur propre histoire n’a pas érigé en interdit. Considéré par les Européens comme un summum de civilisation, le déni de recours à la force peut ainsi être compris par d’autres soit comme une contrainte normative particulièrement hypocrite, soit comme une forme de décadence ou, tout au moins, de faiblesse à exploiter.
Sans doute plus grave encore, cette annihilation incantatoire de la violence par la délégitimation de toute forme de guerre prive les relations internationales d’un espace ritualisé où les tensions extrêmes peuvent s’exalter en confrontations armées encadrées par le droit. Or, comme René Girard René Girard, Achever Clausewitz, Paris, Carnets Nord, 2007. en fait le constat et comme l’observation objective des vingt années passées devrait l’ériger en évidence, la violence ne disparaît pas. Elle demeure désormais généralisée, éparpillée, endémique et plus destructrice que jamais. Avoir, par un tour de passe-passe sémantique et conceptuel, escamoté tout ennemi pour le remplacer par le « terrorisme » ne règle rien, bien au contraire. Aujourd’hui devenus des criminels en infraction avec le droit et la morale, les violents n’ont d’autre recours que l’extrême, le paroxysme. Sans ennemi, il n’y a certes pas de combat, seulement une chasse au contrevenant pour restaurer la paix et l’ordre. Mais sans ennemi et sans combat, il n’y a pas non plus de « paix des braves ».
Confrontées à une telle impasse, les sociétés modernes ont-elles d’autre choix que celui de réinventer la guerre ? Ne doit-on pas reconsidérer dès lors la contribution de la culture militaire à la culture nationale et européenne non comme un ultime avatar de la « babouinerie » féodale mais comme un enrichissement salutaire ? Ainsi le besoin de préservation, au sein de l’institution militaire, d’une culture forte et originale ne doit-il pas être compris comme l’expression d’une prétention aussi vaine qu’insupportable à entretenir un conservatoire national de vertus plus ou moins désuètes. Il s’agit, bien au contraire, d’une garantie de lucidité : l’acceptation de la perspective du combat. Un combat qu’il faut tout faire pour ne jamais avoir à le livrer, mais auquel il faut se préparer, non seulement en entretenant l’outil, mais aussi en cultivant les valeurs, les vertus et le degré de conscience collective qui, dans la guerre, préserveraient la société de la barbarie de la violence.