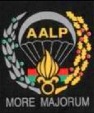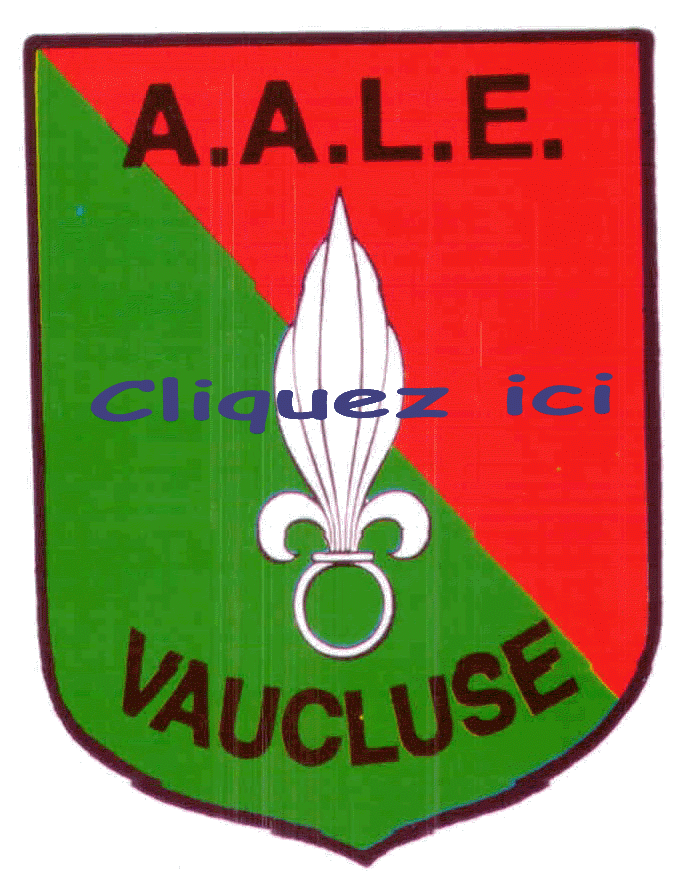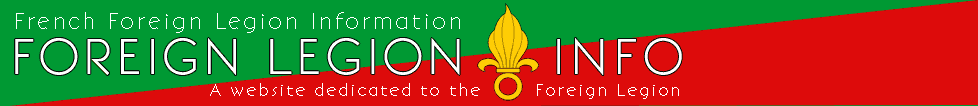Publié le Lundi 17/08/2015

24 juillet 2015. Face à un parterre d’officiels et quelques journalistes, un homme d’une c i n q u a n t a i n e d’années se tient droit, ému, vêtu d’un sage pantalon beige et d’une chemise blanche immaculée. Entre les mains, de Jacques Nicolaï, le diplôme de citoyen d’honneur de la ville de Promina que vient de lui décerner Tihomir Budanko, le maire de la commune. Les deux hommes se sont connus près d’un quart de siècle plus tôt. A l’époque, ils portaient des treillis et faisaient le coup de feu contre les miliciens et l’armée serbes.

Car si Jacques Nicolaï a obtenu cette distinction, ce n’est pas en tant que mécène ou résident VIP de Promina, mais parce qu’il est un ancien combattant étranger dans les rangs de l’armée croate. Retour à l’automne 1991. Jacques a une trentaine d’années, son histoire personnelle s’enlise dans un quotidien morne, rythmé par les journées de travail au sein d’une entreprise du bâtiment en train de péricliter : « J’étais couvert de dettes, j’avais trente ans, une vie morne et triste, tout cette consommation de merde... »
"J'avais trente ans, une vie morne et triste, toute cette consommation de merde..."
Le déclic a lieu à l’automne de cette année-là, alors que la guerre fait rage sur le sol européen pour la première fois depuis près de cinquante ans. Dans les foyers français, les téléviseurs déversent un flot ininterrompu d’images du conflit en ex-Yougoslavie et Jacques, « dégoûté par une guerre qui se déroule à quelques kilomètres de nos frontières », décide de se lancer dans l’humanitaire. Avec un ami avocat, il commence à organiser des convois à destination de la Croatie et se rend vite compte que les vêtements, les produits de première nécessité, la nourriture acheminés par semiremorques entiers, terminent sur les étals des marchés à Zagreb.

Changement de programme : dorénavant, il acheminera ses vivres au plus près des lignes de front, d’Osijek à Zadar en passant par Sisak. C’est dans cette dernière bourgade de Croatie centrale, tristement célèbre pour avoir abrité un camp de concentration pour enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, qu’en octobre 1991, alors qu’il est resté sur place pour préparer l’arrivée d’un nouveau convoi, Jacques voit des jeunes hommes « monter au front ». C’est le deuxième déclic. A quoi bon faire des allers-retours entre la France et la Croatie à bord de camions chargés de fournitures « quand des gosses se battent sous tes yeux juste pour survivre » ?
L’ancien militaire – il ne s’étendra pas trop sur ce passé – troque sa tenue civile pour un treillis. Mais où s’engager ? Sous l’uniforme de la HOS (Hrvatske Obrambene Snag, Force de Défense Croate), une formation paramilitaire d’extrême-droite, bras armé du Parti Croate du Droit ? « Je suis allé les voir, ils m’ont donné l’impression de mythos archétypiques avec leur équipement rutilant, leurs mitaines en cuir et leurs Ray-Ban », se souvient Jacques, qui avoue au passage s’être lourdement trompé sur leur compte : « Au combat, ils étaient courageux même si je ne partageais pas leur idéologie ». Ce sera finalement la ZNG (Zbor narodne garde, Garde nationale croate), embryon d’armée sous-équipée, constituée « de peintres en bâtiment, de boulangers, de pères de famille sans expérience militaire qui essayaient de résister comme ils pouvaient au rouleau-compresseur serbe ».

Cette guerre d’amateurs est aussi une affaire de bricolage, Jacques – alias « Paul Tramoni », le nom sous lequel il s’engage – ne tardera pas à s’en apercevoir. Pour tout armement, il perçoit un pistoletmitrailleur allemand datant de la Seconde Guerre mondiale, royalement approvisionné de huit cartouches, pas même de quoi tirer une honnête rafale. Le reste est à l’avenant. « Tu gardais tout sur toi de peur de te le faire piquer pendant ton sommeil : casque, rangers, même ton arme individuelle. On tournait à trois sur une kalach »...
Le casernement se fait à la bonne franquette : dans des maisons abandonnées, désertées, sans grand confort.
Le volontaire corse n’aura pas trop le temps de se lamenter : quinze jours après avoir revêtu sa tenue de camouflage, il participe aux premiers combats, début novembre 1991, alors que les Croates tentent de desserrer l’étau serbe au cours d’une contre-attaque dans le centre du pays qui leur permettra de récupérer près de trois cents kilomètres carrés après cinq jours de combats acharnés.

Pendant ce temps, la situation de Vukovar – assiégée depuis l’été et noyée sous un déluge de bombes – tourne au désespoir. Impuissant malgré des opérations de harcèlement entre Nustar et Vinkovci pour tenter de venir en aide aux assiégés, Jacques assiste à la chute de la ville-martyre le 18 novembre après quatre-vingt sept jours de siège pendant lesquels près de 10 000 obus l’ont transformée en champ de ruines. Plus tard, il apprendra la mort de Jean-Michel Nicollier, un autre volontaire français croisé peu avant et exécuté comme 239 autres blessés de l’hôpital de Vukovar.
La guerre en pointillés
Pour s’être battu les armes à la main, « Jack » ne surjoue pas les bêtes de guerre : « Il n’y a pratiquement pas eu de corps-à-corps, ça se passait de ligne à ligne, à 200 – 300 mètres de distance. Le but était de prendre une position et la tenir. »
Quand ils mènent des opérations ponctuelles, pour quatre à cinq jours de front, les combattants peuvent ensuite regagner une zone plus calme avant de remonter en ligne.
Une sorte de guerre en pointillés. En tout cas, largement de quoi se fabriquer quelques mauvais souvenirs et autant de cauchemars qui hanteront Jacques pendant des années, comme cet épisode qui voit « trois soldats, des gamins partis chercher des photos de famille dans leur maison abandonnée. Ils sont tombés sur des miliciens serbes qui les ont découpés en lanières ».
Jacques se souvient aussi des médias français : « Une horreur, ils cherchaient du nazi.
Tu leur disais que tu ne l’étais pas, tu n’existais plus à leurs yeux. » Mais tout de même, les – nombreux – militants néo-fascistes français et étrangers engagés au côté des Croates, les nostalgiques de l’Oustacha, le mouvement pro-hitlérien d’Ante Pavelic ?
Jacques ne cache pas son passé de « militant nationaliste français ». Dit en être en revenu, et depuis longtemps – ce qui ne l’empêche pas d’avoir publié une tribune sur le site « Corsica Patria Nostra », pas exactement classé à gauche – et espère désormais « mourir en ayant vu la Corse indépendante ». Mais à l’époque, jure-til, il combat d’abord par antimarxisme et pour soulager un peuple « démuni de tout, qui se faisait étriller en plein coeur de l’Europe sans que personne ne lève le petit doigt ».

« Nous avons tout fait pour faire expulser les fafounets parisiens, les recalés, les barjots et les néo-nazis de la ligne de front.
On n’avait pas besoin d’eux, on ne les voulait pas », affirme-til aujourd’hui en enfonçant le clou. « De toute façon, nous cherchions des combattants, pas des idéologues à la con. » Fin 91, victime d’une infection, il regagne la France avant de retourner combattre début 1992. Les instances européennes reconnaissent sa patrie d’adoption en janvier. Les opérations militaires se font plus sporadiques, parfois de simples accrochages. Affecté à la 113e brigade, en Dalmatie, il maintient les positions de la nouvelle HV (Hrvatska vojska) l’armée de l’état croate et participe à quelques missions contre les forces serbes.
Les 21 et 22 juin, la première grande offensive menée par les Croates se déroule au cours de la bataille du plateau de Miljevci.
Affecté à un groupe antichars, Jacques participe à l’assaut qui voit la HV reprendre aux Serbes plusieurs villages croates, à un contre cinq, avant de s’infiltrer de vingt-cinq kilomètres dans les lignes. Ensuite, c’est un retour en France puis un nouvel épisode en Bosnie-Herzégovine cette fois, où il ne goûte guère « les petits chefs locaux, plus voyous qu’autre chose ».
Début 1993, après avoir visité « pratiquement tous les fronts de Croatie », il est démobilisé et regagne ses foyers. La guerre - « une saloperie malgré tout » -, « sa » guerre est terminée.
Matricule 001
Vingt-cinq ans plus tard, que reste-t-il de l’épopée croate de « Legendo », le surnom que lui avaient donné ses camarades ?
Une poignée de souvenirs, quelques photos et une courte vidéo où Jacques Nicolaï, en treillis, grille clope sur clope et sourit à la caméra.
Pour le reste, l’ancien volontaire se retrouve lesté d’un solide paquetage de désillusions. « La Croatie est devenue une sorte de dictature capitaliste inféodée à l’Europe. Quant aux anciens combattants étrangers, la population est avec nous à 150% mais les pouvoirs publics ne nous ont toujours pas reconnus, nous n’avons aucun monument aux morts, pas même un endroit où déposer une gerbe de fleurs. »
Pour essayer de remédier à cet oubli mâtiné de mauvaise c o n s c i e n c e , Jacques a participé à la création de l’USDDR (Udruga Stranih Dragovoljaca Domovinskog Rata, Association des volontaires étrangers de la guerre patriotique) qui recense les combattants étrangers ayant participé aux opérations militaires en Croatie et en Bosnie entre 1991 et 1995. Sa carte porte le matricule 001.

Des ‘‘Affreux’’ aux ‘‘contractors’’
Comme Jacques Nicolaï, ils sont quelquesuns, Corses d’origine ou d’adoption, à avoir guerroyé sous des cieux plus ou moins exotiques – rarement pour les mêmes raisons. Des « grands anciens » comme Armand Ianarelli, ex-légionnaire passé par l’OAS avant de se jeter à corps perdu dans la fournaise du Biafra, la matrice des « Affreux », le surnom que se donne la fi ne fl eur du mercenariat européen en Afrique. Ianarelli – dont on dit qu’il offi cia aussi comme garde du corps de Madame Claude – deviendra au fi l du temps l’un des missi dominici les plus infl uents et les plus discrets d’Afrique, intime du président centrafricain François Bozizé avant de tomber en disgrâce en 2013 et être chassé du pays.
D’autres ont repris ce fl ambeau. Par idéal ou pour l’adrénaline et le goût de l’aventure. Et parce que le métier de « contractor » - salarié d’une SMP, une société militaire privée – se vit désormais comme une carrière à part entière. Ainsi de ce jeune quadra, fi ls de bonne famille de la région bastiaise et – dixit une connaissance – « véritable anomalie généalogique dans une lignée de juristes ». Encore en activité, joint alors qu’il se trouve à l’étranger, il refusera abruptement d’évoquer son parcours : « Rien de personnel mais par principe, je reste loin des journalistes ».

Prudents, les « contractors » préfèrent éviter les foudres d’une législation devenue autrement plus restrictive que par le passé – quoique d’une effi cacité douteuse – surtout lorsqu’ils sont insulaires et ne souhaitent pas trop que leur patronyme se retrouve accolé à l’épithète toujours aussi infamant de « mercenaire ». Pour sa famille, Stéphane Zannettacci n’en était pas un. Pour ses amis d’extrême-droite, il est même devenu l’icône fl amboyante d’un engagement sans concession. Une gloire qu’il n’a guère eu l’occasion de savourer.
Une icône de l’extrême-droite
C’est un tombeau sans apparat posé sur une parcelle de terre avec vue imprenable sur le golfe du Peru, à Cargèse. On y accède par une volée de marches que veille un imposant fi guier de Barbarie, à deux pas de la route qui mène à Piana.
Gravé sur le marbre du caveau, le nom Zannettacci dit les origines de ceux qui y reposent. Mais rien – ni épitaphe, ni plaque commémorative - n’indique le destin tragique d’un jeune homme mort à 22 ans, le ventre labouré d’éclats de grenades, dans l’attaque d’un camp palestinien au Liban. Stéphane Zannettacci « martyr » foudroyé au nom d’un idéal – son éphémère combat au sein des Phalanges chrétiennes puis dans les Tigres de Camille Chamoun, pendant « une guerre, dit sa soeur Marie-Eve, qui n’était pas la sienne. » Les Zannettacci, c’est d’abord une histoire de famille, celle de Grecs de Cargèse qui quittent la Corse pour s’établir en Algérie aux premiers jours de la colonisation.
Un aïeul instituteur, un oncle mort pendant la Seconde guerre mondiale en faisant sauter un train allemand, un père surtout – Charles, dit « Kanou », fi gure de baroudeur, tour à tour journaliste, pilote de l’Aéropostale, prospecteur. Engagé dans l’OAS, il sera condamné emprisonné à la Santé puis deux ans à l’Ile-de-Ré. Le petit Stéphane, né en 1954 au Maroc, le visite au parloir avec sa soeur, née d’une autre union, et en conçoit une obligation : épater ce père aventureux que l’on surnommait le « Saint-Ex de Cargèse ». Son enfance, il la passe en banlieue parisienne, élevé par une mère « très engagée à gauche ».

L’été, le gosse rieur, devenu ado intrépide, regagne le berceau familial pour des vacances casse-cou, multipliant les occasions de se couvrir de plaies et de bosses.
A rebours des idéaux de sa génération autant que par anticonformisme, il commence aussi à témoigner de nets penchants droitiers, lit Robert Brasillach, les Hussards puis, parvenu en fac, milite dans les rangs des organisations étudiantes d’extrême-droite, au GAJ (Groupe action jeunesse) notamment, une organisation étudiante violemment anticommuniste créée en 1973, qui présente la particularité de s’être également heurtée à d’autres mouvements de la droite radicale comme le GUD (Groupe Union Défense) très implanté à la faculté d’Assas.
Zannettacci s’y forge une réputation de dur, de castagneur, fait volontiers le coup de poing contre les « gauchos » de Nanterre – tout en faisant cause commune avec certains trotskistes contre les frères ennemis du GUD ! L’époque est aux sigles, aux scissions, aux sous-scissions. Stéphane y militera un temps, sera grièvement blessé au crâne à l’occasion de bagarres devant le lycée Buffon et la fac d’Assas, à Paris. Puis il paraîtra s’assagir et entamera une carrière de plongeurscaphandrier à Marseille – parce qu’il faut bien vivre et que sa mère, employée à la FNAC, ne dispose que demaigres ressources.
C’est par l’intermédiaire de son père qu’il trouve une place de plongeur-scaphandrier à Marseille pour une société de forage. Il y travaille quelques semaines avant un accident qui l’éloigne du Midi. A cette époque, le jeune homme projette déjà de partir se battre au Vietnam, où Saïgon ne tarde plus à tomber.
Exit l’Asie, bienvenue au Liban. Là-bas, les Phalanges Chrétiennes accueillent les volontaires étrangers, français notamment, dont la plupart sont issus de la nébuleuse « nationaliste ». Le jeune cargésien mûrit son plan, n’en dit rien à sa soeur, assistante sociale au Dispensaire antipaludéen de Bastia, à laquelle il rend souvent visite. Il se fait également détailler les fi lières d’acheminement via Chypre par ses « camarades » qui ont déjà effectué un séjour au pays du Cèdre.

Fin juin 1976, après avoir embrassé une dernière fois sa fi ancée Brigitte, il s’embarque pour ne jamais revenir. Trois semaines plus tard, sans avoir reçu de réelle formation militaire, il tombe pendant l’attaque du camp retranché de Tel-al-Zaatar, une enclave palestinienne en territoire chrétien. Sa soeur l’apprendra quelques jours tard, elle peine à comprendre les motivations d’un frère « que tout le monde adorait, qui n’était pas particulièrement pratiquant mais qui voulait peut-être attirer l’attention d’un père plutôt absent ». Dans la nuit du 10 au 11 août 1976, le corps de Stéphane est rapatrié à Cargèse. Sa mère n’assistera pas aux obsèques. A des proches, elle dira : « C’est vivant que je voulais son corps, pas mort ». Le père se claquemurera dans le silence et mourra au début des années 80 après avoir travaillé pour des sociétés off-shore dans le sud-est asiatique.
Du bidonville de Nanterre aux palaces
De son passé de soldat de fortune, « Simon », lui, ne possède aucun souvenir à part quelques clichés et six cicatrices circulaires sur le corps – les traces laissées par des blessures. Confortablement assis à la terrasse d’une paillote de la rive sud du golfe d’Ajaccio, ce colosse au regard couleur de glacier, à la voix é tonnamment douce, dévide l’écheveau d’une autobiographie digne d’un roman d’aventures. Singulier contraste offert par la quiétude de cette soirée d’été, les sourires de jolies serveuses et le récit poignant d’une existence entamée dans le bidonville de Nanterre, poursuivie tant bien que mal sous les auspices de l’Assistance publique avant le tournant d’une fi n d’adolescence tumultueuse. 1987. « Simon » a 16 ans et s’engage frauduleusement dans la Légion étrangère. Il y passera onze années, culminera au grade de sergent avant de quitter cette troupe d’élite.
Le retour à la vie civile est plus dur que prévu et, pour ainsi dire, peu glorieux pour celui qui s’imaginait auréolé du prestige du baroudeur.
« Dans l’armée, ta valeur se voit sur ta tenue : tes brevets, tes décorations, ton grade.
Dans le civil, j’étais de la merde. Je ne savais rien faire d’autre que me battre, je m’étais engagé à seize ans, je n’avais ni bac ni diplôme mais j’étais un expert en violence avec une immense capacité de nuisance physique. » Après quelques mois d’errances, le voilà embauché par une société privée comme garde du corps d’un milliardaire russe, affecté à la garde d’un imposant portail qui commande l’entrée d’une vaste propriété dans le sud de la France.

En costume sous des chaleurs caniculaires, l’ancien sous-off au béret vert voit le temps s’écouler lentement, cantonné à un rôle de planton qui ne lui sied guère. Il sera plus tard affecté à la garde des enfants du magnat, puis de son épouse, ancien mannequin qui apprécie modérément la présence de cet encombrant chaperon à ses côtés.
"Je roulais des heures dans Ajaccio.
Au moindre accrochage, je pouvais tuer le mec en face"
Le moins que l’on puisse dire basques de ses «clienst», il écume Istanbul, Londres, les Etats-Unis, Dubaï. Termine sur les rotules, « défoncé par le jet-lag » mais se console avec une paie à laquelle le gosse du bidonville de Nanterre n’aurait jamais osé prétendre : entre six et huit mille euros par mois. 12 000 euros Après trois ans de ce régime, son contrat de bodyguard prend fi n. Direction le Continent africain, où son employeur l’expédie pour un nouveau job.
Changement de décor. De standing aussi. Terminé, les palaces et les plages de rêve. Dans ce pays d’Afrique centrale, le voilà chargé d’une mission autrement délicate que veiller au bien-être d’une ancienne reine de beauté : à la tête de quatre-vingt soldats, il doit contenir l’avancée éventuelle de rebelles, devient l’otage de confl its géopolitiques qui le « dépassent totalement » et où la France, comme il se doit, joue un trouble jeu. « Il y avait un mec là, un autre là et moi au milieu, » montre le doigt de Simon sur la nappe blanche où sont disposées des assiettes de poisson grillé. Dans cette province frontalière, il « monte au carton tous les jours » et découvre les subtilités africaines, les offi ciers supérieurs nommés parce qu’ils appartiennent à telle ethnie ou jouissent d’une excellente réputation de marabouts.

12 000 euros ans les primes
Le guerrier renoue avec l’épreuve du feu, ne s’en trouve pas trop mal. « Je me sentais vivant, je faisais ce pourquoi on m’avait formé et je commandais.
Moi, un petit sous-off de la Légion, je me retrouvais à bouffer le couscous avec des dignitaires africains ! » Son boss, rarement à court d’idées, a même le front de négocier un nouveau contrat, en sus : contrecarrer les incursions de braconniers qui déciment les populations d’éléphants et lutter contre le banditisme de grand chemin des « coupeurs de route ». Sa campagne se terminera mal. Bousculé pendant une offensive, il est blessé, fuit en bicyclette, traverse une frontière et se réveille quelques jours plus tard menotté à un lit d’hôpital. Dans une brume de sédatifs, il entend à peine les mots vociférés en boucle par un diplomate français : « Dès que vous rentrez en France, c’est la prison ! »
Grâce à des complicités dont il ne dira rien, Simon parvient tout de même à se faire la belle. Et reprend aussitôt du service. En Côte-d’Ivoire, notamment, où grassement payé via des transferts en Suisse, il ne sait « ni pour qui ni pour quoi » il combat, côtoie des « confrères » sud-africains venus relever un premier contingent de mercenaires commandés par un ex-caporal chef de la Légion, dont les prestations n’ont pas été jugées satisfaisantes par Laurent Gbagbo, alors maître d’un pays ravagé par le chaos. La fréquentation de ces « clowns racistes et alcoolos » achève de convaincre Simon de changer d’air.
Ca tombe plutôt bien : depuis quelques mois, les chiens de guerre ont un nouvel eldorado. L’Irak. Un vrai pays de cocagne. Pour appuyer l’armée américaine dépassée par les événements, Washington fait appel à ces fi rmes spécialisées dans l’assistance militaire.

La solde moyenne, pour peu qu’on puisse faire valoir quelque compétence en la matière, s’établit aux alentours des 12000 euros mensuels, sans les primes - une paie à la hauteur des risques encourus dans un pays totalement hors de contrôle. Simon va le découvrir en convoyant matériel et VIP d’une base militaire à l’autre. Embuscades. P e r t e s élevées. La guerre exhibe son masque grimaçant - « une monstruosité ». Pas de quoi décourager Simon, qui met le cap sur l’Afghanistan en 2004. « Là, je me suis dit que je ne reviendrais jamais vivant de cet enfer ». Affecté à la protection de convois dans le nord-est du pays, il éprouve un choc. Rien à voir avec la guerre et ses atrocités : Simon parle de culture.
« L’Afghanistan a changé ma vie, ma vision des choses. Les gens que j’ai rencontré là-bas m’ont bouleversé. On parle de valeurs corses ? Mais les Afghans ont mille fois plus de valeurs corses que les Corses. » Il y apprend la méditation, ce qui n’est pas de trop quand on risque sa peau au quotidien. Au total, il y effectuera plusieurs séjours jusqu’en 2007, date à laquelle il raccroche les gants pour se consacrer à des missions moins périlleuses, comme la sécurisation de mines d’or en Guinée.
Puis c’est le retour au bercail, dans l’île où l’attendent sa compagne et ses deux enfants nés au coeur de ses années de plomb.
Syndrome post-traumatique de guerre
Comment se réadapter à la vie civile, entre les courses du samedi et les factures à honorer ? Simon tente de se fi xer sans y parvenir tout à fait, la faute au PTSD - pour Syndrome post-traumatique de guerre. Traduction de l’intéressé : « Je devenais dingue, au sens premier du terme. Je roulais des heures dans Ajaccio.
Au moindre accrochage, je pouvais tuer le mec en face. Le voisin qui démarrait sa tondeuse, je cherchais un abri » Son couple se délite lentement jusqu’au coup de folie : en 2008, il fonce au volant de sa voiture dans la devanture d’une brasserie ajaccienne où travaille sa compagne. Case prison. « Le juge m’a dit ‘Trouvezvous un travail normal, monsieur’. Mais c’est quoi, pour moi, un job normal ? Je ne sais que me battre... » Pour les anciens mercenaires, pas de cellule psychologique et personne à qui parler.
C’est qu’entre-temps, une loi a été votée pour lutter contre le mercenariat.

Pour Simon, « Si j’ouvrais ma gueule, j’étais bon pour la taule. » Il lui faudra des années avant de pouvoir se reconstruire, retrouver un semblant de vie normale, ne plus sursauter à la moindre pétarade de moteur. Simon est un grand blessé. A vie. De sa fréquentation assidue des champs de bataille, il a conservé les séquelles qui minent souvent les anciens combattants, à quoi s’ajoute la crainte irraisonnée d’une mort absurde : « Parfois, laisse tomber le gaillard, les yeux soudain traversés d’une lueur d’inquiétude, je me dis que je vais crever comme une merde, ici, écrasé par une deux-chevaux en traversant devant le camping Le Sud. » Alors que le soleil s’est couché depuis longtemps sur le Golfe d’Ajaccio et que les serveuses dessinées au pinceau baillent poliment près du comptoir, l’ancien mercenaire s’interrompt brusquement. Trop de souvenirs trop brutalement remontés à la surface d’une mémoire encore trop à vif.
Trop d’images – comme celle-ci, qui le persécute encore : le chauffeur pakistanais d’un convoi, silhouette rongée par les fl ammes après un accrochage, se précipitant vers lui pour lui demander de l’aide et qui fi nit par tomber à ses pieds, criblé de balles.
La voix s’étrangle. La tête se détourne. Poings crispés audessus de la nappe blanche, Simon mettra plusieurs secondes à reprendre ses esprits, à tenter de dompter l’émotion qui le submerge. « Je ne suis pas quelqu’un de violent, lâche-t-il comme une évidence après avoir étouffé un sanglot. Mais ma vie a été violente. Très violente. » La vie d’un soldat d’infortune