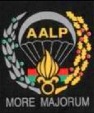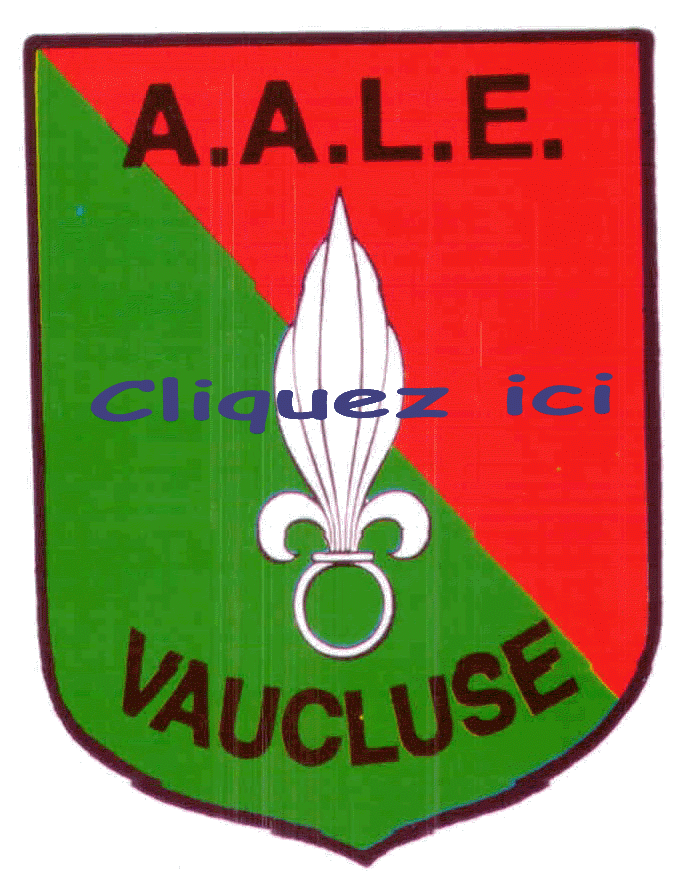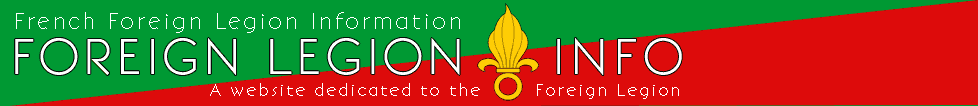par Jean-Philippe LIARDET, dr
"Vous ne vous arrêterez pas dans vos succès ; je ne m'arrêterai pas non plus, dussé-je inventer pour vous de nouvelles récompenses."
Le général Pétain aux légionnaires, après avoir décoré leur Drapeau de la croix de la Légion d'honneur. 27 septembre 1917.
Le déclenchement du conflit
Le jeu des alliances
Avec la démission de Bismarck en 1890, l'Allemagne adopte une politique extérieure plus agressive qui va servir la volonté de revanche française. La Russie puis la Grande-Bretagne, inquiètes de l'évolution de la situation, se rapprochent de la France. En 1907, les trois pays forment la Triple Entente.
L'Allemagne se retrouve alors encerclée avec pour seule grande puissance alliée l'Autriche-Hongrie. L'assassinat de l'héritier du trône le 28 juin va mettre en marche un engrenage tragique. L'archiduc d'Autriche Franz Ferdinand et son épouse Sophie sont assassinés au cours d'un voyage officiel à Sarajevo par une organisation terroriste serbe, la "Main Noire".
Forte du soutien de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie durcit sa position envers la Serbie et formule dans un mémorandum des demandes irréalisables dans les délais indiqués ou portant atteinte à la souveraineté serbe. La Serbie, qui n'est pas impliquée dans l'attentat, répond habilement au mémorandum et demande un arbitrage international pour certains points.
Les plans
La tension augmentant, les principaux acteurs entament une mobilisation partielle et conflit devient inévitable. Le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Dans les jours qui suivent les mobilisations deviennent totales. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, deux jours plus tard elle fait de même avec la France. Le lendemain, la Grande-Bretagne, indignée par la violation de la neutralité belge par l'Allemagne lui déclare la guerre à son tour.
La stratégie allemande repose sur le seul plan Schlieffen. Il s'agit d'envelopper l'aile gauche française par un mouvement tournant à travers la Belgique. Le grand état-major allemand espère ainsi remporter une victoire décisive à l'ouest en six semaines pour pouvoir reporter ses forces à l'est contre la Russie plus lente à mobiliser.
La France voit dans ce conflit la possibilité de reprendre les territoires perdus en 1871. Elle fait le choix d'une offensive en Lorraine coordonnée avec celle de la Russie en Prusse Orientale.
Les premières semaines de combat
Toutes les prévisions s'avèrent vite erronés. La doctrine française qui repose sur le choc est complètement inadaptée. Les mitrailleuses et l'artillerie allemandes creusent les rangs des fantassins français qui montent à l'assaut baïonnette au canon.
Le plan Schlieffen offre presque la victoire à l'Allemagne. Bien épaulés par le Corps Expéditionnaire Britannique les Français raidissent leur défense sur la Marne alors que Paris semblait à portée des Allemands. Une contre-attaque décisive permet de stabiliser le front. Chaque camp tente alors de contourner par le nord le flanc dégarni de son ennemi. Cette course effrénée à la mer débouche sur l'édification d'une ligne de front continue.
Les Russes sévèrement battus à Tannenberg, l'issue du conflit apparaît désormais incertaine et longue à se dessiner. Cette guerre d'usure nécessite de gros effectifs, notamment pour compenser les pertes terribles des premières semaines de combat.
La Légion retrouve la métropole
L'Empire au secours de la métropole
L'instauration progressive du service militaire universel (lois de 1872, 1889, 1905 et 1913) ne suffit pas à compenser la supériorité numérique de l'armée allemande. A la veille de la guerre, les conscrits servent 3 ans (contre 2 ans depuis 1905) dans l'armée d'active puis sont affectés pendant 11 ans à la réserve.
Le potentiel démographique moindre et déclinant de la France rend illusoire toute tentative de parvenir à la parité. Ce rapport de force défavorable guide la politique étrangère de la France entre 1871 et 1914 et conditionne le rapprochement avec la Grande-Bretagne et la Russie.
L'expansion coloniale française s'est fait avec un support limité en nombre et dans le temps des unités métropolitaines. La Légion étrangère profite de cette situation car l'Armée d'Afrique doit non seulement assurer le maintien de l'ordre en Afrique du Nord mais aussi servir de réserve pour les campagnes coloniales dans les autres parties du monde.
Par ailleurs, l'idée de faire appel aux ressources humaines de l'Empire français trouve des ardents défenseurs comme le général Mangin qui préconise l'emploi de la "force Noire" sous la forme d'un corps d'armée sénégalais. L'idée fait lentement son chemin dans l'esprit du haut-commandement. Après les lourdes pertes des premières semaines, le phénomène s'amplifie rapidement. Les unités de la Coloniale ou de l'armée d'Afrique constituent rapidement des divisions entières ou renforcent les divisions métropolitaines.
L'intégration des volontaires étrangers
Dès le déclenchement des hostilités, les volontaires étrangers affluent en nombre pour servir dans les rangs de l'Armée française. Quelque peu méfiante devant ces volontaires, elle cherche à en affecter le plus grand nombre à la Légion étrangère. Parmi les 52 nationalités représentées, on trouve essentiellement des Russes, des Italiens, des Roumains, des Suisses, des Belges, des Anglais et des Américains.
Si certains volontaires n'apprécient guère cet engagement forcé dans la Légion étrangère, celle-ci n'est guère plus satisfaite devant cette augmentation trop brutale de ses effectifs.
En 1914, les deux régiments étrangers comptent 5 bataillons au Maroc, 4 en Algérie et 3 au Tonkin. Ceux d'Algérie reçoivent l'ordre d'envoyer la moitié de leurs effectifs en France pour servir d'ossature à 4 nouveaux régiments : les 2e, 3e et 4e régiments de marche du 1er étranger et le 2e régiment de marche du 2e étranger. L'encadrement doit néanmoins être complété avec des réservistes. Ainsi, les cadres du 3e régiment sont presque tous des pompiers de Paris sans grande compétences militaires. Par ailleurs, les légionnaires allemands ou autrichiens doivent rester outre-mer, conformément au droit international.
A la fin du mois d'août, les légionnaires du 1er étranger débarquent dans le sud de la France. Les volontaires sont rapidement incorporés avant que les unités remontent vers la ligne de front. Certains contingents nationaux sont si nombreux que le principe de l'amalgame se trouve remis en question. Ainsi, le 4e régiment de marche est entièrement composé d'Italiens qui combattent sous le commandement du lieutenant-colonel Giuseppe Garibaldi.
Les "Italiens" engagés les premiers
C'est justement le 4e de marche qui monte au feu le premier. En cette fin d'année 1914, il se trouve engagé près du bois de Bolante en Argonne. Le 26 décembre à l'aube, les légionnaires gagnent leurs lignes de départ alors que les obus français sifflent au-dessus de leurs têtes. Puis le barrage d'artillerie cesse et ils s'élancent dans les premières lueurs du jour.

Le champ de bataille est très vite noyé sous un déluge de fer et de feu. Les quelques survivants de la première vague d'assaut réussissent néanmoins à prendre pied sur les positions ennemies. D'autres légionnaires les renforcent et les Allemands refluent en désordre. Fébrilement, les légionnaires retournent les fortifications pour repousser l'inévitable contre-attaque. Mais une heure plus tard le 4e régiment de marche reçoit l'ordre de se retirer car les autres unités n'ont pas progressé.
Une seconde attaque est lancée le 5 janvier, à Courtes-Chausses. Après avoir fait sauter 8 mines sous les positions ennemies, les légionnaires s'emparent de deux lignes de tranchées. Les combats dans le bois de Bolante se poursuivent encore pendant trois jours sans qu'il soit possible de percer.
Ces deux opérations inutiles et mal conçues coûtent 429 hommes au régiment. Le sous-lieutenant Bruno Garibaldi, frère du chef de corps, et l'adjudant-chef Costante Garibaldi, un de ses proches, sont parmi les tués. Au mois de mars l'unité est dissoute. Les Italiens obtiennent en effet la permission de rejoindre leur pays qui va entrer en guerre au côté de la France.
Une situation militaire difficile
Les autres unité de la Légion étrangère vont bénéficier d'une meilleure préparation. Le centre d'entraînement de la Légion se trouve à Valbonne, un village proche de Lyon. Les difficultés sont nombreuses : l'encadrement manque de qualité et les nombreuses nationalités ne facilitent pas l'homogénéité des unités. Par ailleurs, l'expérience des combats outre-mer n'est que de peu d'utilité dans les tranchées. Mieux armée et mieux équipé, le combattant allemand manifeste une réelle supériorité d'autant qu'il mène pour le moment des combats défensifs. En effet, le grand quartier général allemand cherche à faire la différence à l'est, contre la Russie.
Joffre décide alors de prendre l'offensive malgré le manque d'artillerie lourde et de pièces de tranchées. En outre, les stocks de munitions sont trop insuffisants pour conduire des barrages d'artillerie efficaces. Les attaques à venir reposent donc essentiellement sur l'allant du fantassin français. Les légionnaires, comme les autres "poilus" vont payer un lourd tribu à cette stratégie inadaptée.
Artois 1915
"Les ouvrages blancs"
La mise sur pied du 2e régiment de marche du 1er étranger ne se fait pas sans problèmes. Sous les ordres du colonel Pein qui s'est distingué dans le Sud-Oranais au début du siècle, Tchèques, Polonais et Grecs forment des unités distinctes et arborent leur drapeau national.
Affecté à la 1ère brigade de la division marocaine, le régiment quitte la Champagne pour être engagé en Artois. Le 9 mai 1915 au matin, les quatre bataillons étrangers sont en position devant leur objectif : la côté 140, une des élévations de la crête de Vimy appelée "les ouvrages blancs". La préparation d'artillerie dure 4 heures.

A dix heures, les légionnaires jaillissent des tranchées derrière le lieutenant-colonel Cot qui a pris le commandement la veille, en remplacement du colonel Pein nommé à la tête de la brigade. La première ligne ennemie est rapidement atteinte puis dépassée mais les pertes s'accroissent rapidement. La plupart des officiers et des sous-officiers sont mis hors de combat. Le lieutenant-colonel Cot est blessé, les trois chefs de bataillons - les commandants Noiré, Muller et Gaubert - sont tués. Les unités avancent dans le plus grand désordre mais les légionnaires conservent leur allant et bousculent les défenses allemandes. A 11 heures 30, la côte 140 est entre leurs mains.
Sur la droite, le 156e régiment d'infanterie n'a pu atteindre son objectif et laisse le flanc du régiment étranger sans protection. Des autobus réquisitionnés à Lille amènent déjà les renforts allemands au plus près de la ligne de front. Le colonel Pein rejoint les légionnaires pour organiser la défense de la colline. Il tombe peu après. L'absence de cadres et le manque de mitrailleuses ne facilitent pas la tâche des défenseurs, d'autant que dans leur dos subsistent des poches de résistance allemandes. Une violente contre-attaque soutenue par de l'artillerie lourde contraint les légionnaires au repli car les renforts n'arrivent pas. Vers 15 heures, ils abandonnent la côté 140 mais conservent néanmoins une partie du terrain conquis dans la journée.
Les pertes s'élèvent à 50 officiers et 1.889 hommes. Le 2e régiment de marche est réduit de moitié. Le commandant Collet doit le réorganiser en deux bataillons.
Souchez
Le 16 juin, le régiment est de nouveau engagé dans le même secteur. Le 4e régiment de tirailleurs algériens mène l'assaut qui débute juste après midi. Le 2e de marche ne compte en effet plus que 67 officiers et 2.509 hommes.
Les mitrailleuses allemandes déciment les légionnaires qui traversent le ravin de Souchez, situé au pied de la côte 119. Une nouvelle fois le barrage d'artillerie s'avère inefficace. Les positions allemandes sont encore intactes et les obus français tombent même en grand nombre sur les tirailleurs et les légionnaires. Cette fois-ci cependant, des groupes spécialement équipés nettoient avec efficacité les tranchées à la grenade et au couteau.
Vers 18 heures, les Allemands repoussent les zouaves qui couvrent le flanc gauche du 2e de marche. Toute la nuit, les contre-attaques se poursuivent, soutenues par de violents tirs d'artillerie. Au matin les barrages s'intensifient. La division marocaine doit alors décrocher, faute de soutien. Le retour par le ravin de Souchez creuse encore les rangs de la Légion qui perd au total 21 officiers et 624 hommes tués, blessés ou disparus.

Crise et réorganisation
Une chute du moral
Les lourdes pertes subies lors de ces deux attaques suscitent une crise du moral dans les unités engagées. La Légion étrangère n'y échappe pas. Plus que les pertes, ce sont le manque de préparation et les maigres résultats de ces opérations qui donnent l'impression à la troupe de faire des sacrifices inutiles.
Plus spécifiquement, la Légion étrangère souffre de l'abandon du principe de l'amalgame. Lors de l'attaque du 16 juin, le bataillon grec refuse de monter à l'assaut car les hommes déclarent s'être engagés pour combattre les Turcs. Il faut l'intervention de lieutenant-colonel Cot pour les faire avancer. Déjà indiscipliné à l'arrière, ce bataillon sera par la suite dissous, les meilleurs éléments rejoignant le bataille de la Légion engagé aux Dardanelles.
Mais, au-delà de ce cas particulier, subsistent d'autres problèmes : la mauvaise réputation faite à la Légion étrangère par ses détracteurs suscite de nombreuses réticences chez les engagés affectés de force dans ses rangs; le retour dans leur pays des volontaires les plus motivés laisse un trop grande proportion d'indésirables ; enfin, l'encadrement affecté à la Légion reste de médiocre qualité, d'autant que ses meilleurs officiers ont demandé leur transfert dans des unités métropolitaines dès le début de la guerre, de peur de ne pas être engagés en métropole.
Réorganisation
Le retour à l'amalgame permet de résoudre une partie des problèmes. Le 3e régiment de marche du 1er étranger est dissous le 13 août après une séjour sur la Somme où les pertes au feu restent minimes. En effet les Russes, les Belges et les Italiens qui le composent retournent pour la plupart servir dans leurs armées nationales. Les autres légionnaires viennent combler les pertes du 2e régiment de marche du 1er étranger, aggravées par les autorisations de transfert vers les unités métropolitaines ou l'artillerie.
Malgré tous ces handicaps, le 2e de marche du 1er étranger a néanmoins combattu avec bravoure. Le 13 septembre, il reçoit son drapeau et sa première citation à l'ordre de l'Armée : "Chargé, le 9 mai, sous les ordres du lieutenant-colonel Cot, d'enlever à la baïonnette une position allemande très fortement retranchée (Ouvrages Blancs), s'est élancé à l'attaque, officiers en tête, avec un entrain superbe, gagnant d'un seul bon plusieurs kilomètres de terrain malgré une très vive résistance de l'ennemi et le feu violent de ses mitrailleuses".
*
Artois 1915
La butte de Souain
Les deux derniers régiments de marche forment avec le régiment de marche du 4e tirailleurs algériens la 1ère brigade de la division marocaine. A la mi-septembre l'unité est transférée en Champagne où Joffre décide de lancer une nouvelle offensive.
La 1ère brigade passe sous les ordres du général Marchand, le héros de Fachoda, qui commande la 10e division coloniale. Le 2e de marche du 2e étranger est engagé le premier. Jusqu'à présent, il n'a tenu que des secteurs calmes dans la région de Reims puis de Paissy. Le 25 septembre, il gagne ses positions de départ sous une pluie diluvienne. Malgré l'inefficacité des tirs d'artillerie les légionnaires s'emparent de leur objectif : la butte de Souain.
Ce succès ouvre la voie à d'autres unités. Dans la nuit, les légionnaires doivent cependant rallier baïonnette au canon des hommes du 171e régiment d'infanterie qui se débandent. Malgré ses débuts prometteurs, l'offensive doit être stoppée en raison de la pénurie d'obus. L'opération vaut au 2e de marche du 2e étranger une citation à l'ordre de l'armée.

La ferme de Navarin
Le 28 septembre, les deux régiments de marche joignent leurs efforts dans le même secteur pour s'emparer de ferme de Navarin, proche de la butte de Souain. Les leçons meurtrières des précédents combats ont été retenues. Les légionnaires montent à l'assaut en file indienne, les sections disséminées sur le champ de bataille. Les premières lignes prises, les hommes les retournent rapidement pour résister aux contre-attaques allemandes.
Le principal centre de résistance ennemi, pourtant à peine distant de deux cents mètres, reste imprenable malgré plusieurs assauts sanglants. Les nids de mitrailleuses et les réseaux de barbelés sont en effet intacts. Les commandants Declève et Burel tombent à la tête de leurs bataillons. Le lieutenant-colonel Cot estime alors la mission impossible à remplir et demande l'arrêt de l'attaque. Son régiment a perdu 608 tués et blessés sur 2.003 hommes. Néanmoins, l'attention de l'ennemi se focalise sur les régiments étrangers qui se retranchent aux abords de sa position. D'autres unités en profitent pour le déborder par l'ouest, mais l'offensive finit par s'enliser.
Le 2e régiment de marche du 2e étranger accuse également de lourdes pertes dans ces opérations. Les combats de Souain et de la ferme de Navarin lui coûtent 14 officiers et 300 hommes tués ou blessés. Son chef, le lieutenant-colonel Leconte-Denis est blessé. Les deux régiments sont cités à l'ordre de l'armée pour leur action décisive.
Le RMLE
Sous un seul drapeau
Le 11 novembre, les deux derniers régiments de marche fusionnent pour former le Régiment de Marche de la Légion Etrangère (RMLE). Son drapeau est celui du 2e de marche mais il arbore les distinctions des deux unités. Le régiment compte 71 officiers et 3.115 légionnaires répartis dans trois bataillons. Le lieutenant-colonel Cot en assure le commandement.
Cette fusion consacre l'abandon de la pratique de l'enrôlement forcé des volontaires étrangers dans la Légion étrangère. Celle-ci n'en avait de toute façon ni les moyens ni la vocation. D'ailleurs, les effectifs passe d'environ 11.000 hommes avant la guerre à un maximum de 21.887 au début de 1915. Le corps n'a donc absorbé qu'un quart du total des volontaires étrangers. Le passage par la Légion, obligatoire sur le plan administratif, a semble-t-il généré une certaine confusion. Les demandes de transfert dans d'autres régiments ou dans l'artillerie sont en effet rapidement acceptées et certains engagés ne sont légionnaire qu'une heure ! En 1916, la Légion étrangère compte plus que 10.683 hommes dont 3.316 au RMLE.
Le retour aux sources
Cette réduction des effectifs et la crise du moral de l'année 1915 vont contribuer de manière décisive à faire du RMLE une unité d'exception.
La réputation acquise au bois de Bolante, en Artois et en Champagne donne une autre image de la Légion étrangère, auprès de l'armée et du grand public, mais aussi auprès des nouveaux engagés. Désormais, les volontaires sont des hommes qui ont décidé de rester à la Légion en sachant qu'elle va combattre comme troupe de choc. Ils acceptent également son mode de vie particulier. L'entente avec les anciens légionnaires s'en trouve considérablement améliorée.
Les légionnaires sont désormais considérés par le haut commandement comme des professionnels aguerris, capables de réussir des missions jugées impossibles. Si l'armée d'Afrique et les troupes coloniales bénéficient également d'une grande considération, la Légion étrangère possède une aura inégalée. Le 5 juin, la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre est décernée au RMLE.

Coûteuses et vaines offensives
Belloy-en-Santerre
Après les durs combats de l'année 1915, la division marocaine occupe des secteurs calmes dans la région de Roye-Lassigny ou elle complète son instruction. Pendant ce temps, les armées allemandes et françaises s'affrontent dans la gigantesque bataille d'usure de Verdun. Joffre décide de prendre l'offensive dans la Somme pendant que les réserves allemandes sont fixées. Il espère réduire un saillant dangereux qui pointe vers Paris ou, à tout le moins, attirer une partie des divisions allemandes engagées à Verdun ou susceptibles de l'être.
14 divisions françaises et 26 divisions anglaises prennent part à l'offensive. La préparation d'artillerie dure sept jours. L'assaut commence le 1er juillet 1916, sur une largeur de front de près de 40 kilomètres,.
Le RMLE se trouve placé en réserve avec la division marocaine. Les Allemands ont évacué leur première ligne et la réoccupent dès la fin du barrage d'artillerie. Les assaillants doivent faire face à un déluge de feu. Dans la zone des légionnaires, les troupes coloniales réussissent à s'emparer du petit village d'Assevillers.
Le RMLE reçoit alors la mission d'exploiter ce succès isolé. Le 4 juillet, il relève les coloniaux et le 39e régiment d'infanterie. Son objectif est le village de Belloy-en-Santerre, clef de voûte de la défense allemande dans le secteur. La position est puissamment fortifiée et bénéficie d'un glacis de près d'un kilomètre. La première vague d'assaut s'élance sur ce terrain découvert et rendu glissant par la pluie qui continue à tomber. La plupart des cadres sont mis hors de combat dès les premiers tirs. Les clairons sonnent le Boudin alors que les légionnaires reprennent leur avance. La deuxième vague finit par atteindre les premières maisons du village et s'empare de la position après deux heures de violents combats de rue.

Furieux, les Allemands amènent des renforts par camions et lancent contre-attaque sur contre-attaque. Les légionnaires tiennent pourtant bon jusqu'à l'arrivée de la relève, le matin du 6. Ils détiennent alors 750 prisonniers dont 15 officiers. Les pertes sont de 25 officiers et de 844 soldats sur les 62 officiers et 2.820 hommes engagés.
Mais si la 6e armée française remporte quelques succès, sur sa gauche les Anglais avancent moins vite. L'effort va se poursuivre jusqu'au 5 novembre sans plus de succès. Cette offensive permet néanmoins de soulager la pression ennemie sur Verdun où les troupes françaises réussissent à regagner une partie du terrain perdu dans la première moitié de l'année.
Période de transition
Durement éprouvé, le RMLE est envoyé au repos et à l'instruction dans l'Oise, près de Maignelay. Il occupe ensuite le secteur de Plessier-de-Roye puis regagne en fin d'année celui de Santerre où il reste pendant un mois. Le terrain est devenu méconnaissable : le village de Belloy et les bois alentours ont été entièrement rasés par les bombardements.
Pendant les mois suivants, le régiment alterne les périodes d'instruction et les participations aux travaux de préparation pour la prochaine offensive de printemps. En février, le lieutenant-colonel Duriez remplace le lieutenant-colonel Cot promu à la tête d'une brigade. Le nouveau chef de corps est un ancien du 1er étranger, ce qui facilite la passation de pouvoir.
Nouvelles stratégies pour 1917
Au mois de décembre 1916, le général Nivelle succède à Joffre, élevé au grade de maréchal. Confiant, il pense réussir une percée décisive en deux jours contre des armées allemandes usées à Verdun et sur la Somme. Les Anglais doivent lancer une puissante attaque depuis le sud d'Arras pendant que les Français concentrent leurs moyens sur un étroit secteur, au Chemin des Dames, à l'ouest de Reims. L'objectif de cette attaque en tenaille est d'isoler le saillant allemand.
Mal conservé, le secret de l'offensive est rapidement connu de l'ennemi. Celui-ci opte pour un retrait limité d'une quinzaine de kilomètres. Dans leur repli, les troupes allemandes pratiquent la politique de la terre brûlée en ravageant entièrement les zones abandonnées. Avec une ligne de front ainsi raccourcie, les Allemands peuvent placer en réserve plusieurs divisions. Par ailleurs, la révolution russe permet de divertir quelques unités du front de l'est.
Contre l'avis de la plupart des membres de son Etat-Major, Nivelle choisit de maintenir son offensive. Il réussit à convaincre le président du Conseil, Poincaré, et les parlementaires qui souhaitent désormais exercer un contrôle sur les opérations militaires.
Aubérive
La préparation commence le 8 avril et doit être prolongée jusqu'au 16 en raison du mauvais temps. L'artillerie allemande effectue des tirs de contrebatterie meurtriers et emploie un grand nombre d'obus toxiques. 4 millions d'obus de 75, 1 million d'obus de 90 à 155 et 60.000 bombes de mortiers de tranchée sont tirés mais la longueur de la préparation exclue tout effet de surprise.
Le 16, les Français engagent pour la première fois des chars dans une attaque au nord de l'Aisne mais l'infanterie ne peut suivre leur percée et ils doivent faire retraite. 56 Schneider sur 132 rentrent indemnes. L'offensive semble d'ores et déjà vouée à l'échec mais Nivelle insiste.
La division marocaine est engagée le lendemain. Le RMLE occupe la droite de son dispositif avec pour objectif le village d'Aubérive, clef de voûte de la défense d'un saillant appelé "le golfe".
Par comble de malchance, la pluie remplace le soleil des jours précédents. Les légionnaires quittent leurs tranchées inondées à 4 heures 45 pour se retrouver immédiatement cloués au sol par le tir des mitrailleuses allemandes. La préparation d'artillerie s'avère une nouvelle fois insuffisante. Le manque d'artillerie lourde et la dispersion des tirs sur la profondeur du dispositif ennemi laisse la première ligne de défense presque intacte. Le lieutenant-colonel Duriez est l'un des premiers à tomber. Le commandant Deville lui succède. Un assaut général apparaît vite voué à l'échec. Les légionnaires sont immobilisés près du bois de bouleaux calciné qui borde Aubérive, à quelques dizaines de mètres de leurs positions de départ.
Les combats reprennent le lendemain sous la neige. La coordination avec l'artillerie reste médiocre et les légionnaires préfèrent souvent s'en passer. De toute façon, la progression se fait désormais par petits groupes autonomes qui cherchent à s'infiltrer dans le dispositif ennemi. Les combats se déroulent à courte distance.

Les Allemands se défendent avec vigueur. et lancent souvent des contre-attaques violentes et bien cordonnées à partir de positions arrières bien protégées. Le 19 dans la soirée, le 3e bataillon s'empare cependant d'Aubérive. Il ne compte plus que 275 hommes valides sur 800. Il faut ensuite déloger l'ennemi des tranchées environnantes. C'est chose faite le lendemain.
En quatre jours d'affrontement, le RMLE a utilisé 50.000 grenades. Celles-ci épuisées, les combats se poursuivent au corps à corps, au couteau et à la baïonnette. 7 kilomètres de tranchées et de boyaux sont ainsi nettoyés. Le manque de grenades et le mauvais temps empêchent toutefois les légionnaires de poursuivre plus avant contre un ennemi pourtant lui aussi durement éprouvé.
La conduite au feu d'un des rares allemands de la Légion engagés en France en dit long sur l'agressivité des légionnaires. Le 21 à l'aube, l'adjudant-chef Mader se porte au secours d'une compagnie du 168e régiment d'infanterie sur le point de tomber dans une embuscade. Avec dix légionnaires, il attaque à la grenade une compagnie ennemie et la met en déroute. Poursuivant son avantage, il s'empare d'une batterie d'artillerie lourde. Cet exploit hors du commun lui vaut la Légion d'honneur.
Epuisés, les légionnaires sont relevés et gagnent Pocancy dans la Marne. Sa conduite héroïque vaut au RMLE sa cinquième citation, à l'ordre de la IVe armée. Le 14 juillet suivant, le régiment reçoit la fourragère aux couleurs de la Médaille militaire, créée pour lui par le général Pétain qui aura ces mots : "Il est le premier de tous les Régiments de France à recevoir cette distinction. Il peut la porter fièrement."

Le RMLE et la crise du moral de 1917
Malgré des pertes moins élevées que lors des précédentes offensives, 150.000 hommes en dix jours, cet échec porte un coup décisif au moral de l'armée française. Nivelle avait annoncé une victoire finale qui semble de nouveau bien lointaine. Le 29 avril, des mutineries éclatent et près d'un tiers des régiments sont touchés par une grave crise du moral.

Le RMLE n'est pas concerné par ce phénomène et sert même à ramener des mutins vers la ligne de front. La réorganisation de 1915 qui fait du régiment une unité d'élite formée de combattants particulièrement motivés, explique en partie cette bonne tenue. Tous manifestent la volonté de se montrer digne de la prestigieuse réputation acquise dans les combats précédents.
D'autres facteurs peuvent être mis en avant. En 1916 et en 1917, le RMLE ne reste au front que pendant de brèves périodes. Même s'il participe à de violents combats, ceux-ci tournent à son avantage et renforce sa cohésion et son moral.
Au mois de mai, le lieutenant-colonel Rollet succède au lieutenant-colonel Duriez tué à Aubérive. Avec lui, le RMLE et la Légion étrangère vont trouver une figure emblématique. Il exerce d'emblée une forte impression sur ses hommes, prêts à le suivre n'importe où.
Changement de stratégie
Le général Nivelle est remplacé par Pétain qui ramène l'ordre dans les rangs de l'armée française. Il constate néanmoins que celle-ci est pour le moment incapable de reprendre une offensive de grande ampleur et adopte une stratégie défensive en attendant l'arrivée des Américains et la mise en service des chars.
Mais si les premières troupes américaines défilent dans les rues de Paris dès le 4 juillet, pour la fête nationale américaine, elles ne seront pas opérationnelles en grand nombre avant le milieu de l'année 1918. Les Etats-Unis débutent en effet la guerre avec une armée de terre extrêmement réduite. La France va devoir fournir une grande partie de son armement et de son équipement. Il faut également instruire et transporter à travers l'Océan Atlantique les divisions nouvellement formées.
Pour remonter le moral des troupes françaises, Pétain opte pour des offensives limitées avec un soutien d'artillerie massif. Le 31 juillet, la 1ère armée française attaque avec l'armée britannique et réussit dégager le saillant d'Ypres.
Verdun
Le 20 août, une seconde offensive est déclenchée à Verdun, où la Légion étrangère n'a pas encore combattu. Il s'agit de compléter la reconquête des territoires perdus lors des offensives allemandes de 1916. Pour la première fois, les attaquants disposent du soutien d'une grosse concentration d'artillerie lourde. Du 20 au 26 août, 3 millions d'obus de 75 et 1 millions d'obus lourds sont tirés, soit 5 tonnes par mètre de front.
L'objectif de la division marocaine est de reprendre aux Allemands un saillant sur la rive gauche de la Meuse. Le RMLE fait partie de la première vague d'assaut et doit prendre le bois de Cumières. Une autre unité doit ensuite pousser plus loin.
A 4 heures 40, les légionnaires du 1er bataillon s'élancent vers les lignes ennemies, collant au plus près aux tirs des canons français. Les défenseurs sont encore sous le choc d'une préparation d'artillerie enfin efficace. Les légionnaires prennent le bois de Cumières puis le boyau des Forges, réputés inexpugnables. Cette action d'éclat vaut au régiment une nouvelle citation.
Il est à peine 10 heures du matin et les pertes restent légères. Le lieutenant-colonel Rollet décide alors de pousser cet avantage inespéré. Son attention se porte sur l'ouvrage 265, situé un kilomètre plus loin sur la "côte de l'oie". Puissamment défendue, cette position d'artillerie semble en effet plus vulnérable à partir du bois de Cumières. Sous les yeux du général Pétain et du général Pershing, informés de l'évolution favorable de l'attaque, le 1er bataillon s'empare de l'ouvrage en moins d'une heure. Puis le 2e fait la conquête du reste de la "côte de l'oie".
Le lendemain, le 21 août c'est au tour du 3e bataillon de monter à l'assaut. Le village de Régnéville est rapidement conquis, puis le ruisseau de Forges est franchit et enfin les légionnaires prennent le village de Forges. Le RMLE a progressé de 3 kilomètres au prix de pertes minimes : 53 tués dont un officiers et 271 blessés et disparus dont 20 officiers. Bien que blessé d'un éclat d'obus au bras gauche, le lieutenant-colonel Rollet a conservé son commandement. Au total, 680 Allemands, dont 20 officiers, sont capturés. Les légionnaires s'emparent d'une masse considérable de matériel dont 10 canons de 77, 4 de 105, et 1 de 380.
Après cette offensive victorieuse, la division Marocaine est mise au repos dans la région de Vaucouleurs et de Bois l'Evêque. le 27 septembre, elle est passée en revue par le général Pétain. A cette occasion, il décore de la Légion d'honneur le drapeau du RMLE. En épinglant à la cravate du drapeau la croix de la Légion d'honneur, il annonce aux légionnaires la création prochaine d'une fourragère rouge, aux couleurs de la Légion d'honneur. Le 3 novembre, le RMLE est le premier régiment à la recevoir.

Dernière année de guerre
La crise des effectifs
Du 20 octobre 1917 au 17 janvier 1918, la Légion se trouve dans la région de Flirey. Seul un coup de main d'envergure, mené avec succès le 8 janvier, trouble la quiétude de ce secteur.
En ce début d'année 1918, le RMLE n'est pas épargné par une crise des effectifs qui touche d'ailleurs l'ensemble de l'armée française. Il récupère bien quelques éléments de qualité en provenance du bataillon d'Orient, récemment dissous, mais l'évolution reste préoccupante. Avec l'accroissement du nombre de pays belligérants, la Légion se trouve coupée de ses sources de recrutement traditionnelles.
La Suisse, l'Espagne et dans une moindre mesure les Etats-Unis continuent à fournir des contingents non négligeables mais insuffisants pour combler les pertes ou les départs pour les armées nationales, polonaise ou tchèque par exemple.
La défaite russe apporte une nouvelle vague de volontaires d'une qualité variable. La RMLE intègre ainsi trois bataillons qui se sont mutinés à la Courtine, en septembre 1917. Beaucoup de Russes désertent ou refusent de combattre, mais ils seront néanmoins nombreux à bien se comporter lors des premiers combats de l'année 1918. Pour autant, la fiabilité des Russes restent douteuse et conduit à préférer une intégration limitée après une sélection des meilleurs éléments lors de l'instruction.
Par ailleurs, Lyautey n'accède aux demandes de renforts qu'au compte-gouttes car les 5 bataillons de Légion sous ses ordres lui apparaissent indispensable pour conserver le Maroc. Cette situation inquiète le lieutenant-colonel Rollet qui craint la dissolution de son régiment en cas de nouvelles pertes importantes. Il propose alors de chercher des volontaires dans les régiments français voire de prélever sur les autres régiments les effectifs nécessaires pour conserver opérationnel un régiment aussi exceptionnel.
L'Allemagne reprend l'initiative
Après l'échec de l'offensive de Nivelle, seule l'armée britannique avait continué à mener des opérations de grande envergure à Messine, Ypres, Passchendaele et Cambrai. Cette dernière opération avait vu un engagement massif de chars sans préparation d'artillerie. Après un succès initial, des divisions allemandes transférées de Russie avaient lancé une contre-attaque victorieuse et repris le terrain perdu. Désormais les Anglais étaient également exsangues. A la fin du mois d'octobre, le désastre de Caporetto oblige même les Français et les Anglais à déployer 11 divisions dans la péninsule italienne pour soutenir une armé italienne en grande difficulté.
A l'automne 1917, le transfert en grand nombre des divisions allemandes du front de l'est redonne l'avantage numérique aux Allemands. Ludendorff décide alors de frapper un coup décisif avant le déploiement des troupes américaines. Un grand nombre de ses troupes emploient désormais une tactique particulièrement efficace : un tir d'obus à gaz et fumigènes puis un bref et violent bombardement suivi au plus près par des groupes d'assaut qui s'infiltrent en profondeur dans les lignes ennemies en contournant les points de résistance laissés à la deuxième vague d'assaut. Abondamment pourvus en grenades, pistolets, mitrailleuses légères et même quelques nouveaux pistolets-mitrailleurs, ces Stosstruppens ont déjà démontré toute leur efficacité en Russie (Riga), en Italie (Caporetto) et en France (contre-offensive de Cambrai).

Devant cette menace, Pétain préconise une défense en profondeur avec une position principale bien en arrière de la ligne de front. Les points de résistance situés en avant doivent ralentir et désorganiser les assaillants en attendant la contre-attaque des divisions placées en réserve comme la division marocaine et ses légionnaires.
Hangard-en-Santerre
Le 21 mars, les Allemands engagent les IIe, XVIe et XVIIIe armées dans le secteur de Saint-Quentin. Les 3e et 5e armées britanniques sont incapables de résister aux 66 divisions allemandes soutenues par 6.000 pièces d'artillerie. Une brèche de 50 kilomètres s'ouvre dans leurs lignes. Les 1ère et 3e armées françaises forment alors le groupe d'armées de réserve qui doit maintenir la liaison avec l'armée britannique.
La division marocaine débarque à Villers-Bretonneux le 2 avril, en provenance de Vaucouleurs. Une contre-attaque sur Avre est prévue le 12 mais la menace qui pèse désormais sur Amiens fait abandonner cette opération. Le 25, le RMLE est engagé à l'aile droite de la division marocaine. Il doit reprendre le bois de Hangard, situé au nord de la route entre Amiens et Noyon.
Pour la première fois les légionnaires vont bénéficier de l'appui des chars, britanniques en l'occurrence. Les Allemands s'avèrent néanmoins mieux préparés à un combat aussi mobile. Des groupes de mitrailleurs profitent du brouillard pour s'infiltrer entre les avant-postes français. Les chars s'avèrent incapables de les museler et leurs tirs fauchent les légionnaires dont la progression n'excède pas 500 mètres. A la fin de la journée il ne restera qu'un officier et 187 hommes valides au 1er bataillon. Le 3e bataillon le soutient mais perd son chef, le commandant Colin, et de nombreux autres en atteignant la lisière du bois. L'avance meurtrière se poursuit entre les arbres. Une brutale contre-attaque repousse temporairement les légionnaires mais ils produisent un nouvel effort et restent maître du terrain au prix de 120 tués, 497 blessés et 205 disparus.
Cette coûteuse action d'éclat vaut au régiment sa septième citation. Il tient sa position jusqu'à sa relève, le 6 mai, puis gagne la région de Versigny et d'Ermenonville pour prendre du repos. L'offensive allemande est stoppée mais la gravité de la situation oblige les Alliés à mettre enfin en place un commandement unifié : le 26 mars, le général Foch est nommé commandant en chef de l'ensemble des forces de l'Entente. Du 9 au 29 avril, Ludendorff lance une nouvelle offensive contre l'armée britannique dans les Flandres. Avec le soutien des Français, celle-ci est également contenue. Dans les deux cas les réserves d'artillerie française jouent un grand rôle en soutenant les contre-attaques.

Montagne de Paris
Le 27 avril, les Allemands lancent une troisième offensive au Chemin des Dames. Un violent bombardement à l'ypérite neutralise l'artillerie française. Contrairement aux consignes de Pétain, l'essentiel des défenseurs occupent les premières lignes et subissent de lourdes pertes.
L'Aisne est franchie dans la soirée. Le 1er juin, les Allemands atteignent la Marne à Château-Thierry. Le 29 mai, la division marocaine et le RMLE sont acheminés par camions à l'ouest de Soissons qui vient de tomber aux mains de l'ennemi. Il s'agit de bloquer son avance vers Villers-Cotterêts en prenant position sur la "Montagne de Paris".
L'attaque se déclenche au petit matin après un bref mais violent barrage d'artillerie. Nettement supérieur en nombre, l'ennemi réussit à prendre pied dans les positions de la Légion. Obligés d'économiser leurs munitions, les légionnaires perdent 47 tués, 219 blessés et 70 disparus en deux jours de combat. Ces pertes viennent s'ajouter à celles du mois précédent qui n'ont pas été compensées (1.250 hommes). Néanmoins, le RMLE réussit à maintenir ses positions et à bloquer l'avance allemande dans son secteur.
Saint-Bandry
Le RMLE reste engagé dans les environs de Soissons. Le 5 juin, il s'installe dans le ravin d'Ambleny à Courtanson, en avant de Saint-Bandry avec le 4e régiment de tirailleurs algériens. Le 12 juin, il perd 36 tués, 94 blessés et 5 disparus en subissant sa dernière attaque allemande sérieuse. Manquant d'effectifs, le régiment est menacé d'être tourné sur son flanc droit, à la Fosse-en-Haut. Deux compagnies d'infanterie et une compagnie de mitrailleuses du 7e tirailleurs algériens, placées sous les ordres du lieutenant-colonel Rollet, sont nécessaires pour rétablir la situation.
Les canons de 75 portés sur camions et la réserve d'artillerie lourde pilonnent les axes de pénétration allemands. Puis l'intervention près de Villers-Cotterêts de 5 divisions américaines, soutenues par les chars légers Renault FT-17, porte un coup fatal à l'offensive ennemie.
Ludendorff attaque de nouveau le 9 juin sur le saillant de Matz, entre les poche de Montdidier et de la Marne. Après un maigre succès initial les assaillants sont violemment contre-attaqués par 4 division françaises.
La contre-offensive de Foch
Bien que durement éprouvée, la division marocaine est désignée pour être le fer de lance de l'offensive préparée par Foch sur le saillant ennemi de Soissons. Ludendorff le prend de vitesse en attaquant une dernière fois le 15 juillet, près de Reims. Là où la tactique de défense en profondeur de Pétain est employée, les Allemands sont contenus. Ils réussissent néanmoins à percer à l'ouest de Reims et franchissent la Marne dans la région de Dormans. Epernay est menacée alors que les dernières réserves françaises sont épuisées.
Foch refuse d'effectuer des prélèvements sur la 10e armée de Mangin réservée pour la contre-offensive. L'artillerie et l'aviation française pilonnent les passages sur la Marne pour ralentir l'avance ennemi.
Dans la nuit du 17 au 18 juillet les 18 divisions de la 10e armée et les 9 divisions de la 6e armée occupent leurs positions de départ entre Soissons et Château-Thierry. L'attaque doit se développer sur une largeur de front de 40 kilomètres. Une puissante artillerie, 68 escadrilles et 545 chars sont engagés en soutien.
Le RMLE est chargé de prendre le plateau des Dommiers avec l'appui de chars légers Renault FT-17. L'attaque commence à 4 heures 45 du matin sans préparation d'artillerie mais derrière un barrage roulant. Le 2e bataillon en tête, le régiment s'enfonce profondément dans le dispositif allemand et prend le plateau de Dommiers. Le 20 juillet, les légionnaires atteignent la route de Château-Thierry à Soissons après avoir franchit le ravin de Chazelles-Léchelles et pris les positions ennemies de La Foulerie et d'Aconin. Les Allemands lancent alors trois contre-attaques à partir de Buzancy. Soutenus par de puissants tirs d'artillerie, ils reprennent la ferme de l'Aconin mais s'épuisent contre les défenses de la Légion. Les pertes atteignent 780 hommes et le RMLE doit être relevé dans la nuit. Ces deux mois de combats lui valent une huitième citation.
Avec 17.000 hommes et 300 canons capturés la contre-offensive de Foch est un succès. Leurs lignes de ravitaillement menacées, les troupes allemandes doivent évacuer le sud de la Marne puis se replier encore plus au nord derrières la Vesle. Le 6 août, Foch est fait maréchal de France.
La percée de la ligne Hindenburg
Le 8 août les Français et les Anglais portent un coup terrible à l'ennemi dans la région d'Amiens. Après ce "jour noir", l'armé allemande perd toute velléité offensive. Le 22 août, elle se retrouve repoussé sur ses positions du printemps. Le Kaiser et Ludendorff décident d'engager des négociations tout en tentant de se maintenir sur le sol français en tenant la ligne Hindenburg. Conscient de la faiblesse allemande, Foch s'apprête maintenant à porter une série de coups décisifs pour gagner la guerre en 1918.

Bien que réduit à 48 officiers et 2.515 hommes, le RMLE va contribuer de manière exemplaire à cette offensive finale. Dès le 1er septembre, il gagne le secteur du plateau de Laffaux pour relever des troupes américaines. Du 29 au 31 août, celles-ci ont tenté sans succès de prendre les villages de Terny et de Sorny. Le 2e septembre, la Légion s'empare de la position en quelques heures. Le 2e bataillon perd son chef dans l'affaire, le capitaine de Lannurien. Le 5, le 3e bataillon reprend la progression et occupe de vive force Neuville-sur-Margival et le tunnel de Vauxaillon. Dans les jours suivants, l'attaque s'enlise. Les compagnies du régiment ne compte plus en moyenne qu'une cinquantaine de combattants valides. Les autres unités de la division marocaine sont également éprouvées mais toutes s'avèrent encore capables d'un dernier effort pour percer la ligne Hindenburg.
Le 14 septembre, le bataillon Maire s'élance, soutenu par le bataillon malgache et un bataillon composé de Russes. Devant l'impétuosité de l'assaut, les Allemands cèdent : le château de la Motte et le village d'Allemant changent de mains. Le bataillon Maire capture un nombre de prisonniers double de son propre effectif.
Ces treize jours de combats ininterrompus valent au RMLE sa neuvième citation. Ils lui coûtent aussi la moitié de ses hommes avec 10 officiers et 265 légionnaires tués ainsi que 15 officiers et 1.143 légionnaires blessés.
La ligne Hindenburg est maintenant percée. Le 26 septembre, le maréchal Foch lance une offensive générale. Le 5 octobre, les Allemands abandonnent définitivement la ligne Hindenburg. Après un moment de panique, Ludendorff tente de replier en bon ordre ses troupes sur la Meuse mais la chute du moral sur le front comme en Allemagne rend la situation sans espoirs.
Les honneurs
Terriblement éprouvé, le RMLE reconstitue ses forces dans la région de Rosière-aux-Salines puis de Saulxures-les-Nancy. Le 26 octobre, il se met en route pour prendre part à la grande offensive qui doit libérer Metz mais la fin de la guerre survient avant son déclenchement. Le 11 novembre, l'armistice est signé dans le wagon de Foch à Versailles.
Les honneurs ne sont pourtant pas terminés pour le RMLE. Le 4 novembre, son drapeau reçoit la fourragère double aux couleurs de la Médaille Militaire et de la Légion d'honneur, pécialement créée pour l'occasion. Le Régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc (RICM) sera la seule autre unité à arborer cette distinction, c'est aussi le régiment le plus décoré de France devant le RMLE avec 10 citations.
Le 17 novembre, les légionnaires se retrouvent en Lorraine sur des territoires épargnés par la guerre. La population fait un accueil chaleureux à la division marocaine du général Daugan qui défile dans les rues de Château-Salins. Le colonel Rollet marche à la tête de son régiment, son flanc couvert de médaille. Le général Daugan fait alors former le carré pour rendre un hommage particulièrement émouvant au drapeau du RMLE.
Le 1er décembre, les légionnaires pénètrent en Allemagne, à Hornbach. Le régiment fait ensuite partie des unités qui ont l'honneur de monter la garde au Rhin.
Ultime honneur accordé à seulement cinq régiments, le drapeau du RMLE est décoré de la Médaille militaire le 30 août 1919.
Sur les autres fronts
Les Dardanelles
Sur l'insistance de Winston Churchill, alors Premier Lord de l'Amirauté, la France et l'Angleterre mènent une opération conjointe pour forcer les détroits turcs. Après une première phase navale de plusieurs mois qui pousse pourtant l'excellente défense turque presque à bout, il est décidé d'opérer le débarquement d'un corps expéditionnaire dans la péninsule de Gallipoli.
Mal conduite l'opération tourne rapidement au désastre. Les troupes débarquées sont décimées ou restent au bord des plages. Les Turcs renforcent leurs défense mais s'avèrent incapables de rejeter les assaillants à la mer malgré plusieurs contre-attaques particulièrement violentes.
Le 1er étranger et le 2e étranger fournissent chacun deux compagnies pour former un bataillon de marche intégré au 1er régiment de marche d'Afrique. Le 28 avril, les légionnaires débarquent à Seboul-Bahr et s'emparent des objectifs qui leurs sont assignés malgré de lourdes pertes. Cette action vaut au bataillon une citation mais en juin il doit être retiré car il ne compte plus qu'une centaine d'hommes commandés par l'adjudant-chef Léon. Tous ses officiers sont hors de combat. En décembre 1915, l'ensemble du corps expéditionnaire est rembarqué, longtemps après les légionnaires.

En Serbie
Reconstitué en partie grâce aux meilleurs éléments du bataillon grec, dissous après son mauvais comportement au feu en France, les légionnaires sont en engagés dans les Balkans. La France à décidé de soutenir son allié à partie du port de Salonique, au grand mécontentement du gouvernement grec. Avec l'entrée en guerre de la Bulgarie aux côtés des puissances centrales, la position serbe devient intenable. Belgrade tombe aux mains des forces allemandes et autrichiennes après seulement deux jours de combat, le 9 octobre. Deux jours plus tard, les Bulgares passent à leur tour à l'offensive, coupant la route de Salonique à l'armée serbe en pleine retraite. Celle-ci entame alors une longue retraite vers l'Albanie.
Le 16 novembre, le bataillon de marche obtient sa deuxième citation lors de l'attaque de la "Dent de scie". Puis il participe à la retraite à travers les montagnes par un froid rigoureux.
De septembre à novembre 1916, le bataillon de marche participe à l'offensive des forces serbes et françaises à l'ouest du Vardar. Il entre à Monastir en même temps que la cavalerie serbe et gagne dans ces combats sa troisième citation et la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre.
Trois mois plus tard le bataillon participe à l'attaque de la Trana Stena et s'empare des objectifs qui lui sont assignés. Les contre-attaques bulgares sont repoussées mais ne laissent que deux cents légionnaires valides. Les bataillons est alors dissous et l'essentiel de son effectif rejoint le RMLE en France à la fin de 1917.
Russie du nord
L'armistice ne signifie cependant pas la fin des combats pour la Légion étrangère. Elle doit former un bataillon de marche pour renforcer le Corps d'occupation française en Russie du Nord. Sa 1ère compagnie gagne Oboserskaïa dans les premiers jours de décembre 1918. La 2e compagnie arrive en mars 1919 et se trouve engagée dans de violents affrontements. La température très basse rend la campagne particulièrement éprouvante
La 3e compagnie et la compagnie de mitrailleuse ne rejoignent qu'au mois de juillet. Le bataillon reçoit alors l'ordre de barrer la route d'Arkhangelsk à l'Armée rouge. Quelques mois plus tard, il est dissous et rattaché au 1er étranger. Quelques légionnaires libérés vont combattre devant Petrograd avec l'Armée russe blanche de Boudenitch.
Après le conflit
Le remarquable comportement de la Légion étrangère en France mais aussi au Maroc se traduit pour le corps par un prestige encore jamais atteint.
En juin 1919, un ancien de la Légion étrangère, le général Mordacq, devient chef de cabinet de Clemenceau. Il entreprend de réorganiser le corps et souhaite créer des divisions de Légion étrangère dotées de cavalerie et d'artillerie. En novembre, Lyautey évalue à 30.000 européens les effectifs nécessaires pour contrôler le Maroc. Il réclame le développement de la Légion étrangère pour satisfaire ces besoins. Les régiments de cavalerie et d'artillerie sont crées par décrets en 1920.

Le 1er étranger reste à Sidi-Bel-Abbès qui devient un centre administratif et un centre de formation. Le 2e étranger quitte Saïda pour Meknès. Le Régiment de Marche de la Légion Etrangère (RMLE) devient le 3e étranger et prend garnison à Fès, en janvier 1921. Le 4e étranger est formé à Meknès en décembre 1920, puis transféré à Marrakech. Le régiment étranger de cavalerie est formé à Sousse en Tunisie en 1922.

Le général Rollet s'aperçoit très vite que la "nouvelle Légion" se trouve face à un problème de recrutement encore plus grave qu'avant la Grande Guerre. Sur le plan quantitatif, il faudra attendre la grande crise économique de 1929 pour disposer de suffisamment d'engagés.
L'organisation officielle du 10 janvier 1921 est de 4 régiments. Chacun d'eux comporte 5 bataillons de 500 hommes et deux compagnies montées de 250 hommes chacune. Cet organigramme implique un effectif total de 18.000 légionnaires difficile à réaliser. En 1923, la Légion ne dispose au total que de 13.469 hommes.
La Légion étrangère compte alors 18 bataillons d'infanterie, 6 escadrons de cavalerie, 5 compagnies montées et 4 compagnies de sapeurs. Le développement du corps ne s'arrête cependant pas là. En 1930, les 3 bataillons du Tonkin cessent d'être rattachés administrativement au 1er étranger pour former le 5e étranger. En 1939, 3 bataillons du 1er étranger et un du 2e stationnés en Syrie forment le 6e étranger. La même année, un 2e régiment étranger de cavalerie est constitué. Les régiments d'artillerie prévus ne seront cependant jamais formé, mais quelques batteries sont mises sur pied pendant les années trente. En 1933, la Légion étrangère compte 33.000 hommes.